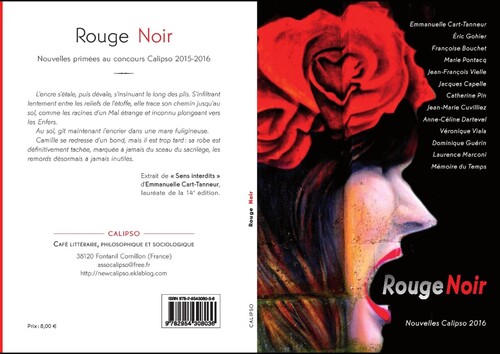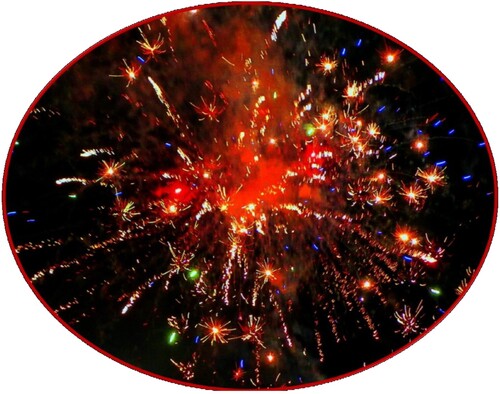-
Par Barman le 7 Juin 2016 à 09:13
Nous croyons savoir que Ludmila Safyane naquit, comme son ami le petit poucet, dans une fratrie nombreuse, à la lisière d’une forêt de sombres bâtiments dont les cimes accrochaient les nuages, vous savez, de cette sorte d’immeubles qui prirent racine en France dans les années 70.
Nous pourrions ajouter que le contact avec une jungle aussi urbaine provoqua immédiatement chez cette enfant sensible un irrémédiable désir d’évasion. A trois ans, elle construisit un navire en allumettes et fit un premier tour du monde, accompagnée de Sans-Nom, son chien bleu en peluche. Elle en profita pour écrire son premier roman l’année suivante, texte qu’elle grava elle-même sur des planches de chêne récupérées dans le grenier de sa mère-grand…
Quoi ? Que dites-vous ? … Fariboles et carabistouilles ?... Oui. Sans doute… Elle finit, en effet, par revenir, par s’assagir et par vivre à peu près comme tout le monde, avec un métier, un mari et des enfants, un ordinateur, une cafetière, des voisins, un basilic en pot et un bocal à poisson rouge sans poisson rouge. Et puis, dans le coin de l’esprit, une petite cheminée où le bois de la folie douce brûle encore un peu…Intermezzo
Ludmilla SAFYANE
Lui« On a dit soirée italienne, mais y’a plus d’olives pour les pizzas ! »
Voilà ses derniers mots. Ou plutôt les avant-derniers, parce qu’après elle a ajouté : « J’passe à Carrouf. Sors les antipasti, poussin, j’suis là dans un quart d’heure. »
Elle l’a appelé vers 18h30. Il a répondu : « OK, à tout de suite » et il a raccroché en sortant deux tranches de jambon et des gressins. Elle est marrante avec ses soirées à thèmes. « On avait dit, on avait dit… » C’est toujours elle qui choisit. Une fois l’Espagne, l’autre le Maroc ou le Viêt Nam ; elle ne tient pas en place. Ce vendredi-là, c’est destination Italia ! « Comme un air de Naples ou de Florence, hein mon p’tit Romain ? » elle lui a balancé. Il ne lui a pas dit que Florence, c’est le prénom de son premier amour, au collège. Une grande brune avec les yeux de Sophia Loren qu’il n’a jamais vraiment oubliée. On a droit à ses petits secrets...
Elle avait choisi la destination, mais le vin c’est l’affaire de bibi. Faut pas déconner non plus. Il a ouvert une bouteille de Mercurey et l’a posée à côté des gressins.
Et puis il a attendu.
Il s’est dit qu’il avait bien manié les choses. Encore un peu et elle invitait ses amis assommants. Elle adore inviter. Il lui faut toujours du monde, du changement, de l’animation… c’est épuisant. Il a soupiré. Un vendredi soir à deux de temps en temps, juste elle et lui, c’est pas du luxe.
Il attend et il se repasse le disque. Elle l’a appelé vers 18h30. Elle a dit « Sors les antipasti, poussin, j’arrive.» Ou quelque chose d’approchant. Elle a dit « poussin », il s’en souvient parce qu’il a trouvé ça touchant et ridicule, ça lui a fait une petite chaleur agaçante au fond du cœur. Et puis il a tout bien fait comme elle a dit, sortir les machins et le vin, et puis il a attendu.
Il est une heure du matin. Elle n’est toujours pas rentrée.
Dire qu’il s’inquiète est faible. Il sait qu’il lui est arrivé quelque chose. Au fond de lui, il sait. Quelque chose de terrible que son imagination lui présente avec trop de réalisme, avec des images qu’il essaie de repousser encore un peu. Il ne veut pas savoir, pas encore.
D’habitude elle répond tout de suite au téléphone. Ou bien elle rappelle dans les 5 minutes. Il a dû envoyer au moins dix, quinze SMS. Plus encore. Il a commencé vers 20h.
« T’arrives ? »
« T’es où ??? :/ »
« J’ai ouvert la bouteille, je suis au lit, à oualpé. ^-^ »
« Sans dec, réponds, merde !! »
Après il a essayé de la joindre directement, bien sûr.
«Vous êtes sur le répondeur de Mélanie Berlot, je ne suis pas là pour l’instant… etc.» Il a laissé un message, puis un deuxième et puis… Elle n’a pas rappelé.
Il est une heure du matin et il a arrêté de jouer avec le téléphone. Ça ne sert à rien. Si elle ne répond pas, ne le rappelle pas, c’est qu’il y a une raison. C’est qu’elle en est physiquement empêchée.
Il a peur.
Il se sent impuissant.
Le plus drôle dans cette histoire, non ce n’est pas drôle. Le pire dans cette histoire, c’est les flics. Ces cons. Quand il y pense, il a envie de chialer, de frapper, de tout faire péter. Il leur a téléphoné vers minuit et demi. Une nana lui a répondu qu’ils ne pouvaient rien faire, d’abord qu’il était trop tôt pour ce genre de cas, qu’une petite escapade dans un couple, ça arrive parfois, qu’elle allait peut-être rentrer dans la nuit, qu’elle avait peut-être tout simplement rencontré une amie d’enfance et que son téléphone était déchargé, ou bien… Il a eu du mal à supporter tous les sous-entendus de l’interlocutrice. Elle va rentrer, oui, la robe un peu froissée peut-être, les cheveux en bataille… Non, la policière n’a pas réellement dit ces mots. C’est lui qui a interprété le ton léger, l’ironie à peine voilée. Les cornus ont toujours fait sourire les braves gens.
Pourtant, là c’est différent. Mélanie ne le trompe pas. Mélanie est en danger ! À quoi ils servent ces abrutis ? C’est pour ce genre de réponse de m… qu’on paie nos impôts ?
Certes, Romain s’est sans doute un peu emporté au téléphone, il n’est pas toujours resté courtois et l’interlocutrice a été moins patiente sur la fin. Elle s’est sentie en droit, au bout de quelques minutes, de lui balancer deux ou trois mots en pleine poire, des mots aux contours acérés pour lui rappeler que la loi n’interdit pas à une femme adulte de sortir la nuit, que ça plaise ou non à môssieur qui se croit sans doute propriétaire… et que n’étant ni mariés, ni pacsés, techniquement Mélanie Berlot n’est rien pour lui, d’un point de vue légal, et - plus dur encore - il n’est rien pour elle. Il a eu beau gueuler qu’ils doivent se marier le mois prochain, que ce silence n’est pas normal, qu’il lui est forcément arrivé un truc – il n’ose pas donner d’exemple, mais les images-choc chahutent dans sa tête - rien à faire !
« Il faut attendre. Prenez un somnifère. »
Saletés de fonctionnaires ! Il est seul. Il tourne en rond. Qui appeler ? Que faire ? Il n’en peut plus. Il passe une veste, descend à la voiture et fait le tour de la ville. Il repasse devant le bureau où Mélanie travaille, fait le trajet qu’elle a dû faire jusqu’au Carrouf. Tout est noir, vide, silencieux. Il pleut un peu. Un type promène son chien.
Romain tourne encore un peu en scrutant chaque ombre qui passe. Rien. Il est seul. Il continue dans les rues solitaires jusqu’à ce que la fatigue et le désespoir le submergent.
Mélanie est peut-être rentrée entre-temps. Romain fait demi-tour, gare la bagnole et remonte à l’appartement.
Tout est sombre. Il n’allume pas. Il se traine jusqu’au salon et se recroqueville dans un coin.
Sur la table, la bouteille de Bourgogne a des reflets hésitants.
C’est le moment où la nuit prend le dessus.
ElleC’est à cause des olives tout ça. Des noires, à la grecque, c’est indispensable pour faire de bonnes pizzas. Y’en avait plus à la maison.
Les pizzas, Romain, il adore ça. Et elle, elle cherche à lui faire plaisir. Chaque vendredi elle tente un truc fun, histoire de mettre du peps’ dans leur petite vie de province ennuyeuse. Le mariage lui fait un peu peur aussi : si c’est pour s’encroûter, ça craint ! C’est vrai que Romain, question ambiance, on repassera. Pantouflard comme pas deux. Si on le laissait faire, ça serait pire que Cayenne !
Bon, elle exagère un peu…poussin, il est mignon, tendre, il l’adore, ils s’adorent… mais deux ans c’est long et ces derniers mois ça ronronne un peu trop. Besoin de piment !
La berline s’engage sur l’autoroute.
C’est à cause des pizzas, ou grâce aux pizzas, comment savoir... Elle est assise dans une super bagnole, à côté d’un « putain de beau gosse », comme dirait sa collègue Sandra, un mec à faire pâlir d’envie toutes les nanas de la boîte, et même la grande Émilie du service compta, elle qui se la joue avec ses rencontres sur Meetic ! Un truc de ouf, un plan d’enfer !
Elle se repasse mentalement la scène : Elle a tendu la main pour prendre le bocal d’olives et lui, il a fait pareil, en même temps qu’elle, comme dans les séries télé !
« Excusez-moi.
- Non, c’est moi.
- Pas de soucis. »
Jeu des regards. Accent italien. Sourire Colgate. Waouh ! Leurs bras se sont frôlés. Électricité. Deux minutes après, même topo au rayon coulis de tomate. Re-sourire de connivence. Début de conversation à propos du basilic et de la mozzarella. Et puis l’horizon s’est élargi…
« C’est à Napoli qu’on fait les meilleures pizzas. Vous connaissez la côte d’Amalfi ? »
Ils ont poursuivi à la caisse. Trop craquant le type. Elle a craqué.
Elle s’en veut quand même. Romain l’a appelé une bonne centaine de fois. Elle n’a pas répondu. Qu’est-ce qu’elle lui aurait dit ? Qu’elle était en train de faire une folie ? Qu’elle filait vers Paris aux côtés d’un top modèle ? Il doit être mort d’inquiétude. Tel qu’elle le connait il a dû appeler le GIGN et déclencher le plan ORSEC.
Ils roulent vers la Ville lumière. On n’est qu’à deux heures et demie. Il connait un petit pub sympa dans le Quartier latin, il a dit, ils mangeront un truc avant, sur la route. Elle a accepté. C’est vendredi soir. Elle est folle.
La route défile. La bagnole est confortable, une Allemande qui tient parfaitement le 160. Il doit avoir du fric en plus… Y’a des gens, comme ça, qui ont tout. Elle le regarde. Il lui parle et lui sourit. Il est beau. Elle est folle. De lui.
Le type est bavard comme un Italien, oui, un vrai rital, originaire d’un petit village de Sicile, il dit, Farnianto… Faribolo… ou quelque chose dans le genre, une beauté de pierre face à la mer turquoise, il l’emmènera un jour, elle va adorer…
Pour une fois que ce n’est pas elle qui doit alimenter la conversation, c’est reposant, elle n’a qu’à se laisser aller, comme prise par les vagues de la mer turquoise, elle flotte dans un rêve, elle sourit, elle dit « oui, oui… »
Et de temps en temps elle pense à Romain. Elle se réveille un peu… C’est n’importe quoi ! Qu’est-ce qu’elle fout là ? Avec un parfait inconnu.
Avec un inconnu parfait…
Et elle replonge. Elle veut vivre ce rêve, une nuit, une seule, sa dernière soirée de célibataire, juste une parenthèse, un intermède, une bulle de champ’ dans sa vie ordinaire.
Une fois mariée, elle sera sage.
Demain elle rentre au bercail.
Elle dira à Romain que son portable était déchargé… et que…qu’elle a rencontré une vieille copine de lycée, Florence par exemple, il ne la connait pas, ne pourra pas vérifier. Oui, Florence, c’est une bonne idée. Mélanie dira qu’elle l’a rencontrée par hasard à Carrouf, au rayon des olives, et que Florence n’allait pas bien du tout. La copine viendrait de se séparer de son copain qui la trompait – le salaud - et la battait aussi…tiens, pourquoi pas. La totale quoi ! Ça arrive ce genre de truc, non ? On vit pas au Paradis ? Bref, la fille aurait eu des idées de suicide, il aurait fallu rester avec elle toute la nuit. Voilà. Elle est désolée.
Bon.
C’est bien comme ça. Bon plan.
La voiture s’enfonce dans la nuit autoroutière. Le mec a mis de la musique. L’ambiance tamisée invite à l’intime. Mélanie a enlevé ses escarpins. Ses pieds endoloris par la journée de boulot gigotent en douce. Son collant a filé sur le côté ; elle aurait dû en acheter une paire à Carrouf. Elle tire un peu sur sa robe magenta. Un coup d’œil au rétro. Elle se trouve jolie aujourd’hui. Un petit côté coquin qui lui va bien.
C’est le moment où le désir prend le dessus.
L’autreC’est la robe qui l’a attiré. Un rouge comme ça, on peut pas le rater ! Et puis les jambes, les cuisses, le cul ! Au début, il ne pensait pas à ça, ce soir. Il s’était juré d’arrêter depuis la petite blonde du Super U.
Ce soir, il voulait juste des olives. Mais quand il a vu la fille, un truc s’est déclenché en lui, comme un signal. Le destin lui met ça sous le nez et faudrait pas qu’il y touche ? Pure provoc’ !
En plus elle ne demandait que ça, la meuf du Carrefour, ça se voyait à des kilomètres. C’est toujours la même chose. Dès qu’il entre quelque part, les nanas le matent comme un loukoum, les jeunes et les vieilles… Faut dire qu’il fait tout pour : muscu, UV, fringues de marque… et la bagnole en prime. Alors si ça ne marchait pas, ce serait le comble !
Bon, pour l’accent italien il a peut-être exagéré. À cause de cette histoire des pizzas, c’est venu sans prévenir. Bon comédien. Excellent même ! Et il a de l’imagination. On se demande bien pourquoi il n’arrive pas à décrocher autre chose que des rôles secondaires dans des films de séries B… Heureusement qu’il y a la pub et les catalogues par correspondance, ça paie pas trop mal.
Et puis avec les femmes, ça fonctionne bien tout ça !
D’accord, ses petites pratiques surprennent parfois au début, ne plaisent pas toujours… mais on finit par s’arranger. Grosso modo, la vie n’est pas désagréable.
Le ruban d’asphalte se déroule devant la voiture. Paris est encore loin, mais un panneau affiche la sortie 23 qu’ils vont bientôt prendre.
Au fond de lui, il sait bien qu’il ne devrait pas. Il sait que ce serait plus simple d’aller simplement boire un verre au Quartier latin. Il pourrait encore changer de voie, il est encore temps.
Sortie. Péage. Route nationale.
Trop tard pour faire demi-tour.
C’est toujours à ce moment-là qu’elles demandent où on va. « C’est pas la route, ça ! » La réponse est toute trouvée : un petit resto sympa qu’il connait, pas loin, une bonne pizzeria. Ils rient. Elle n’a pas faim, elle ? Lui a une faim de loup.
Il pense à la maison, touche sa poche discrètement. Heureusement qu’il a toujours les clés au cas où. Beau mec et prévoyant.
Après le deuxième virage, on est rapidement loin du monde. La route traverse la forêt. C’est là que les questions reviennent. Avec un peu d’inquiétude dans la voix, c’est drôle, elles sont toutes pareilles. Et quand il bifurque et prend le chemin creux, l’angoisse fait son entrée, faut voir ça ! Là, des fois, y’en a qui crient, qui veulent sortir, qui découvrent que les portes sont verrouillées. Parfois même faut s’arrêter là, juste pour les faire taire tellement elles braillent, mais il n’aime pas trop parce que ça salit la voiture, et les taches partent difficilement ensuite.
Après, rouler sans phares jusqu’à la maison en contrebas. Ouvrir rapidement la porte de derrière et descendre ensemble à la cave. Ensuite c’est cool, le temps ne compte plus. Les gens ont oublié cette bicoque abandonnée au milieu des bois face aux vignobles de Bourgogne. Personne ne viendra les déranger.
C’est le moment où la nuit prend le dessus. 12 commentaires
12 commentaires
-
Par Barman le 31 Mai 2016 à 09:00
Enseignant-chercheur, Jean Gualbert écrit quelques nouvelles et poèmes en amateur. Certains de ceux-ci ont été publiés en recueils (parus chez Dix de Plume, éditions Grrr...Art, éditions Aljon, les Dossiers d'Aquitaine, les Joueurs d'Astres, les Grilles d'Or...).
Voyageur du néant
Jean Gualbert
Le corbeau s'était posé sur un rocher, en bordure de chemin. De son large bec anthracite, il lissait son plumage, taché de croûtes rougeâtres encore visqueuses, témoignages de son dernier repas. Au passage de l'homme, il se contenta de croasser, en sautillant maladroitement, pour manifester un net mécontentement. Le marcheur, bien trop vivant, ne l'intéressait pas encore.
Ce n'est que quelques centaines de mètres plus loin que l'homme, soulevant une nuée de mouches, dépassa les restes dont s'était rassasié l’oiseau : un vieillard, dont ne subsistait que la maigre carcasse déchiquetée à coups de becs, de griffes et de dents par tout ce qui pouvait se repaître de viande.
Fuir ! Cela faisait trois jours qu'il n'avait plus pour perspective que cette course désespérée vers l'inconnu. Quand les autorités de la petite ville où il exerçait la profession de photographe avaient convoqué tous les membres de sa communauté pour le lendemain à l'aube, leur enjoignant d'apporter leurs biens les plus précieux, il avait compris. On leur avait parlé de camps où ils pourraient travailler pour le bien de tous, mais seuls les naïfs y avaient cru. Les anciens, trop âgés pour se révolter, s'étaient résignés, pleurant le sort de leurs petits-enfants autant que le leur. Quelques jeunes hommes avaient déjà gagné les bois des alentours, tentant vainement d'y organiser la résistance. Mais la plupart restaient comme pétrifiés, incapables de prendre la moindre décision, prêts à se rendre sans broncher à leurs bourreaux dans l'espoir d'une improbable clémence.
La seule issue possible était le Nord-Est, la direction de la Russie d'où pouvait venir l'unique secours envisageable. Il lui fallait pour y parvenir marcher de longues heures, contournant villages et hameaux, se nourrissant de ce qu'il pourrait glaner, évitant surtout les patrouilles qui ne manqueraient pas de sillonner la contrée. Puis il devrait franchir la ligne de front sous la menace tant des balles de ses concitoyens, devenus ennemis, que de celles d'étrangers pourtant plus susceptibles d'éprouver quelque forme de compassion. Mais il n'avait d'autre choix que d'abandonner son confort, ses amis, sa maison, la terre et les coutumes de ses ancêtres. Après avoir fouillé les ruines encore fumantes de la masure du vieil homme, dans l'espoir vain de découvrir de quoi repaître sa faim tenaillante, il reprit sa route.
Il venait de dépasser la lisière d'une lande aux taillis clairsemés quand il déboucha sur ce carrefour dont le souvenir ne cesserait de hanter ses nuits. Une colonne de prisonniers y avait fait halte. Quelques-uns d'entre eux avaient-ils tenté de se révolter ou de prendre la fuite, profitant d'un moment de relâchement de leurs gardes ? Ceux-ci s'étaient-ils simplement trouvé las de conduire ce troupeau de morts en sursis ? Les pleurs d'un enfant, les plaintes d'un blessé les avaient-ils exaspérés ? Toujours est-il qu'ils s'étaient déchaînés, massacrant jusqu'au dernier les captifs qu'ils prétendaient escorter vers un avenir meilleur, abattant ceux qui espéraient trouver refuge dans les collines qui bordaient la route, achevant au couteau les blessés, égorgeant sans remords femmes, éclopés, nourrissons.
Sur un talus, il trouva confirmation des rumeurs les plus horribles qui couraient le pays. Un amas sanglant de femmes éventrées et de fœtus réduits en charpie attestait que, pour se distraire, la soldatesque s'amusait à parier sur le sexe d'enfants à naître, avant de désigner le vainqueur en arrachant aux mères encore vivantes l'objet de leur prédiction. La volonté de purifier le pays, d'y garantir la sélection d'une population nettoyée de toute trace de différence, d'éliminer toute croyance qui divergerait de la religion du plus grand nombre avait atteint ses limites les plus abjectes.
Les heures qui suivirent cette macabre découverte furent terribles. Il lui semblait que tout repère avait disparu, que toute valeur avait été réduite à néant sous l'œil cynique de dieux dénués de pitié. Hagard, il continuait à marcher sans que son esprit ne puisse se fixer sur quelque but, sur quelque espoir de réconfort. La faim, la soif, le sommeil l'avaient abandonné en même temps que tout sentiment d'appartenance à l'humanité. Après une nuit d'errance, il s'effondra à l'abri d'un rocher, dans une inconscience déchirée de visions apocalyptiques, de hurlements déments, de spectres hallucinés. Sans cesse ses pensées le ramenaient aux siens, aux cousins qu'il avait laissés à leurs atermoiements, à ses amis avec qui il plaisantait gaiement à peine quelques jours plus tôt. Sans doute, ne devait-il pas rester d'eux beaucoup plus que les cadavres sanglants croisés le matin même. Il resta là, prostré, incapable de la moindre réaction, pendant une interminable journée. Au soir, rassemblant péniblement ses esprits, il reprit son cheminement de voyageur du néant.
Deux longues journées d'errance le conduisirent en bordure d'une maison isolée. Quelques poules picoraient à l'abri d'un maigre grillage. C'était l'aube, personne encore n'était passé pour prélever les œufs fraîchement pondus. La faim, qui le tenaillait plus encore que la soif, étanchée au hasard de maigres ruisselets, le décida à prendre le risque de se faire repérer. Il allait s'éclipser, après avoir gobé goulument son butin, lorsqu'une voix fluette le fit sursauter :
– Bonjour, que fais-tu dans mon poulailler ?
C'était une toute petite fille, âgée de peut-être six ans. Ses vêtements indiquaient clairement qu'elle n'appartenait pas à sa communauté.
Il rougit violemment, contraint d'avouer son larcin.
– Maman m'a envoyée chercher les œufs du matin. À présent, je ne pourrai plus rien lui rapporter. Que vais-je lui dire ?
– Peut-être que tu n'en as pas trouvés ? Ce ne serait pas mentir, puisque je les ai mangés.
– C'est vrai, mais pourquoi viens-tu les prendre chez nous ? Tu n'as donc pas de poules ?
– Non, comme toi j'en avais, mais je les ai perdues. J'avais très faim, je n'ai plus mangé depuis deux jours.
– Tu sembles fort fatigué aussi ! Viens te reposer chez nous, mon père te donnera l'hospitalité, maman te préparera un repas.
– Tu es très gentille, mais je ne crois pas que je serais le bienvenu...
– Pourquoi donc ? Tu es méchant ?
– Non, je ne pense pas. C'est une histoire d'adultes, le nom que je donne à Dieu n'est pas le même que celui que tes parents et toi utilisez.
– Tu crois que cela lui pose un problème, à Dieu ? Ma maman et mon papa me donnent des petits noms différents, et les gens du village encore un autre. J'aime beaucoup cela, j'ai l'impression que chacun m'aime un peu différemment, mais tout autant que les autres.
– Sans doute, mais toi tu es une charmante petite fille, pas un dieu sévère...
Le bruit de la conversation, le retard de la fillette avaient attiré les parents à l'extérieur. À la vue de cet étranger ils eurent tout d'abord un mouvement de crainte, rappelant à eux leur enfant. Lui se crut perdu. C'était un temps où les différences ethniques ne pardonnaient pas. Toutefois, l'air enjoué de la petite fille, son absence complète de peur, le récit qu'elle fit à ses parents agirent comme un charme bénéfique. L'homme et la femme invitèrent le voyageur à se restaurer et à prendre quelque repos. Devant tant de bonté, celui-ci éclata en sanglots.
Le père de famille lui dit alors, comme pour s’excuser :
– Comment pourrions-nous être moins généreux que notre enfant, une fillette si petite, si frêle qu'elle devrait pourtant redouter tout passant inconnu ? Ne nous montre-t-elle pas l'exemple en t'invitant à partager notre demeure ? Je sais que tu appartiens à cette race que nos dirigeants disent impure, qu'ils nous ordonnent de pourchasser pour assainir le pays. Je n'ai que faire de ce régime qui se prétend nouveau, qui se croit destiné à durer toujours, mais qui attise les haines anciennes et détruit son propre peuple. Chez nous, tu ne crains rien. Repose-toi, prends des forces et repars quand tu t'en sentiras capable. Nous prierons pour que ton chemin te mène à la paix.
Quelques jours plus tard, ragaillardi par l'espoir que lui avait insufflé la rencontre de cette famille accueillante, il parvint à la ligne de démarcation entre les deux armées. Il décida de tenter le passage à l'aube, quand les sentinelles s'assoupissent. Une légère brume semblait devoir favoriser son entreprise. Lentement, il se glissa hors de l'ombre protectrice de fourrés épais pour s'aventurer en terrain découvert, évitant les postes de garde, attentif à la présence de la moindre silhouette. Mesurant ses gestes, il avançait courbé, presque à quatre pattes, sans mouvements brusques, n'hésitant pas à s'arrêter dans sa progression ou à ramper quand quelque bruit lui faisait redouter d'être découvert. Il ne lui restait plus que quelques dizaines de mètres à franchir avant d'atteindre les premières lignes russes quand les nuées se déchirèrent pour laisser place à la lueur d'une aube naissante. Presque aussitôt, une détonation retentit. Une vive brûlure lui déchira la poitrine, et il tomba, face contre terre. Avant de perdre conscience, il put admirer une dernière fois le soleil illuminant les collines de son pays, de son Arménie chérie.
Le corbeau se posa lourdement, inclina la tête pour s'assurer de l'absence de tout danger, puis s'approcha en sautillant. Cette fois, l'homme l'intéressait. Ce n'était plus qu'une de ces innombrables charognes parsemant le pays depuis quelques semaines. Il pouvait entamer un nouveau repas sans crainte.
 6 commentaires
6 commentaires
-
Par Barman le 24 Mai 2016 à 09:00
Danielle Akakpo réside à Saint-Etienne, capitale du design et des Verts – qui ne sont en rien ses sources d’inspiration – ! Ne se considère pas comme un écrivain, terme qui implique pour elle une professionnalisation, mais comme un auteur qui souhaite faire partager des émotions.
Pour faire mieux connaissance avec elle :
Forum Maux d’Auteurs (dont elle est l’animatrice) : http://www.forum-mda.com
Toi ma p’tite folie : son dernier recueil publié aux éditions Zonaires.P’tit frère
Danielle Akakpo
Les années ont passé, p’tit frère, mes cheveux grisonnent, les tiens et ta barbe aussi, et je m’aperçois que malgré moi je me mets à ressasser de vieux souvenirs. Toi aussi, peut-être ? Il en est un qui remonte à fin 1970 qui me revient ce soir à l’esprit, sans doute parce que les fêtes de Noël approchent, que la nuit s’installe doucement et que les seules lueurs dans la pièce émanent des boules rutilantes que j’ai accrochées au sapin dans l’après-midi. Devrais-je parler de souvenir, d’ailleurs, puisque cette histoire, je ne l’ai vécue que par personne interposée ? J’étais loin, notre mère me l’a racontée brièvement au téléphone. Par la suite, elle me l’a narrée à plusieurs reprises de vive voix, enrichie de détails et de commentaires si bien qu’il m’a souvent semblé que j’étais présente. Je me demande si toi aussi, il t’arrive d’y penser encore.
Elle avait tant d’amour pour toi, maman. Pour toi le dernier-né, le bébé de la quarantaine, celui dont on se serait volontiers passé dans notre famille ouvrière où l‘on tirait le diable par la queue : trois enfants, c’était déjà beaucoup. Toi le petit frère que j’avais trouvé si rougeaud, si laid à sa naissance que j’avais menacé du haut de mes cinq ans de te jeter à la poubelle... Toi que nous avions tous couvé, chéri, tremblant d’angoisse à chacune de tes poussées de fièvre.
Le nourrisson chétif pour qui la médecine se montrait si pessimiste était devenu en 1970 un beau gaillard de vingt et un ans bien charpenté, chevelu, barbu qui terminait ses études d’ingénieur à Lyon. Charles et Marie, les aînés, avaient quitté la maison pour fonder leur famille. Nous étions proches, tous les deux. Grâce aux grands, nous avions pu faire des études. Nous partagions les mêmes goûts en matière de cinéma, de musique. Puis l’Éducation nationale nous avait séparés, m’exilant aux cinq cents diables pour mon premier poste. Toi, tu te plaisais à Lyon avec ta bande de copains. Tu revenais à Saint-Etienne un week-end sur deux, quelquefois seulement pour la journée du dimanche, avec ton sac rempli de linge à laver. L’énorme tendresse qui vous unissait, maman et toi, avait du mal à s’exprimer. Vous ne parveniez à échanger que des banalités et tu étais du genre taiseux, ce qui n’arrangeait rien. Mais les liens profonds étaient bien présents, ancrés au fond de chacun de vous.
Un dimanche, tu as débarqué sans crier gare accompagné d’une belle fille blonde au teint clair. « C’est Lotte » as-tu simplement dit à maman qui n’a su que bredouiller : « Bonjour, entrez, asseyez-vous ! » C’était une femme toute simple, maman. Elle n’avait pas eu d’autre horizon que ses quatre enfants à nourrir et habiller, un budget serré à gérer, ses travaux de couture sur sa Singer à pédale, ses soucis après la disparition de papa alors que tu n’avais que douze ans. Jamais beaucoup de temps pour penser à elle.
Elle aurait aimé être prévenue, tout de même, qu’elle aurait une invitée et pas n’importe laquelle. Elle avait l’air de quoi avec son tablier à carreaux qu’elle s’est empressée de faire disparaître ! Heureusement que le dimanche, elle mettait toujours les petits plats dans les grands et passait chez le pâtissier. Lotte est revenue souvent à la maison avec toi. Maman la trouvait gentille, attentionnée ; elle aidait à mettre le couvert, à faire la vaisselle. Au fil des conversations, elle a compris que vous viviez ensemble à Lyon. Elle était heureuse de te voir heureux. Elle souriait avec attendrissement quand elle vous surprenait échangeant un regard tendre ou un baiser.
Les mois ont passé. Tu as obtenu ton diplôme, Lotte le sien. Maman avait préparé un repas fin pour fêter votre succès. Le champagne lui a semblé bien amer et en dépit du soleil de juin, un voile de brume s’est abattu sur le salon lorsque vous lui avez annoncé que vous partiez vous installer à Stuttgart. Lotte se languissait de son pays. Vous n’auriez pas de difficultés à trouver du travail là-bas. Vous lui écririez, viendriez pour les vacances. Notre mère a refoulé son chagrin, s’est réjouie avec vous. C’était votre bonheur qui comptait. Vous avez donné des nouvelles, comme promis. C’était surtout Lotte qui écrivait, une dizaine de lignes sur de jolies cartes postales. Toi, p’tit frère, tu téléphonais, juste quelques minutes pour t’assurer qu’elle allait bien. C’est idiot, on s’aime tous très fort dans la famille mais on n’a jamais su vraiment se parler.
Un an s’est écoulé, les courriers d’Allemagne sont devenus plus rares, plus laconiques. Et puis un soir de novembre, maman a entendu le bruit de la clé dans la serrure. Elle s’est précipitée dans l’entrée. La porte s’est ouverte sur toi, p’tit frère, le regard sombre, le dos voûté. Tu as laissé tomber ton sac de voyage sur le carrelage, tu as embrassé maman sans chaleur et murmuré :
« Lotte et moi, c’est fini ». Tu es resté debout, chancelant, les bras ballants. Sans un mot, elle t’a pris par la main et t‘a conduit dans ta chambre. Tes pantoufles étaient à leur place au pied du lit, elle a sorti un pyjama d’un des tiroirs de la commode et t’a dit : « Repose-toi, mon grand ! » espérant qu’une bonne nuit de sommeil te ferait du bien et qu’il serait bien assez tôt le lendemain pour les explications, si toutefois tu le souhaitais. Le lendemain, tu n’es pas sorti de ta chambre avant une heure de l’après-midi, tu t’es installé à table en face d’elle l’œil noir, le teint blême, tu as mangé comme un automate et tu es retourné t’enfermer dans ton antre. Pendant près de quinze jours, tu as vécu comme un zombie, allongé sur ton lit, les yeux rivés au plafond ou au mur, ne quittant ton refuge que pour grignoter sans appétit, l’esprit ailleurs. Elle ne te posait pas de questions. Elle espérait, guettait à chacune de tes apparitions un signe d’apaisement. Elle comptait sur ta collection de livres, de BD restés sur leurs rayons et qu’en ton absence elle avait continué à épousseter chaque matin. Elle avait conservé tes disques, ton vieil électrophone, ton poste de radio. Elle glissait discrètement Libération, ton journal favori, sur la table de chevet. Il demeurait soigneusement plié, comme à sa sortie de chez le marchand. Elle a fini par bouillir de colère, maman. Trop, c’était trop ! L’indignation lui empourprait les joues lorsqu’elle pensait à Lotte. Une fille sans cœur qui avait bien caché son jeu, une intrigante qui avait séduit son petit, l’avait éloigné de son pays pour le jeter ensuite comme un mouchoir sale. Ah, si elle l’avait eue sous la main, l’Allemande qui avait fait de toi une ombre, une ruine, une, elle lui aurait dit son fait, elle aurait même été capable de l’étrangler !
Elle a déployé des trésors d’autorité dont elle ne se serait pas crue capable pour tenir Charles et Marie à l’écart. Elle leur a tout simplement interdit la porte de la maison. « Le petit a besoin de repos, laissez-le en paix, je vous ferai signe quand il ira mieux, ça ne saurait tarder. »
Mais l’angoisse la gagnait. Elle avait fait ses emplettes de Noël, les cadeaux pour ses petits -enfants surtout. Elle aimait cette fête qui nous réunissait tous autour de la grande table familiale dans la salle à manger décorée par ses soins de guirlandes multicolores, de Pères Noël musicaux dont les gamins raffolaient. Aux anges, elle trônait au milieu de sa nichée, dans sa robe de fête. Une petite robe noire toute simple, qu’elle avait confectionnée elle-même. Il y avait belle lurette que le noir, le gris et le mauve n’étaient plus les couleurs du deuil. Elle l’agrémentait d’un lainage blanc. Elle avait bien été tentée par une veste de couleur vive, pour changer, mais aurait-ce été bien raisonnable à son âge, n’allait-on pas l’accuser de vouloir jouer à la jeunette ? Toi, p’tit frère, tu continuais de te noyer dans tes pensées lugubres, à dépérir et elle, elle commençait à se persuader qu’il n’y aurait pas de fête de Noël à la maison cette année-là, parce qu’elle ne pourrait pas t’imposer cette corvée. Et son cœur saignait à la pensée de la déception des petits, de l’incompréhension et des reproches des grands.
Et puis, il y a eu cet après-midi de mi-décembre où maman se tenait tristement derrière la fenêtre de la cuisine, observant le ciel d’un gris moutonneux, peut-être annonciateur de neige. Son attention a été attirée par une grosse dame qui peinait à ouvrir la portière avant de sa voiture tant elle était encombrée de paquets enrubannés de toutes les tailles. Ensuite, elle a chargé dans le coffre un affreux arbre de Noël synthétique couleur rose fuchsia. Une voix a retenti soudain près de ton oreille : « Elle a dévalisé combien de magasins, celle-là ? » Maman a sursauté : tu étais là, à ses côtés, p’tit frère, enfin sorti de ton refuge, de ton silence. Elle a fait comme si de rien n’était. Ensemble, vous avez regardé la brave dame tentant d’extirper à grand-peine son véhicule de sa place de parking, jusqu’à ce que tu t’exclames, faussement en colère : « Ma parole, elle a eu son permis dans une pochette surprise, c’est qu’elle va me l’emboutir, ma Dyane ! » Vous avez échangé un sourire, le premier depuis bien longtemps. Tu as mis ton bras autour de ses épaules et tu as déclaré d’un ton bien décidé : « Allez, maman, prends ton manteau, il faut qu’on aille acheter le sapin. »
Il ne lui a pas fallu cinq minutes pour s’habiller et se chausser. Il paraît même que vous avez plaisanté dans la voiture. :
Elle a toussé, s’est fait prier, la Dyane, mais elle a bien voulu se mettre en route et vous conduire jusqu’au marché aux sapins près de l’avenue Victor Hugo, comme pour manifester son plaisir d’avoir enfin retrouvé son conducteur.
Les jours qui ont suivi, maman n’a pas eu une minute à elle. Elle a briqué la maison, passé des coups de fil à Charles, à Marie. Elle n’en revenait pas de te voir revivre. Tu piochais dans ta bibliothèque et relisais tes vieilles bandes dessinées, tu mangeais de meilleur appétit, reprenais des couleurs, tu t’attardais à ses côtés le soir devant la télévision.
Le jour de Noël, ils étaient tous là, Charles et sa femme Julie, Marie et son mari Frédéric et les cinq gamins, heureux, réunis autour du sapin qui brillait de mille feux. Maman, rayonnante au milieu de sa couvée – je n’avais pas pu faire le voyage mais j’avais téléphoné, dit un mot à chacun de vous – avait revêtu sa robe noire, celle des grandes occasions, osé une petite veste carmin et ourlé ses lèvres d’un soupçon de rouge. Toi, caché dans les plis du grand manteau de Père Noël, la tête encapuchonnée, d’une grosse voix, tu demandais aux enfants, les petits un peu effrayés, les plus grands gloussant de rire, s’ils avaient été bien sages toute l’année. Pendant que Charles commençait à déboucher la bouteille de côtes du Rhône, maman essuyait discrètement une larme derrière ses lunettes. Toi, je jurerais que tu en as laissé couler une jusqu’à ta grosse barbe de coton hydrophile dissimulant ta barbiche brune. Tu t’en souviens de ce moment-là, dis, p’tit frère ? 9 commentaires
9 commentaires
-
Par Barman le 17 Mai 2016 à 10:39
Un automne sanglant
Stéphanie Fleury
Ma nouvelle se passe dans la région où je suis née et où j'ai passé toute mon enfance. À gambader en sauvageonne, comme Manon des sources, entre les torrents et les alpages. Je l'ai quittée à contrecœur par obligation, mais c'est toujours avec beaucoup de tendresse et d'émotion que je me la rappelle.
Écrire cette nouvelle m'a permis d'évoquer avec vous, mes montagnes et ce village qui me manquent tant. Tout est prétexte à me rappeler cette région et j'espère juste, malgré la noirceur de ma nouvelle, vous donner envie d'aller faire un tour dans les Hautes-Alpes !!!
* * *
Cette année-là, l’automne est venu très tôt. Il s’est mis à pleuvoir dès le début du mois de septembre et les jours de grisaille succédaient aux jours de grisaille…
Avant de vous relater les événements effroyables qui se sont déroulés, il me faut tout d’abord vous planter un peu le décor.
Je vis dans un village de 800 âmes, au fin fond des Hautes-Alpes. Un bourg paisible, accroché depuis le moyen-âge à un éperon rocheux, qui domine un torrent impétueux, dont le nom est associé à la vallée qui l’entoure.
Il y a une école primaire et un collège, une petite épicerie et une boulangerie qui fait encore son pain au feu de bois. La rue principale, bordée d’arbres, traverse le village d’un bout à l’autre et sur la place de la fontaine, on trouve trois cafés avec chacun sa clientèle. Le café du commerce pour les touristes de passage, qui descendent de l’autocar effectuant la liaison Marseille/Briançon, le café des sports pour les vieux et le café des Pignes, qui accueille les jeunes. Inutile de vous dire que tout le monde se connaît ici. C’est bien cela qui a été terrible dans toute cette histoire… Le fait que tout le monde se connaisse et que parmi nous rôde le mal, pendant des semaines, sous les traits d’un visage familier et ami, répandant ainsi la peur et la méfiance parmi tous les habitants de notre vallée.
Mais venons-en aux événements.
Cette année-là donc, l’automne était à son apogée. Les mélèzes avaient pris une teinte sanglante qui se répandait dans toute la montagne environnante. Oserais-je dire que c’était magnifique, cette couleur pourpre, si violente, si présente autour de nous ? Cette couleur éclatante nous enveloppait, nous poursuivait, nous obsédait vraiment. Cela a-t-il donné envie à quelqu’un d’en répandre un peu plus dans les ruelles sombres de notre village ?
Le fait est qu’un matin, la boulangère a réveillé toute la rue par ses hurlements hystériques. En allant récupérer la poubelle de la ville, déposée la veille dans la venelle contigüe à sa boutique, elle a découvert à côté, le cadavre d’une femme, portant des traces noirâtres autour du cou, prostré, recroquevillé et baignant dans son sang. Elle l’a identifiée sur-le-champ, grâce à ses longs cheveux roux.
Il s’agissait de Marie Peuzin, une jeune femme de 23 ans, née au pays et qui travaillait comme coiffeuse dans la grande ville d’à côté.
Les gendarmes sont arrivés très vite, mais nous étions déjà tous sur les lieux, encore sous le choc et ne pouvant pas vraiment associer ce corps lardé de coups de couteau, raidi et ensanglanté, à notre jolie Marie, si pétillante, si pleine de vie… Qui donc avait pu faire une chose pareille ? Un monstre de passage sûrement… Car l’idée ne nous serait pas venue que l’un d’entre nous puisse commettre un crime aussi abject et aussi éloigné de la petite vie paisible que nous menions tous, jusqu’alors.
Aucun indice, aucune empreinte, ne furent retrouvés sur les lieux.
Il faut dire aussi que nous avions tous pas mal piétiné les alentours, avant l’arrivée des gendarmes…
L’enquête commença et tout doucement, la vie reprit son cours. On enterra la pauvre Marie et l’on essaya d’oublier. Dehors, les jours diminuaient et la nuit tombait de plus en plus tôt. Le crime était malgré tout, dans les pensées de chacun et les femmes se hâtaient de regagner leurs domiciles après le travail, en jetant des regards terrifiés sur les ténèbres qui les engloutissaient peu à peu.Le temps s’y est mis lui aussi. Dès la tombée de la nuit, la lune était voilée par les nuages et il faisait si sombre que les portes des maisons se fermaient à double tour et que l’on tremblait à l’intérieur, malgré la chaleur apportée par les poêles rougeoyants.
Une dizaine de jours s’était écoulée, quand un matin, Garcin, le facteur qui se rendait quotidiennement à la poste très tôt pour faire son tri, aperçut dans la lueur de ses phares une masse informe qui gisait sur la route, à l’entrée du village. Stoppant son véhicule en croyant qu’il s’agissait d’un simple animal renversé par une voiture, il découvrit avec horreur le cadavre d’une femme.
Cette fois, c’était Lison Cayolle, la fille des habitants des Roussières. Une belle plante de 18 ans, qui aidait ses parents à la ferme et qui n’avait que des amis. Elle gisait là, gorge ouverte d’une oreille à l’autre, la plaie formant, comme un épouvantable sourire rouge sur son pauvre visage mutilé.
Le malheureux Garcin en fut tellement choqué, qu’on dût l’arrêter pour 8 jours !
Choqué comme nous tous, d’ailleurs. Car à présent, ce n’était plus le crime isolé d’un rôdeur de passage… L’assassin avait encore frappé. Lison était une fille méfiante et de nature plutôt timorée, qui n’aurait certainement jamais suivi un inconnu. Je crois que ce jour-là, sa mort a mis le village devant une vérité crue : la bête immonde vivait peut-être parmi nous !Les gens ont commencé à se regarder de travers. On n’avait plus confiance en personne. Chacun épiait l’autre derrière ses volets. On avait peur de tout et de rien. L’on sursautait au moindre bruit et l’on se disait juste que « Monsieur tout le monde » pouvait bien être cette bête…
Quand l’hiver est arrivé en plongeant dans les ténèbres impénétrables, toute la vallée,
la série macabre a continué…Il y a eu Sophie, la fille de la mercière, retrouvée sur la place du village, le corps lardé de coups de couteau, puis Isabelle des Ginestes, une brave fille, dont le cadavre gisait près de l’ancienne usine de brique et découverte par un chasseur, au hasard de sa balade. Et encore Rosine, la fille Pinero, du bureau de tabac, si douce, si aimable derrière son comptoir, abandonnée toute mutilée au pied du pont de pierre qui enjambe le torrent au cœur du village. Cinq pauvres vies arrachées avec une brutalité inouïe. Cinq jeunes femmes attachantes dont la disparition prématurée nous a si cruellement marqués…
Pendant tout ce temps-là, l’enquête piétinait… Les gendarmes avaient beau faire, le mystère restait entier. La recherche de l’ADN n’existait pas encore à cette époque et les indices laissés près des corps, étaient inexistants. Ces femmes moururent les unes après les autres et c’était comme une fatalité contre laquelle, on ne pouvait rien faire…
À la fin de l’hiver, Pierre le boulanger nous a quittés lui aussi. Il était en pleine dépression et s’est pendu dans l’appentis, juste derrière la boulangerie. Estelle, sa femme a continué vaille que vaille à faire tourner la boutique avec son fils Gabriel, qui a fait le pain comme son père, puisqu’il avait passé toute son enfance à le regarder travailler les fougasses, au feu de bois.
Au printemps de cette année terrible, les meurtres se sont arrêtés. Les jours ont rallongé et le soleil est revenu, éloignant les heures sombres de notre vallée et réchauffant les âmes transies.
Je suis vieille à présent et si toute cette histoire m’est revenue avec une telle précision aujourd’hui, c’est parce qu’Estelle, la boulangère est morte cette semaine. Son fils Gabriel, en fouillant dans la boite à souvenirs de sa mère, a découvert une lettre de plusieurs pages, écrite par Pierre, son mari, juste avant son suicide.Une confession terrible, relatant soigneusement les meurtres de Marie, Lison, Sophie, Isabelle et Rosine. Écrite de la main d’un homme désespéré, dont la folie l’avait conduit à faire des choses épouvantables. Lui, l’homme ordinaire, le boulanger jovial, le partenaire idéal à la belote ou à la pétanque, l’ami fidèle au cœur généreux, qui vous dépannait dès qu’il le pouvait, le mari aimant et le père attentionné. Lui, que l’on croisait chaque jour au café du commerce où il avait ses petites habitudes, et qui vous saluait avec un grand sourire, avait sombré un soir d’octobre, devant la beauté d’une jeune fille, dont la jeunesse lui rappelait si fort que le temps passe trop vite. Il l’avait attrapée dans la venelle, cette jeunesse et il lui avait tordu le cou une bonne fois, avant de la larder de coups de couteau. Et il avait ressenti un plaisir immense, en sentant la vie fuir entre ses doigts. Un plaisir si vif, si violent, que cela lui avait donné envie de recommencer encore et encore. C’était devenu une véritable obsession, un besoin qui lui rongeait l’âme et l’empêchait de penser à autre chose. Il avait épié, suivi chacune de ces filles, avec l’excitation du prédateur sur les traces de ses futures victimes. Il avait soigneusement préparé chacun de ses crimes et dans un éclair de lucidité, par peur du scandale peut-être, ou pour préserver sa famille, qui sait, il avait simplement mis fin à ses jours pour arrêter la bête immonde qui grossissait en lui et qu’il ne pouvait plus contrôler désormais. Estelle, la boulangère avait découvert ce journal à la mort de Pierre. Honteuse ou se sentant coupable de n’avoir pas pu empêcher ces horreurs, ou tout simplement de n’avoir pas su voir le vrai visage de celui qui partageait son lit depuis plus de 30 ans, elle avait préféré garder pour elle le terrible secret et enfoui simplement le journal dans sa boite à souvenirs, comme pour emprisonner le passé.
Puis elle avait continué à vivre avec ça, vendant son pain chaque jour, en souriant de manière mécanique, voulant à tout prix protéger du scandale son Gabriel chéri.
Aujourd’hui c’est l’automne, et les mélèzes ont pris leur teinte sanglante. Depuis plusieurs jours déjà, une partie de la montagne est presque pourpre… Et même si les vieilles, comme moi, ressassent encore cette histoire, la jeunesse insouciante, elle, mène sa barque. La place de la fontaine grouille de monde, car c’est jour de marché, et les éclats de rire s’envolent dans le ciel pur et montent jusqu’à ma fenêtre. L’automne sanglant est définitivement derrière nous.
 4 commentaires
4 commentaires
-
Par Barman le 8 Mai 2016 à 14:27
Le recueil des treize nouvelles primées à la 14e édition du concours Calipso sera disponible à partir de mercredi 11 mai 2016. Les auteurs primés en recevront un exemplaire ainsi que les personnes ayant contribué en 2015 à l'appel à dons à hauteur de 25 euros.
Pour les personnes qui souhaiteraient commander un ou plusieurs exemplaires de ce recueil, (8€ + 2€ de frais de port à l'ordre de Calipso), merci de le faire au cours de cette semaine, car le café sera fermé du 17 mai au 5 juin 2016.
Les nouvelles étoilées et reçues au café seront programmées pour être publiées au cours de cette période. Merci à leurs auteurs.
 1 commentaire
1 commentaire
-
Par Barman le 2 Mai 2016 à 09:49
Recueil des nouvelles primées pour la 14e édition de Nouvelles en fête. Disponible le 13 mai 2016 auprès de l'association Calipso, 94 pages, 8 € + 2€ de participation aux frais de port (les auteurs primés en recevront automatiquement un exemplaire ; également les personnes qui ont contribué à hauteur de 25 euros à l'appel à dons en 2015).
 votre commentaire
votre commentaire
-
-
Par Barman le 20 Avril 2016 à 08:47
Pour cette quatorzième édition du concours Calipso, quatre-vingt-dix-neuf nouvelles étaient en compétition. Une belle participation pour un thème dont on nous a souvent dit qu'il était difficile. En sus des treize nouvelles sélectionnées, quatorze ont été étoilées par le jury dans une première sélection comme quoi de nombreux auteurs ont été inspirés. Les nouvelles recalées ne sont pas pour autant sans qualité, elles n'ont peut-être tout simplement pas eu la force d'emporter l'adhésion de ce jury. Aussi, nous encourageons leurs auteurs à les présenter dans d'autres concours, s'ils satisfont à la thématique bien entendu.
Les étoilés de cette 14e édition et par ordre alphabétique d'auteur :
Danielle Akakpo pour P’tit frère
Maryvonne Brasme pour Passage à l’acte
Benoît Camus pour Bâton Rouge
Claudine Créac’h pour Une berceuse
Stéphanie Fleury pour Un automne sanglant
Martine Gengoux pour d’Eux
Roland Goeller pour Alice
Jean Gualbert pour Voyageur du néant
Michèle Labbre pour Le baiser du papillon
Annie Pellet pour Les P’tits cœurs
Jean-Christophe Perriau pour Carton rouge !
Pierre Pirotton pour La Voisine
Ludmilla Safyane pour Intermezzo
Marie-Claude Viano pour Un lundi sans Lune
Comme chaque année, nous proposons aux auteurs étoilés de les retrouver au café, histoire de ne pas limiter au seul recueil les regards et les sensibilités qui se sont exprimés à l’occasion du concours. Nous les invitons, s’ils le souhaitent, à nous envoyer par mail leur texte, accompagné d’une courte présentation.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Barman le 17 Avril 2016 à 18:00
Le jury du concours de nouvelles Calipso a le plaisir de vous présenter le palmarès de la quatorzième édition :
1 - Emmanuelle Cart-Tanneur pour « Sens interdits »
2 - Éric Gohier pour « Longue, longue route »
3 - Françoise Bouchet pour « Phoenix »
4 - Marie Pontacq pour « Dunkerque, juste avant la nuit »
5 - Jean-François Vielle pour « Game over »
5 - Jacques Capelle pour « Une nuit extraordinaire »
7 – Catherine Pin pour « Vin de noix »
8 – Jean-Marie Cuvilliez pour « Venise la Rouge »
9 – Anne-Céline Dartevel pour « Soixante-neuf battements par minute »
10 – Dominique Guérin pour « L’écho des sables d’antan »
10 – Véronique Viala pour « Cristallisasong »
12 – Laurence Marconi pour « Le colis »
13 – Mémoire du Temps pour « La gloire de Rayo »
Dans quelques jours nous vous proposerons de découvrir les étoilés de la première sélection ; leurs auteurs seront bien sûr invités comme chaque année à nous transmettre leurs textes s’ils souhaitent une publication au café.Encore toutes nos félicitations aux lauréats, aux étoilés et à tous les participants de cette quatorzième édition.
 13 commentaires
13 commentaires
-
Par Barman le 16 Avril 2016 à 16:00
Sans commentaires, voici les nouvelles sélectionnées pour la 14e édition du concours Calipso. Comme presque chaque année, ce sont 13 nouvelles plutôt que 12 qui ont été retenues. Le classement est par ordre alphabétique de titre. Nous vous donnons rendez-vous demain dimanche 17 avril 2016 pour le palmarès.
Cristallisasong
Dunkerque, juste avant la nuit
Game over
La gloire de Rayo
L’écho des sables d’antan
Le colis
Longue, longue route
Phoenix
Sens interdits
Soixante-neuf battements par minute
Une nuit extraordinaire
Venise la Rouge
Vin de noix
Merci aux auteurs qui se reconnaitront dans cette liste de prévoir de nous envoyer très rapidement leur texte afin de pouvoir préparer l’édition du recueil et qu’il soit disponible pour Nouvelles en fête le 14 mai 2016 au Fontanil.
Nous publierons en début de semaine prochaine la liste des nouvelles étoilées qui pourront être publiées sur le site si leurs auteurs le souhaitent.
 4 commentaires
4 commentaires Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Café littéraire, philosophique et sociologique