-

Ce soir, nous accueillons Annie Mullenbach-Nigay, une poétesse talentueuse qui a écrit un recueil de poèmes inspirés d’un voyage en automne, dans la Belle Province.
Calipso fête son 400e numéro, le Québec fête son 400e anniversaire…Un poème sur la Belle Province où l’on couvrait les ponts de bois qui, l’hiver, n’auraient pas résisté au poids de la neige. Ainsi dans le film : Sur la route de Madison…
(extrait de " La Belle Province voyage au Pays d’en face ")
Pont couvertIls avaient rendez-vous
Sur le pont
Sous le pont
On ne sait plus très bien
Ils sont venus pourtant
Leurs pas ont résonné
Sur les travées de bois
Leur ombre s’est découpée
A travers les croisées
Sur quelle route ensuite
Se sont-ils égarés
Lui
Elle
Sur quelle route
Elle
Lui
 7 commentaires
7 commentaires
-
Pour la quatre centième de Calipso, Yvonne Le Meur-Rollet nous propose ce soir une chanson poétique, pleine de tendresse et de nostalgie, qui a été mise en musique par Jean Deschamps.

Dans la rue des Drapiers
Ils se sont promenés
Comme le premier soir
Dans la rue mal pavée
Mais n’ont pas retrouvé
Le porche lisse et noir
De leurs baisers mouillés
Dans la Rue des Drapiers.
Elle a voulu quand même
S’accrocher à son bras
Elle a vu dans ses yeux
Monter une étincelle
Elle a cru que pour elle
Se ranimait le feu
Dans la Rue des Drapiers.
Mais près de la margelle
En haut de l’escalier
S’avançait une fille
Aux cheveux caramel
Anneau d’or au nombril
Fin tricot de dentelle
Dans la Rue des Drapiers.
Tous deux ont aperçu
Leur reflet dans la glace
Et ils ont entrevu
Le poids du temps qui passe
Qui essouffle les cœurs
Et fait traîner les pieds
Dans la Rue des Drapiers.
Ils se sont promenés
Comme le premier soir
Dans la rue mal pavée
Mais n’ont pas retrouvé
Le porche lisse et noir
De leurs baisers mouillés
Dans la Rue des Drapiers.
 9 commentaires
9 commentaires
-
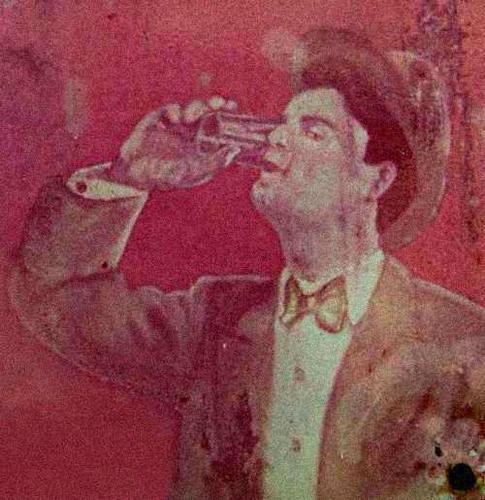
Aujord’hui, c’est un capitaine qui n’en est pas à sa première traversée qui a jeté l’encre sur le papier, pour nous parler de la Calipso. Il l’aperçoit, de temps à autre, quand il repose son stylo, et il se joint à nous pour trinquer à la santé du navire et lever haut son verre sous les étoiles.
Calipso
Gamin, quand on évoquait devant moi la Calipso, je songeais avant tout à ce rafiot du tonnerre de Dieu et à son capitaine – un petit marin à bonnet rouge, dont la voix singulière traînait d’une mer à l’autre, chaque dimanche après-midi – qui recherchait sous toutes les latitudes l’épatante compagnie des requins-marteaux et des tortues marines… Un peu plus tard, à cette même évocation, je n’en avais que pour Ulysse. Une histoire d’île et de passion fatale… Moi qui ne suis pas foutu d’inventer une excuse valable quand j’arrive avec cinq minutes de retard à la maison, j’ai toujours eu de l’affection pour les heureux veinards qui ont la science du bobard…Aujourd’hui, c’est autre chose. Quand on me dit Calipso, je me dis qu’il y a sans doute un peu des deux. Qu’on tient là une arche – à bord de laquelle ne sont grimpés que des gibiers à plume – qui poursuit sans faiblir une bien belle odyssée…
Je la vois passer, de temps à autre. Elle traverse à belle allure mes eaux territoriales, frôle – un brin enjôleuse – mon port d’attache. Toutes voiles dehors. Le vent qui la pousse en avant est de bonne composition et les matelots, pour ce que j’en sais, ont le cœur à l’ouvrage. C’est plutôt bon signe, par les temps qui courent. Quant à moi, j’en profite, à ma façon.
Et voilà qu’aujourd’hui, on m’annonce qu’elle affiche ses quatre cent coups. Il me semble bien que ça s’arrose…
C’est la première fois que je monte à bord mais je ne suis que de passage. On ne peut pas être de tous les voyages. Mais si d’aventure vous croisez dans mes parages, vous devriez sans trop de mal m’apercevoir. Je serai dans un troquet du port, à trinquer à votre belle santé. Et si vous tendez l’oreille, vous devriez même m’entendre vous souhaiter bonne chance…
Alain Emery
 16 commentaires
16 commentaires
-

Marielle Taillandier aime les cafés et la chaleur humaine que l’on peut y trouver. Elle aime le bois verni des tables et les chaises de bistro, les petits gâteaux de boulanger que l’on s’échange dès que le garçon a le dos tourné, les confidences au-dessus d’une tasse de chocolat (elle ne boit aucun alcool, même pas en rêve), les rires retenus, les projets de se revoir dès que possible. Elle aime les autres au point de les rassembler, dans un lieu choisi par elle, lorsque l’automne se met au gris. Elle aime tout cela, sans distinction. Elle sait bien qu’en Novembre, à Paris, les cafés sont des soleils où venir se chauffer.
Marielle Taillandier fait partie de ces auteurs généreux qui n’ont pas recours aux effets de manche pour nous parler des choses de la vie. En quelques phrases authentiques, ils nous émeuvent, et nous bouleversent.
De nos jours, ces auteurs-là ne sont pas si nombreux.
C’est avec elle que nous entrons ce soir au café.
Verveine Menthe
Elle m’a suivie quelques minutes plus tard et s’est assise en face de moi, portant un cabas à provisions rempli et bien trop lourd pour elle. Petite, frêle, la tête enroulée d’un foulard représentant les monuments de Paris, elle a pris son temps pour s’installer en poussant des petits " pfff ! " de soulagement en posant enfin son sac. Son imper élimé plié soigneusement sur la chaise, elle a dénoué son foulard qu’elle a enfoui dans son sac à main. Puis elle m’a souri, toute heureuse d’avoir capté mon attention, et son visage ridé s’est illuminé comme une vitrine de Noël. Je venais de commander un thé à la russe bien chaud avec des cookies lorsqu’elle appela le garçon pour demander une verveine menthe. Visiblement, nous avions besoin toutes deux de nous réchauffer.
Nous nous sommes regardées, elle tout sourire, moi un peu timide. Je ne sais que trop ce que signifient ces sourires d’approche de la part des vieilles dames : ce sont des appels au secours, des harpons plantés dans les cœurs. Son sourire à elle traquait le mien qu’elle semblait supplier de rester accroché et de ne pas l’abandonner. Les vieilles dames tentent leur chance auprès d’inconnues comme moi qu’elles savent disponibles et peut-être aussi seules qu’elles. Je parie même qu’elle m’avait repérée avant d’entrer, proie facile que j’étais avec mon regard vide et, entre deux doigts, un cookie grignoté du bout des dents.
Une main posée sur la tasse brûlante de sa verveine, remuant de l’autre le sucre qui s’y noyait, elle eut vite fait d’engager une conversation qui ne laissait aucun doute sur sa situation. Les Parisiennes sont souvent des montagnes de souffrances accumulées entre leurs quatre murs, qu’elles viennent déverser en flots douloureux aux inconnues des cafés. On les affuble souvent d’un caniche hargneux et d’un maquillage outrancier mais leur vérité est bien plus cruelle. Les verveines menthe ne sont que des prétextes pour parler, d’ailleurs elle n’a presque pas touché à la sienne, affirmant qu’elle était amère et que ça lui remuait l’estomac. La moitié de sa pension devait passer dans les infusions dont il devait peu lui importer en vérité qu’elles fussent amères puisqu’elle ne les buvait pas. Non, elle m’a regardée longuement avec son sourire d’un rose criard et nous avons parlé, doucement, tâtant le terrain sensible des épanchements puis, oubliant Paris autour de nous et l’ambiance du café aidant, nous nous sommes progressivement confiées, saoulées de souvenirs et de petits secrets qui nous arrachaient des rires pudiques ou des oh ! d’incrédulité. Elle s’appelait Marthe et avait été artiste de music hall de strass et de lumières qui avaient laissé des éclats dans son regard noisette. Amoureuse d’un homme beau comme un dieu, qui était aussi son partenaire, tous les deux avaient usé les scènes des cabarets de France et vécu de leur passion. J’imaginais les photos de cette époque tapissant les murs de son appartement, soigneusement conservées dans des cadres dorés entre les souvenirs de tournées et les programmes des premières dédicacés. Son compagnon avait disparu et les photos devaient avoir jauni tandis qu’elle devait se repasser en boucle le film de leur gloire où les projecteurs les éblouissaient face à un public enthousiaste.
Les heures ont passé, entraînant avec elles le déclin de la faible lumière de novembre. Nous n’avons pas vu la pluie tomber abondamment sur la ville, pas senti la fraîcheur qui s’installait, ni vu la nuit qui recouvrait les trottoirs et allumait les réverbères. Paris se préparait pour une longue soirée d’automne humide et froide et enfilait son pyjama.
Marthe n’a pas bougé de son siège de tout l’après-midi et n’est pas allée aux toilettes ; parfois elle contrôlait son visage dans son miroir de poche, le lissait des deux mains pour retrouver une jeunesse fanée et tenter de me montrer à quoi elle devait ressembler, avant. Une coquetterie datant de l’époque où il fallait entrer en scène avec un maquillage irréprochable. Et la peur au ventre. Le numéro de lancer de couteaux ou celui de la femme tronc, dont elle connaissait les trucs qui font rêver les gens et trembler leurs acteurs.
Vers 19 heures, alors que je regardai ma montre pour tenter d’amorcer un départ, deux types sont entrés dans le café. Ils ont lancé un coup d’œil circulaire dans la salle et, en apercevant mon interlocutrice, se sont approchés tranquillement de nous comme pour ne pas l’effrayer :
" Alors, Madame Laroche, vous nous avez encore fait des niches, aujourd’hui ? On vous cherche depuis des heures…c’est pas bien, vous savez… "
Marthe lui répondit d’un regard brillant de larmes. L’un des infirmiers l’avait prise par le bras pour l’entraîner doucement vers la sortie. Elle n’a manifesté aucune résistance et les a suivis, résignée. Alors que je regardai la scène sans comprendre, elle s’est retournée vers moi en me lançant :
" A demain, ici, à la même heure, revenez demain, je m’échapperai encore et je vous raconterai la suite ! Je vous en prie ! "…
 12 commentaires
12 commentaires
-

Calipso fête aujourd’hui son quatre centième numéro. Ysiad, collaboratrice de la première heure et subtile chroniqueuse a sollicité sa fille et sonné le rappel auprès de quelques compères pour orchestrer l’événement. Le menu des jours à venir s’annonce succulent, alors n’hésitez pas à revenir et à inviter vos amis. Un grand merci aux auteurs et aux lecteurs ; sans leur bienveillante attention et leurs généreux commentaires, le café n’aurait plus de raison d’être.
Nous transformons ce soir le café de Calipso en café-concert, pour accueillir le chansonnier Jean-Claude Touray.
Installez-vous, prenez place, nous larguons les amarres sur les traces d’une baleine assez leste, au large des côtes bretonnes. Ça va sacrément swinguer. My God ! Nous allions oublier Miss Smith. Montez vite, Miss Smith, on vous a gardé une place sur la Calipso. C’est la première fois que vous partez chasser la baleine ? How exciting ! Ah, tenez bien votre cornette, le vent décoiffe pas mal dans la région. Le chapelet, non, vous n’en avez pas nécessairement besoin. Mais oui, on vous traduira, promis. Jean-Claude est bilingue.
Musique, maestro !
La chanson du baleinier
Refrain
Pique pique la baleine, matelot c’est ta chanson.
Pique, nique avec Germaine, pique-nique avec Suzon,
Rien à faire avec Julienne, et bernique avec Lison.
Couplets
La bergère Madelon, pastourelle en bas de laine,
Voulait chasser la baleine, en mer avec les garçons.
Déguisée en moussaillon, toute habillée de futaine,
Ell’ fut engagée sans peine sur un baleinier breton.
Un matin le capitaine la vit debout sur le pont
Nue, couverte de savon, d’une beauté souveraine.
Ventre-Dieu par ma bedaine, quel faux-cul ce moussaillon.
Voilà du filet mignon et de beaux tétons Tontaine.
Derrièr’ le mât d’artimon, derrièr’ le mât de misaine,
Ell’ perdit sa marjolaine, sa jolie fleur en boutons.
Pas avec le capitaine ou le lieut’nant son second
mais avec le marmiton, un beau faiseur de fredaines.
J’ai fait mon éducation, Sainte Mado ma marraine,
J’ veux un’ autre marjolaine, pas encore en floraison.
La sainte fut bien en peine et répondit " Madelon,
Les fill’ perdent leur fleuron, sitôt vu le croqu’ mitaine ".
MoralitéAlors si c’est ça Tontaine, dans la CAL’ IPSO facto
Tous les gars, les matelots, pourront boire à ma fontaine.
Et même le capitaine et le lieut’nant, ce fayot
Pourront voir mes beaux lolos, Sainte Marie Madeleine.
 14 commentaires
14 commentaires
Café littéraire, philosophique et sociologique
































































