-
Par Barman le 14 Février 2013 à 08:00

Tout le monde à table ! (2)
Patrick Ledent
Ils sont arrivés tous à la fois sur le coup de 19 heures. Ça a fait un bouchon jusque sur le trottoir. Le pauvre Bernard observait la scène depuis l’autre côté de la rue. Sa gueule de chien battu m’a réjoui. Il aurait fait pleurer une paire de lunettes en vitrine. Je n’ai pas pu m’empêcher de lui adresser un petit bonjour ironique, tandis que je faisais entrer tout ce beau monde à la queue-leu-leu. Un apéritif offert, une pub dans le journal local, un prétexte bricolé, et tous de répondre présent. Sommes-nous à ce point manipulables ? À quoi pensaient-ils ? N’y croyaient-ils vraiment pas ou cherchaient-ils à vaincre leur trouille en faisant bombance ? Bah ! Quelle importance après tout ? D’un côté comme de l’autre, ils étaient sans noblesse. La vérité ne s’élude pas, elle s’affronte. Savoir mourir, c’est une ultime leçon de savoir-vivre.
Je m’étais impliqué en cuisine. Je voulais que tout fût parfait. Trente-six personnes, menu unique : je pouvais assurer sans aide. J’avais d’ailleurs donné congé à mon assistant. C’était mon idée et j’entendais la servir en toute indépendance.
Ma femme s’activait en salle, comme d’habitude. Elle m’a épaté. Fallait voir la vaisselle sur les tables dressées ! Un petit cercueil pour l’entrée, un plus grand pour le plat de résistance, des fauchons en guise de couteaux et des ciboires en forme de crânes évidés pour le vin. Elle avait trouvé le tout en location sur internet. J’ai apprécié. J’allais devoir mettre les bouchées doubles pour ne pas la décevoir.
Fallait les voir s’esclaffer ! Des gosses ! Chacun soulevait son cercueil et y allait de sa réflexion, de table en table. J’entendis des « c’est mignon » et des « c’est adorable », qui m’auraient fait grimper en mayonnaise si je ne connaissais pas la suite. Parce que tout de même, il était tout sauf mignon, mon restaurant aux allures de caveau. Jusqu’aux tentures que nous avions couvertes de fausses toiles d’araignées ! Il n’y avait vraiment que des demeurés pour trouver ça adorable. Des demeurés ou des lâches, on y revient ! Certaines personnes s’obstinent à ne voir que le bon côté des choses, quitte à les travestir, au mépris de la plus éclatante évidence. Méthode Coué, mon œil ! Méthode couard, ça oui !
à suivre...
 1 commentaire
1 commentaire
-
Par Barman le 13 Février 2013 à 08:00
 Tout le monde à table !Patrick LedentEn pleine saison morte et juste avant les fêtes, c’était une bonne idée. Une occasion de remplir la salle. J’ai envoyé l’annonce au journal local :Vendredi 21 décembre, le restaurant« La Fourchette buissonnière »vous propose son menu spécial« FIN DU MONDE ».Mise en bièreRoulés de jambon fumé aux aspergesGrand-messeMédaillon de veau aux champignons sauvages,gratin de pommes de terre et céleri-raveInhumationBal masqué de fromages sur voile lactéApéritif et pousse-café offerts par la maisonSix heures après la parution, j’étais complet : 36 couverts. Ma femme était ravie et m’a félicité : « Tu aurais dû faire la com., chéri, tu aurais cartonné ».J’avais des dons, c’est vrai. Le pauvre Bernard, mon unique concurrence sérieuse, trottoir d’en face, allait encore se demander pourquoi tant de monde franchissait ma porte et si peu la sienne, quand nos prix et notre cuisine étaient comparables. Et dimanche midi, au bistrot, je lui sortirais une fois de plus :– Tu veux que je te dise la différence entre nous, mon pauvre Bernard ?Il grommellerait comme d’habitude – ce que je prendrais pour un encouragement –, avant de lui balancer une nouvelle fois :– Il ne suffit pas d’être restaurateur, il faut être aussi commerçant. Moi, j’emballe avant de servir, c’est toute la différence !Sauf que dimanche… Tout serait fini, hélas. Oh ! Je voyais bien que personne n’y croyait. Les Mayas, on les prenait pour des clowns. N’empêche, je savais bien, moi, que plus rien ne serait comme avant.Aussi ce dernier repas serait-il mon chant du cygne. Le leur aussi forcément, mais ils feindraient de l’ignorer. Parce qu’ils sont lâches. Que tous les hommes sont lâches. Quand vient la fin, ils se foutent la tête dans le sable en attendant que ça passe. Et ils périssent asphyxiés, même s’il ne s’est rien passé ! « Tiens ! J’aurais dû leur servir de l’autruche, à ces poltrons », ai-je regretté, à part moi.à suivre...
Tout le monde à table !Patrick LedentEn pleine saison morte et juste avant les fêtes, c’était une bonne idée. Une occasion de remplir la salle. J’ai envoyé l’annonce au journal local :Vendredi 21 décembre, le restaurant« La Fourchette buissonnière »vous propose son menu spécial« FIN DU MONDE ».Mise en bièreRoulés de jambon fumé aux aspergesGrand-messeMédaillon de veau aux champignons sauvages,gratin de pommes de terre et céleri-raveInhumationBal masqué de fromages sur voile lactéApéritif et pousse-café offerts par la maisonSix heures après la parution, j’étais complet : 36 couverts. Ma femme était ravie et m’a félicité : « Tu aurais dû faire la com., chéri, tu aurais cartonné ».J’avais des dons, c’est vrai. Le pauvre Bernard, mon unique concurrence sérieuse, trottoir d’en face, allait encore se demander pourquoi tant de monde franchissait ma porte et si peu la sienne, quand nos prix et notre cuisine étaient comparables. Et dimanche midi, au bistrot, je lui sortirais une fois de plus :– Tu veux que je te dise la différence entre nous, mon pauvre Bernard ?Il grommellerait comme d’habitude – ce que je prendrais pour un encouragement –, avant de lui balancer une nouvelle fois :– Il ne suffit pas d’être restaurateur, il faut être aussi commerçant. Moi, j’emballe avant de servir, c’est toute la différence !Sauf que dimanche… Tout serait fini, hélas. Oh ! Je voyais bien que personne n’y croyait. Les Mayas, on les prenait pour des clowns. N’empêche, je savais bien, moi, que plus rien ne serait comme avant.Aussi ce dernier repas serait-il mon chant du cygne. Le leur aussi forcément, mais ils feindraient de l’ignorer. Parce qu’ils sont lâches. Que tous les hommes sont lâches. Quand vient la fin, ils se foutent la tête dans le sable en attendant que ça passe. Et ils périssent asphyxiés, même s’il ne s’est rien passé ! « Tiens ! J’aurais dû leur servir de l’autruche, à ces poltrons », ai-je regretté, à part moi.à suivre... 6 commentaires
6 commentaires
-
Par Barman le 12 Février 2013 à 08:00

Vieux matou (2)
Ysiad
Que c’est fatigant, mon dieu, que c’est fatigant lorsqu’ils se mettent à crier comme ça ! Cette agitation bouleverse ma tranquillité. Et tout ce foin parce que Papa a proposé à la dernière minute à son ami Maurice Leglandu de venir dîner ! Résultat : après sa journée de boulot, Maman est obligée de ressortir sous la pluie pour faire des courses. Papa est allé ouvrir le frigo et il a poussé un gros soupir en constatant qu’il était vide. Enfin voyons, a-t-il dit, c’est pas la fin du monde ! Je peux tout de même inviter Maurice à la maison sans que tu en fasses tout un plat ! Maman a dit que si, justement : quand on invitait des amis, la moindre des choses, c’était de leur faire un plat, et puis comme Maurice était l’ami de Papa, elle se sentait obligée de faire un petit effort. Papa n’avait rien prévu, elle n’allait tout de même pas lui servir les rataillons de fromage qui pourrissent dans un tupperware. Elle est partie en claquant la porte si fort que le radiateur sur lequel j’étais allongé en a tremblé.
Quand Maman est rentrée, elle était trempée de la tête aux pieds. Elle a accroché son manteau au porte manteau en maugréant, elle a posé ses sacs sur la table et elle s’est mise à couper ses fines herbes à grands coups de ciseaux. J’ai sauté du radiateur tiède, c’était l’heure de mes croquettes ; les horaires, c’est sacré, il ne faut pas badiner avec. Je me suis posté devant ma gamelle mais comme Maman avait l’air en colère en battant ses œufs, je me suis retenu de miauler et j’ai pris ma pose de sphinx muet. Elle n’arrêtait pas de répéter qu’elle en avait marre d’être la bonniche de la maison, et qu’elle n’était pas sur terre pour recevoir les amis de Papa au dernier moment, qui se faisaient servir sans bouger le petit doigt. Papa s’est fâché, il a dit à Maman qu’elle exagérait, qu’elle disait tout cela parce qu’elle n’aimait pas Maurice, et il est allé mettre le couvert.
Heureusement, ça embaumait dans la cuisine. J’ai humé l’odeur délicieuse de la ciboulette et de la coriandre, puis je me suis décidé à miauler un peu, pour rappeler à Maman mon existence. En m’entendant, elle s’est arrêtée de couper ses herbes et comme elle sait que je raffole de la ciboulette, elle m’en a donné un brin à mâcher. Tiens, mon Pompon, a-t-elle dit, un petit encas avant les choses sérieuses. J’ai patienté un peu en mâchonnant, mais l’herbe, ça ne nourrit pas son chat. Comme elle continuait à s’affairer, je me suis mis à miauler très fort pour la rappeler à son devoir. Quand c’est pas l’un, c’est l’autre, a dit Maman en remplissant ma gamelle, puis elle est retournée à ses préparatifs.
As-tu pensé au dessert ? a demandé Papa en entrant dans la cuisine. Le gâteau est au four et il est au chocolat, a dit Maman en soupirant. Chouette, a dit Papa pour mettre un peu d’entrain, et il a sorti les verres pour l’apéritif. On propose un kir ? a dit Papa. Parfait, a dit Maman et c’est à ce moment-là que Maurice Leglandu a sonné. Je vais ouvrir, a dit Papa. J’en ai profité pour reprendre ma place sur le radiateur, c’est encore là que je suis le mieux pour piquer un petit roupillon.
Je me suis réveillé quand ils se sont attablés. Maman a posé l’omelette entre eux, et Papa en la voyant a demandé s’il ne fallait pas envisager de la recuire un peu. Comme Maurice ne disait rien, Maman s’est retournée et lui a demandé comment il l’aimait, son omelette, et il a répondu d’une voix prudente que c’était parfait tel quel. Papa et Maman écoutaient Maurice qui parlait très fort en agitant en l’air sa fourchette pleine d’omelette. Comme j’avais encore un petit creux, j’ai quitté mon poste d’observation pour voir ce que je pouvais récupérer. Des petits morceaux d’œufs cuits tombaient autour de la chaise de Maurice qui parlait toujours. Comme personne ne me prêtait attention, je me suis posté sous la fourchette valseuse pour récupérer des miettes volantes, et c’est là que Maman m’a vu. Elle a grommelé qu’au moins, son omelette n’était pas perdue pour tout le monde, et quand Papa a demandé à Maurice s’il avait encore faim, Maman a dit qu’il n’y avait plus d’œufs pour faire une deuxième omelette. Elle a remporté les assiettes en demandant à Papa d’aller en chercher d’autres dans le buffet, pendant que Maurice se curait les dents. Je l’ai suivie jusqu’au frigidaire dans l’espoir qu’elle me donne quelque chose, mais elle m’a dit que c’était trop tôt, que je venais d’être nourri et qu’elle ne voulait pas d’un chat mendiant à la maison. J’ai penché la tête pour lui rouler deux gros yeux réprobateurs, je n’aime pas quand elle me traite de chat mendiant. Elle a déballé un gros fromage crémeux qu’elle a posé sur une assiette pour le porter à table.
Tu aimes le vacherin ? a-t-elle demandé à Maurice, qui a fait une moue polie. Enfin chérie, tu sais bien que Maurice ne mange jamais de fromage ! a dit Papa à Maman sur un ton de reproche. Tu veux un petit-suisse ? a demandé Papa. Maurice a remercié, il a dit qu’il aimait beaucoup les petits-suisses, que c’était une bonne idée. Confiture ou sucre ? a dit Papa. Les deux a dit Maurice, et Papa s’est levé. Moi aussi j’ai un faible pour les petits-suisses, Maman les achète pour Papa, et aussi pour moi quand j’ai été sage. En voyant Maurice en manger six, l’eau m’est montée aux babines. J’ai attendu en espérant qu’un peu de crème coulerait de la cuillère mais comme rien ne s’est passé, je suis retourné me coucher sur le radiateur.
Au moment du dessert, Papa a voulu taquiner Maman qui apportait le gâteau au chocolat sur un plat. Franchement, chérie, ton gâteau, il a pas l’air terrible, on dirait un gros tas de miettes ! a fait Papa. Maurice a ri derrière sa main, il avait l’air de bien s’amuser. Maman, un peu moins. Elle a dit que son gâteau n’avait pas un bel aspect, mais qu’il fallait passer au-dessus des apparences et qu’il serait bon quand même. Elle a même proposé de la crème anglaise avec, et tout le monde était d’accord. Elle en a versé beaucoup à Maurice avec la louche, sans doute pour rattraper les choses, mais au moment de servir Papa, sa main s’est mise à trembler et la crème a coulé sur sa chemise et sur le parquet. Il y avait une petite flaque à côté de la chaise. Mais que tu es maladroite ! a fait Papa furieux, et Maman a ri en me voyant lécher le sol, je n’allais pas rater pareille aubaine. Au moins, elle n’est pas perdue pour tout le monde !, a-t-elle fait.
Papa a continué à discuter avec Maurice pendant que Maman s’affairait à la cuisine. J’ai attendu qu’elle aille se coucher pour la suivre. Voilà un vieux matou heureux, a-t-elle dit en me caressant. J’ai plissé les yeux de dédain et j’ai posé une patte pleine de griffes sur sa main pour qu’elle cesse de me gratter la tête. S’il y a bien une chose que je déteste, c’est quand on m’appelle : vieux matou. La crème n’était pas mal, mais franchement, son gâteau, il ressemblait à un tremblement de terre chinois.
 8 commentaires
8 commentaires
-
Par Barman le 11 Février 2013 à 08:00

Modernité
Alain Créac’h
Monsieur Pierre était tout souriant, heureux de gravir les trois marches de chez Momo et de retrouver Monsieur François à la table des habitués : cinq semaines éloigné des copains par une saleté de grippe. Il n’avait même pas pu débattre de cette sacrée fin du Monde !
- Alors, ça y est, c’est fini ?
- Sûr ! Mais c’était déjà fini avant !
- Avant quoi ?
- Avant la fin !
- Si les choses se finissent avant la fin, comment voulez vous qu’il y en ait une vraie … une fin convenable, je veux dire !
- Vous savez, certaines fins savent se faire discrètes mais elles sont bien présentes, à chaque instant et à tous moments ; elles rôdent… imprécises…
- Si même les fins sont imprécises alors ! Et… comment savoir si on peut recommencer ? Après la fin.
- Bof !
- Vous ne semblez pas croire au « Recommencé »…
- C’est vous qui voyez… moi… Monsieur François laissa sa phrase en suspens.
Monsieur Pierre l’avait pourtant bien sentie, bien imaginée, cette fin ; elle l’avait fait vibrer, espérer. Un grand balayage ! Il était prêt à tout rebâtir, reposer le premier parpaing. Un monde refait, tout neuf, un paradis dont il serait le gardien, dans un beau pavillon ! Sûr, il filtrerait les entrées : normal, faut faire attention quand on recommence ! Mais sans date précise, comment savoir si la fin avait vraiment eu lieu ! Recommencer risquait de ne servir à rien… ou si peu ! Les propos de Monsieur François avaient introduit le doute en lui. Il lui fallait réfléchir. Désarroi !
- Patron ! la même chose !
Monsieur Pierre avait besoin de réflexions et Monsieur François d’arguments, et Dieu sait s’il y en avait dans la réserve du patron : une provende intellectuelle de derrière les fagots ; douze centilitres de douze, dont la générosité baignait de rouge le pied des ballons tous illuminés de l’incandescence d’ampoules haute consommation.
Silence.
Il aspira sa première gorgée de génie polémiste :
- Bon, admettons que la fin ait eu lieu, une fin si subtile que l’on n’ait pu la ressentir… ne serait-ce qu’un tout petit peu…
- Les fins malignes, ça existe : j’en ai rencontrées !
Monsieur François ajusta ses lunettes de professeur, d’écailles et de presbyte. Il avait failli être journaliste, mais un emploi de magasinier avait fait l’affaire jusqu’à la retraite consacrée à l’art de la rhétorique chez Momo :
- Il est vrai que les fins ont toujours eu de grandes et vaines prétentions : le Monde…rien que cela ; laissez moi rire ! Et elles n’en sont pas à leur premier essai… souvenez vous : Nostradamus, la septième heure, etc. … tout cela était public ! Mais…
- Vous pensez à des tests, à une sorte d’entraînement ?
- Oui… et non, Monsieur… peut-être est-elle advenue… effectivement, cette fin… mais peut-être pas… ou si peu… comment savoir ?
- Nous sommes bien vivants…
- Vivants, vivants ; il y a vivants et vivants… l’illusion, Monsieur Pierre, tout n’est qu’illusion !
Monsieur Pierre se sentit perdu, noyé dans les remous de doutes infinis.
Dehors, la fraîcheur du soir, sa belle Mobylette bleue retrouvée, rien n’y fit ; le doute persistait. Comment savoir : fini ou pas fini, telle était la question !
Monsieur Pierre leva la tête pour enfiler son casque ; son regard tomba alors sur la feuille blanche d’un arrêté visé de la préfecture. Il ne l’avait pas remarquée jusqu’à présent : « En raison de l’état de délabrement prononcé et de l’intérêt privé réunis, le dit immeuble, abritant le débit de boisson dit « Chez Momo », ainsi qu’un logement en mauvais état, le tout sur cave voutée, sera livré aux démolisseurs à dater du 21 décembre 2012… blablabla… logements de grand standing… modernité…blabla…
Le 21 : c’était il y a plus d’un mois ! La fin du monde !
Le froid se fit glacial.
Monsieur Pierre reposa son casque sur le porte-bagage et reprit sa place à table. Le patron apporta la bouteille.
Il avait eu raison, Monsieur François, la fin du monde avait été sournoise : une saloperie de fin sur papier timbré !
Ils referaient le monde encore une fois. Bientôt, celui-ci disparaîtrait sous les décombres et la modernité économique. Sûr, ils pourraient se retrouver au Betty’s Bar, si seulement il n’y avait pas cette musique insupportable !
 1 commentaire
1 commentaire
-
Par Barman le 10 Février 2013 à 08:00

Monsieur Cépala
Jacqueline Dewerdt
Mon voisin est déprimé. Un bon vivant, un optimiste comme lui, c’est à n’y pas croire. Pourquoi donc cet homme simple, employé apprécié de tous passe-t-il subitement de l’euphorie à la morosité proche de l’état suicidaire, c’est ce que je m’en vais vous conter.
Mon voisin s’appelle Alexandre, eh oui, ses parents avaient de grandes vues pour lui. Les pauvres, il ne voulut jamais se soumettre à leurs désirs, rien n’y fit, ni leurs imprécations ni leurs menaces. Alexandre n’a jamais eu un tempérament à se faire du souci. Il s’en fit si peu qu’il se retrouva à devoir gagner sa vie sans avoir grand bagage comme on dit. Ni bagage universitaire, ni habileté manuelle particulière. Ses mains se contentaient d’accompagner les beaux discours qu’il tenait à tout propos. La tchatche était son seul savoir-faire. Il était capable de démontrer tout et son contraire dans tous les domaines, en particulier dans ceux dont il ignorait tout. Il faisait douter les plus convaincus, faisait rire la plupart et savait surtout apaiser les conflits. Les ronchons, les mauvais coucheurs, les belliqueux se voyaient réduits à l’état de doux agneaux par la grâce de la parole enjôleuse et convaincante de notre Alexandre. C’est ce qui le sauva.
Au département « Logistique » d’une grande chaîne de restauration libre-service, on sut utiliser au mieux ses qualités. On attendait quelqu’un comme lui au service des réclamations. Ce n’était pas le nom exact de ce service, il y a longtemps que l’on ne nomme plus les choses par leur nom. Toujours est-il que chaque matin, le service Clientèle, puisqu’ainsi on le nomme désormais, reçoit des quatre coins de France une bordée d’injures émanant des gérants furieux d’avoir reçu des filets de sébaste en lieu et place des steaks hachés, des haricots verts alors que ce sont les carottes qui ont été commandées, des glaces au chocolat et non des fraises garriguette. Certes l’un ou l’autre protestataire parvient à rester courtois, mais la répétition quotidienne des erreurs, finit par faire sortir de leurs gonds les mieux éduqués et même les plus soucieux de garder de bonnes relations au sein de l’entreprise.
Et notre brave Alexandre, pendant des années, sut calmer les furies, éteindre les brasiers d’insultes, redonner courage à tous et même se concilier les bonnes grâces des plus coriaces. Dans tous les coins de l’Hexagone, on se surprit à espérer qu’il y aurait au moins une petite erreur de livraison par semaine pour entendre la réplique devenue célèbre :
- Eh bé, ehbé, c’est pas la…c’est pas la fin du monde.
Et Alexandre trouvait vite et bien une solution. On l’appela Monsieur Cépala.
Sa réputation et son surnom dépassaient le cadre de l’entreprise. Ses voisins venaient lui parler avec force détails des malfaçons et des disfonctionnements divers, parfois inventés de toute pièce, rien que pour l’entendre répliquer :
- Ehbé, ehbé, c’est pas la…c’est pas la fin du monde.
Vous comprenez bien qu’en décembre 2012 quand la menace d’une fin du monde programmée pour le 21 courant faisait les beaux jours des radios, des télés, de l’internet et des conversations des dîners, des comptoirs et même des alcôves, Monsieur Cépala fut pris à parti en tant qu’expert. On se moquait de lui, plus ou moins gentiment, mais il tourna les moqueries à son profit et devint une véritable vedette. Cela dura jusqu’à Noël, le temps que l’effervescence autour des tenants et des négateurs se dissolvent dans le foie gras et le champagne, nourritures désormais obligatoires pour célébrer la naissance d’un certain fils de dieu dont Alexandre avait aussi des choses à dire.
Toute cette excitation fut amplifiée par les festivités prévues pour le départ à la retraite de notre héros. Cette perspective le réjouissait. Il en aurait fini avec les camions mal chargés, les contrôles dans les chambres froides, les mécontents de tout poil. Il avait d’autres projets. Il allait rattraper le temps perdu. Il allait étudier. En premier lieu s’intéresser aux prédictions de fin du monde à travers les siècles et pourquoi pas à la civilisation Maya qui avait bien embrouillé tout le monde. Désormais, il attendrait pour parler de maîtriser son sujet.
Las, depuis le premier janvier, Alexandre déprime. Il a commencé par se lever tard. Il a cessé de se raser, de s’habiller. Depuis quelques jours, il ne se lève plus. Connaîtriez-vous un autre Monsieur Cépala pour venir à son secours ?
 5 commentaires
5 commentaires
-
Par Barman le 9 Février 2013 à 08:00
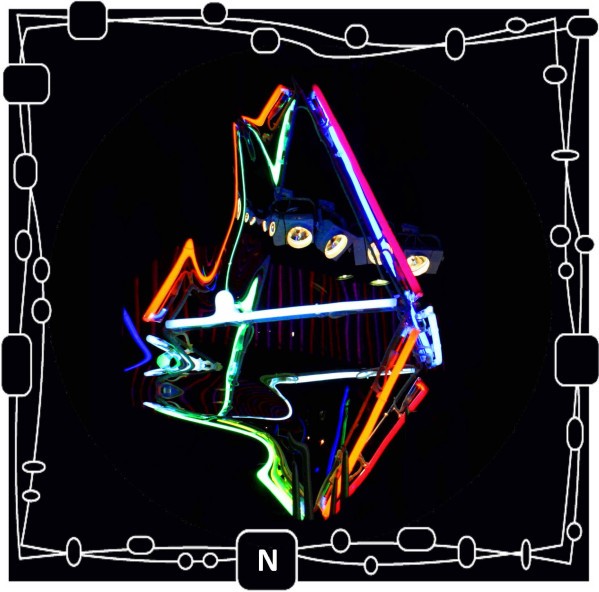
Déboussolé
Emmanuelle Cart-Tanneur
La fin du monde, la fin du monde, on ne parlait plus que de ça... Rien n'était moins sûr, d'ailleurs et CQFD : on est toujours là ! Je le savais bien, moi, que la Terre n'allait pas s'arrêter de tourner ; on nous l'avait même expliqué en long, en large et en travers : elle allait juste changer de sens ! Rapport aux courants magnétiques, tout ça. Je m'y connais, moi ! Enfin, pas en théorie, j'ai jamais été un matheux, mais en pratique, ça oui : je suis fabricant de boussoles. Alors quand j'ai entendu que le Monde allait perdre le Nord, j'ai jubilé, ça oui : de quoi allait-on avoir besoin par millions les jours d'après le bazar ? De boussoles, pardi ! Perdus qu'on allait être entre l'ancien Sud et le nouvel Ouest, on serait bien obligés de venir voir Bibi pour le supplier de céder ses derniers modèles... Moi, dès que j'ai compris ça, ni une ni deux j'ai engagé un plan d'action, comme ils disent. J'ai embauché quatre gars à plein temps : trois ont lancé une production massive, quatre cents unités à la journée, y'avait de quoi satisfaire aux premières demandes qui arriveraient, et le quatrième, je l'ai mis à la remise à jour, en anticipant bien sûr : on disait que les pôles allaient s'inverser, alors mon gars, il tournait les cadrans et les aiguilles de tout le stock qui me restait de cent-quatre-vingt degrés en sens opposé, pour que ça colle. J'avais pris un neuneu, qui s'est demandé dix minutes pourquoi je lui faisais faire ça, vu qu'après, on avait des boussoles qui avaient perdu le Nord, mais je lui ai dit de ne pas se poser de questions et ça a eu l'air de lui aller. Moi je me frottais les mains de voir les caisses qui se remplissaient dans la réserve, et on allait voir ce qu'on allait voir quand le jour J arriverait.
Il est arrivé. Et mazette, c'est pas du tout ce que j'avais espéré !
Ils se sont inversés, les pôles, ça oui... mais personne n'est venu m'acheter de boussoles, parce que tout est tellement sens dessus dessous qu'on a tous plus la tête à comprendre comment on va vivre dans ce monde à la renverse que de savoir où sont maintenant les points cardinaux ! Ils avaient raison, ces fadas de Mayas : le Sud est passé au Nord, et réciproquement... En une nuit, on n'a pas eu le temps de dire ouf que c'était fait. Tout le monde dormait, pensez ils ont fait ça en douce ! Tout juste si on a ressenti un ralentissement, comme quand un train freine pour éviter un bestiau, et c'est reparti... mais dans l'autre sens ! Et on n'y a vu que du feu – jusqu'à ce qu'on réalise l'inversion ! Je me disais aussi, trente degrés en décembre, y'a un truc qui va pas. Et ces touristes qui débarquaient dans mon jardin en paréo... C'est quand j'ai vu ce koala pendu au peuplier que j'ai compris : voilà que Valenciennes, maintenant, c'était dans le Sud !
Je peux bien le dire, le soleil, la chaleur, ça m'a pas réussi. Je suis tombé en dépression. Je passe mes journées sur ma terrasse plein Sud toujours à l'ombre à compter et recompter mes boussoles, pendant que ma femme prend des cours de surf à Dunkerque et apprend à cuisiner les ignames qui ont poussé dans le jardin.
Tout ça parce qu'une bande d'illuminés qui grillaient au soleil du Mexique a décidé un jour que ce serait chacun son tour. De quoi je me mêle ?!
 8 commentaires
8 commentaires
-
Par Barman le 8 Février 2013 à 08:00

Celui qui trouve les vaches
Castor Tillon
La violence du choc m’avait envoyée sur le cul deux mètres plus loin, la bouche grande ouverte, la robe relevée jusqu’à la limite de la décence. Des particules lumineuses dansaient devant mes yeux, tandis que les documents que je tenais à la main avant l’impact retombaient gracieusement dans la flaque d’eau où trempaient déjà mes quartiers arrière.
Quelques instants avant, je déboulais au galop de derrière le kiosque. La toute nouvelle photocopieuse high-tech venait de nous faire une crise, suivie de près par celle du directeur. Il était fou de rage, et avait balayé d’un revers mon paquet de pop-corn king size, heureusement presque vide. Puis menacé de m’expédier à Singapour pour le service après-vente dans le même carton que la putain de bécane si je ne lui copiais pas immédiatement à la boutique d’en bas la demi-douzaine de dossiers urgents de la journée.
L’homme qui m’avait renversée se tenait devant moi, un peu chancelant, visiblement désespéré par sa maladresse. Je suis petite, moins d’un mètre soixante, et la rencontre avec ce grand type m’avait vraiment sonnée. Il s’était accroupi, m’avait pris les mains, et demandé si j’allais bien. Un sosie de l’acteur indien Shahrukh Khan, en plus jeune, et en plus grand. Il m’avait relevée très doucement, et insisté pour m’offrir un remontant au café en face. J’étais pressée, et l’avais envoyé promener plutôt grossièrement, mais il avait un air tellement penaud en ramassant mes photocopies, que j’avais fini par accepter un rendez-vous en fin d’après-midi, après le boulot.
Il s’appelle Govind. Il m’expliqua ce fameux soir que son prénom était un nom de Krishna, et qu’il signifiait « le berger », ou encore « celui qui trouve les vaches ». Après avoir éclaté de rire en même temps, nous avons passé dans ce bistrot les trois heures suivantes à nous raconter notre vie, à glousser, et à mettre à mal le stock de cacahuètes.
En fait, nous bossions dans le même immeuble moderne, moi comme secrétaire pour les cadres de Bova & cow, une boîte de viandes/expéditions/frigorifiques, lui comme garçon de bureau pour le panel de notaires du douzième étage. J’avais d’ailleurs eu affaire à l’un d’eux lors du décès de ma mère, deux mois auparavant.
Govind est un garçon d’une délicatesse et d’une tendresse extraordinaires. Il a cette façon, quand nous sommes assis, de faire couler mes cheveux entre ses doigts, puis de remonter doucement ma robe sur mes cuisses en souriant, et de poser ses lèvres derrière le lobe de mon oreille… Bon sang, ça me rend folle ! C’est pendant un de ces moments intimes et délicieux qu’il m’a avoué, en me lorgnant comiquement comme un gamin qui va prendre une beigne, que notre rencontre n’était pas tout-à-fait fortuite. Il était tombé amoureux de moi depuis un moment, et son ami qui tenait le kiosque à journaux l’appelait sur son portable quand j’apparaissais dans les environs. Je lui ai alors demandé si le fait de me culbuter dans la rue plutôt que dans un plumard faisait partie des techniques de drague traditionnelles indiennes. Ça l’a fait hurler de rire, et il m’a expliqué, entre deux hoquets, qu’il m’avait perdue de vue, et s’était mis à courir pour essayer de me retrouver. Je lui ai promis d’aller casser la figure à son crétin de copain à la première occasion, et de prendre mon journal à la maison de la presse, désormais. Il m’a assuré, en dégrafant mon soutien-gorge, que j’avais raison, que son ami avait été très vilain, et que tout compte fait, il ne lui était plus d’aucune utilité depuis que nous étions ensemble.
Govind fait partie de la rarissime catégorie des gens qui donnent, il ne demande jamais rien, il ne m’a jamais laissé payer un restaurant ou une consommation. Jamais je n’ai eu un petit ami aussi désintéressé, et ça me touche profondément. Après trois mois de bonheur intense, nous avons décidé de changer d’air, de ficher le camp dans un autre pays. Entre-temps, mon bel amant s’était installé chez moi, le loyer de son logement étant hors de prix. Il aurait aimé partir en Inde, où vit une partie de sa famille, mais je n’étais pas d’accord. New-Delhi, pour moi, aurait été un exil.
Il m’a alors proposé une alternative géniale : Maurice, l’île de France. Un petit paradis dont la population est à large majorité indienne, où l’on peut parler français, où la nature et la mer sont omniprésentes. Un de ses oncles installé là-bas nous a envoyé quelques photos, dont celles de la ravissante église rouge et blanche du Cap Malheureux, et d’une petite maison avec varangue en vente dans les environs, pas loin de la mer. Un peu plus de cinquante mille euros que ma mère m’avait laissés et les maigres économies de Govind allaient nous permettre de partir sans trop de problèmes. Cet argent, de toute façon, était destiné aux voyages dont je rêvais depuis toujours.
Le premier jour de notre nouvelle vie est finalement arrivé. Les meubles ont été vendus, ne reste que l’indispensable pour moi. Mon aventurier va partir en éclaireur pour les derniers travaux et aménagements. Comme son modèle bollywoodien, il est très romantique, et il tient absolument à ce que notre petite maison soit un cocon. Qu’elle soit dotée d’une cuisine aux couleurs vives, et d’une chambrette moelleuse avec… eh bien, en fait, c’est tout ce qu’il nous faut pour le moment, n’est-ce pas ?
Je devrais pouvoir le rejoindre dans deux petites semaines. Avant de monter dans le taxi, il m’a serrée dans ses bras, et a déposé à la commissure de mes lèvres un baiser léger comme un colibri.
Trois semaines ont passé. Mon ordinateur portable est ouvert devant moi. Les yeux au plafond, je pioche machinalement dans le sachet de chips.
La boîte de réception de ma messagerie est vide, et le téléphone de Govind ne répond pas. Je ne sais pas trop comment faire pour les communications internationales… J’aimerais bien qu’il me donne des nouvelles. J’ai donné ma démission au bureau, et pour l’argent, ça va être juste.
Maintenant que l’appartement est veuf de tous ses meubles et de la multitude d’éléments qui lui donnaient son caractère, il a l’air de ce qu’il est : un galetas. Le papier peint pisseux révèle toutes ses déchirures, ses plaies exsudant le nitre, et la trace fantôme des tableaux et photos qui recouvraient sa misère.
Contre le mur, quelques cartons crasseux remplis des derniers objets, la plupart venant de maman. Un fatras hétéroclite qui restera probablement là encore longtemps. De vénérables albums photos vides aux pages collées, des vieilles cassettes vidéo, un ancien moulin à légumes en alu. Des merdes, quoi. D’un tas hirsute de fils électriques emmêlés émerge la tête de mon vieux Chonchon, avec son oreille décousue et sa fourrure pelée par l’âge et les câlins. L’ours le plus fidèle du monde.
La journée ayant achevé de se traîner, je suis allée faire une rapide toilette. Même le miroir a un air morne qui me pétrifie. Il me renvoie mon faciès blanc et rond, mes petits yeux enfoncés dans la graisse, mes longs cheveux noirs qui font ressortir les pâles bourrelets de mon cou.
Je vais aller à mon ordinateur, consulter une dernière fois la boîte de déception .
Tirer Chonchon de son exil et essayer de répartir mes quatre-vingt-sept kilos sur le vieux canapé en serrant mon ours dans mes bras.
Et dormir.
 14 commentaires
14 commentaires
-
Par Barman le 7 Février 2013 à 08:00

Vieux matou
Ysiad
Ils m’ont bien bassiné les oreilles avec leur fin du monde. On ne parlait plus que de ça à la maison. A la fin, ça devenait vraiment pénible. Si pénible que le jour J, j’ai décidé de dormir toute la journée, pour leur montrer que moi, la fin du monde, franchement, je m’en brossais les babines. Maman n’arrêtait pas de répéter : « S’il y en a un qui n’a pas peur de la fin du monde, c’est bien lui ! Regarde le ! Tout le temps en train de roupiller sur ses oreillers ! » C’est sans doute pour fêter la fin du monde que Papa et Maman ont décidé d’inviter Madame Larombière à dîner. Comme dit Maman, inviter Madame Larombière, ça peut pas faire de mal à la carrière de Papa !
Avant l’arrivée de Madame Larombière, Maman était très nerveuse. Elle n’arrêtait pas de me lancer : Et toi, tu te tiens à carreau, s’il te plaît. Tu ne viens pas nous déranger, tu restes bien tranquille dans ton coin ! » Papa a suggéré que l’on m’enferme, mais Maman a dit que c’était une très mauvaise idée, que je ne le supporterais pas, et qu’il faudrait s’attendre à des représailles. Maman me connaît bien, elle sait de quoi je suis capable quand je suis contrarié. Il n’a plus été question de m’enfermer, seulement de me verser une double ration de croquettes pour que je me tienne tranquille.
Quand Madame Larombière est arrivée, j’ai tout de suite compris que nous avions affaire à une personne très antipathique. Je les repère, les ennemis de la famille, j’ai un flair infaillible. Elle n’avait pas que des bonnes intentions, Madame Larombière, ça non ! Je me suis glissé sous le lit en attendant qu’elle s’en aille. Quand j’ai entendu qu’ils discutaient, je me suis coulé derrière la porte du salon pour les épier. Madame Larombière était assise sur un fauteuil en face de Papa, et elle pinçait la bouche d’un air dégoûté. Elle s’est mise à éplucher mon coussin préféré. Ne me dites pas que vous avez un chat ! elle a fait d’une voix sèche. Maman a rougi. Elle a incliné la tête. Elle a parlé à mon propos d’un vieux matou inoffensif qui passait son temps à dormir sur ses coussins. J’ai failli en avaler mes moustaches. C’était un peu fort. J’ai fait mes griffes cinq fois de suite sur le tour du sommier, je m’en suis passé l’envie, ils allaient voir de quoi le vieux matou était encore capable.
Puis ils ont commencé à dîner. Maman avait fait du poisson, ça embaumait dans toute la maison. Elle en avait fait tomber un gros morceau dans ma gamelle, mais elle m’avait tellement vexé avec son « vieux matou », que j’ai refusé d’y toucher tout de suite. Je voulais qu’elle me croie malade, elle avait bien mérité de se faire du souci pour moi. Je me suis approché à pattes de velours et je me suis planqué sous le buffet. Papa se penchait sans arrêt vers Madame Larombière, qui mangeait du bout des lèvres. Elle triait dans son assiette pour voir s’il n’y avait rien de suspect, et je voyais bien que ça agaçait Maman, qui passe son temps à faire la chasse aux arêtes quand elle me donne du poisson. Je me suis un peu assoupi, le temps qu’ils passent à la suite, et comme Madame Larombière s’est servi une copieuse portion de camembert en disant qu’elle était « très fromage », j’ai attendu encore un peu jusqu’au dessert.
Maman avait acheté un gâteau à la framboise avec de la crème autour. J’adore la crème, parfois Maman m’en donne à lécher à la petite cuillère. Quand tout le monde a été servi, j’ai fait comme à la maison, après tout j’étais chez moi, et ce n’est pas une Madame Larombière qui va me détourner de mes bonnes habitudes. J’ai bondi sur la table et je me suis mis à lécher les bords du gâteau qui était posé à côté d’elle. Madame Larombière a poussé un cri strident en faisant mine de s’évanouir, Papa s’est levé et a fait le geste de me chasser. Allez ouste ! Hors d’ici ! il a hurlé d’une très grosse voix, alors qu’il me fait des mimis et des grat-grat menton quand nous sommes en tête à tête. Je me suis mis en boule, j’ai feulé le plus fort possible, pour faire peur à Madame Larombière, fffffff ! et j’ai déguerpi.
Quand Madame Larombière est partie, Maman est venue me chercher sous le lit. Boude pas, mon Pompon, a fait Maman. Elle est partie, la méchante sorcière. J’ai risqué une moustache, j’aime bien quand Maman m’appelle son Pompon. Je suis sorti de ma cachette, j’ai sauté sur la table et j’ai lapé très fort l’eau du vase en éclaboussant la table. Après quoi, j’ai joué à pique-babines contre les aiguilles de pin du bouquet, j’ai mordillé les feuilles, j’y suis allé à fond les griffes sur mon griffoir ergonomique, il y avait du carton partout, je me suis roulé dessus comme un gros léopard, et comme Maman me tendait ma gamelle pleine de poisson, j’ai consenti à m’approcher en étirant une cuisse. Ces émotions m’avaient mis en appétit. Tu en veux encore mon Pompon ? Tiens, mon Pompon ! Du rab ! Je me suis régalé. Ensuite j’ai pris toute la place sur le lit, et j’ai dormi entre eux d’une traite jusqu’au matin.
Moi, je dis que ça devrait être tous les jours la fin du monde.
 5 commentaires
5 commentaires
-
Par Barman le 6 Février 2013 à 08:00

Bis repetita
Benoit Camus
Tu attends. Trois quarts d’heure que t’es là, à taper la semelle devant le hall de l’immeuble. T’en peux plus. T’as froid. T’es en sueur. Qu’est-ce qu’il fout ? Tu tournes en rond, tu voudrais qu’il arrive. Je vais clamser, te dis-tu. T’as la nausée. Mal au bide. Ça te démange. Faut qu’il rapplique. Te file la came. T’en as besoin. Juste un fix. Dans ton bras crevassé. Rien qu’un taquet et laisser glisser. Oui, laisser glisser. Tu le hais. Le détestes. Mais il te la faut. Et tu lui refuseras rien. Il te la faut et il l’a.
Ça y est ! Tu le vois. Il se pointe. Il t’a repéré. Tu lui souris. Il est ton sauveur. Il l’a et il s’approche. Tu le rejoins. Te colles contre lui. « T’en as ? » Il te repousse. Te réclame l’argent. Tu l’alignes. Il t’en réclame plus. Tu allonges. T’as tout prévu. T’es content. T’es un malin. Il te dit que t’es un malin. Tu confirmes. T’es un malin, t’es fier de toi. Tu le regardes. Il prend son temps. Joue avec toi. Tu le supplies : « donne-la moi ! » Il ricane. « T’es pressé ? » « Non, enfin si… » Tu insistes. « Donne-la moi ! » Et tu t’agrippes à sa manche. « Allez, s’te plaît ! » Tu chiales presque. C’est trop dur. « Me touche pas ! » Il se dégage. Il recule. Tu le débectes. Il t’a assez vu. N’a plus qu’une envie, que tu t’effaces. Alors, il sort de son blouson le képa. Ton petit képa. Te le sert. Tu trembles. Tu exultes. Le bonheur ! Le récupères et t’arraches. Sans te retourner. « À bientôt, ma gagneuse ! » Il se marre derrière ton dos. Tu t’en fous. Tu l’as. Au creux de ta paume. Ton petit képa. La poudre. Elle est à toi. Elle est pour toi. Et tu perds plus une seconde.
Tu l’emportes dans le local poubelle. La poses sur le couvercle d’un bac à ordures. Et retrousses ta manche. Bon dieu, elle est à toi. Tu sors ta vieille pompe de ta poche. Et tu ris. Tu ris parce qu’elle est là, que dans quelques secondes, tu la sentiras dans tes veines. Tu la dissous. La charges dans la seringue. La dose. Et une bonne. Tu tends ton bras gauche. Un petit nœud autour. Cadeau ! Tu serres. Tu regardes pas ton bras, t’as pas envie de savoir ; tu te contentes de shooter. Tu lâches. Le rush. Elle coule. Le flash. La fin du monde. Une de plus.
 10 commentaires
10 commentaires
-
Par Barman le 5 Février 2013 à 08:00

Fin d’un monde
Claude Romashov
J’ai d’abord senti le silence.
Le monde a retenu son souffle.
Le ciel s’est obscurci de cendre
Le brasier a enflammé la planète.
La douleur m’a arraché la peau.
Mes bras ont imploré les dieux,
Dérisoires lambeaux d’existence
Face au danger, au nuage suffocant.
Les puissants du monde se sont terrés
Dans leurs bunkers, dans leurs abris
Les charniers fumaient à ciel ouvert.
Et brûlaient l’écorce tendre des arbres !
Le sol pétri par les griffes de mort
Exhalait son magma putride,
Ses eaux bouillonnantes d’acides,
Tuaient des mers alanguies et vides.
Ces jours, d’après l’apocalypse
Au soleil crevé de fumerolles,
Ces jours maudits
Ont dévalé des montagnes.
Et sous les pierres qui ravinaient
Les pentes du temps,
J’ai entendu le hurlement de la terre.
 6 commentaires
6 commentaires Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Café littéraire, philosophique et sociologique


































































