-
Par Barman le 2 Novembre 2012 à 08:00

Dimanche dernier, nous annoncions la fin de l'édition 2012 du concours Calipso avec la publication au café de la nouvelle Nous n'irons plus au bois d'Emmanuelle Cart-Tanneur ; sauf que, on le sait bien, rien ne se termine jamais tout à fait et il y a chaque année une petite voix qui vient rappeler nos échanges épistolaires et nous prier de remettre le couvert. C'est bien volontiers et avec nos excuses que nous ouvrons à nouveau la porte 2012 pour accueillir :
Michaël Parent, l'étoile du jour
L'échange
L'équilibre était ajusté par les transferts d'énergies. Cela avait toujours marché, parce que les sièges étaient permutables. Il n'y avait qu'à transvaser pour que tout se déroule avec justesse et cela, ils le devaient à l'échange. Grâce à lui, ils étaient automatiquement habillés de la peau de l'autre, tel un animal écorché dont ils se seraient vêtus. Mais il n’y avait aucun mal, la pratique de ce genre de scalp s’apparentait à une imagerie mentale, une sorte de découpe et de pénétration du cerveau. Ils s’échangeaient leurs vêtements, louaient leur pathos et tous disaient de tous « lui je l’ai dans la peau ». Ils permutaient, ils s'échangeaient pour raccorder tous les fils. Pour raccorder tous les fils dans les fils. Le « je » n'existait pas, ni aucune forme d'égocentrisme, parce qu’ils coupaient et rebattaient continuellement les cartes. Ils redistribuaient le jeu. Ils disaient « on » et ils savaient les liens de dépendances réciproques. Ils savaient que les choses ne tenaient qu'à un fil, ce que les Erectus n'avaient su protégé naturellement. Les Bonobos n'avaient pas besoin de police ou de loi pour canaliser les instincts. Ils permutaient et cela suffisait. C'était comme si la horde était faite de vrais jumeaux dupliqués indéfiniment, si l'un riait, les autres étaient pris d'un fou rire, si l'un pleurait les autres se lamentaient avec lui, si l'un jouissait, ils jouissaient aussi. Les choses étaient si bien réglées que lorsqu'un Bonobo éjaculait, tous perdaient de leur semence. Le sexe était une chose sacrée, le point optimum de leur don d'empathie, à tel point qu'ils ignoraient la masturbation. Le sexe échangiste avait toujours été de soi et ils ignoraient la jalousie. Ils ignoraient la jalousie comme l'envie qui étaient à l'origine de bien des conflits chez les Erectus. Cette espèce était conquérante, elle respirait pour posséder et exhiber ce qu'elle détenait sous le nez de l'autre, pour le narguer derrière une clôture électrifiée. La séparation et l'interdiction de pénétrer sur une propriété privée animaient les instincts guerriers. Il y avait deux mondes, celui du bois et celui des clairières bétonnées. Les Bonobos n'avaient aucun chef, ils ne s'inscrivaient dans aucun modèle patriarcal ni dans aucun modèle de servitude. La hiérarchie et le capitalisme n'existaient pas parce que les objets rares étaient le symptôme du monde des clairières bétonnées. Les objets rares étaient une invention des Erectus, ces peines à jouir. Ils s'étaient redressés, mais à force de porter des ceintures ils étaient restés en berne. Maintenant l’excitation était mécanique. Ils étaient automatisés, le matin ils avaient une érection. Les Bonobos savaient la chance qu'ils avaient de n'avoir pu observer l'horizon. Du moins ils le présentaient, même s'ils n'en avaient clairement conscience. Ils n'étaient jamais redescendus définitivement des arbres et ils marchaient à quatre pattes dans les hautes herbes pour se cacher des prédateurs. Les Erectus avaient cru développer leur cerveau en se redressant. Ils avaient cru découvrir l'ère du calcul en découvrant l'horizon lointain et en fixant leur place dans l'univers, d'un doigt astrologique porté au ciel. Ils avaient cru possible de prévoir les saisons, de tenir un calendrier, de faire des prévisions en cultivant la terre. Ils avaient cultivé la terre et ils s’étaient également imaginés, pouvoir semer dans leur esprit. Les Erectus se parlaient, mais en vérité ils entraient en collision et dès qu'ils pensaient trouver des points de concours, ils rencontraient des conflits d'intérêts et ils s'illusionnaient. En fait, il n'y avait jamais possibilité de consensus parce qu'ils avaient inventé la singularité. Tous proclamaient leur identité, ils s'étaient donné des noms et il faut dire que l'apport de la parole n'arrangea pas leur affaire. Les Bonobos observaient avec curiosité leurs cousins tenter de reproduire leur pensée avec des sons articulés. Ils les regarder montrer du doigt les choses, puis les nommer et cela avait fini par leur donner trop de certitude. Cela avait fini par leur donner une assurance, une assise sémantique qui les trompait sans qu'ils aient le souvenir originel d'une telle duperie. La parole était un tour de passe-passe et certains d'entre eux avaient même fini par chanter. Le larynx poussé à son paroxysme les amena à devenir maîtres-chanteurs. On dit souvent d'un animal intelligent qu'il ne lui manque que la parole, mais chez les Erectus, il est manifeste que cela a apporté l'incompréhension. La situation devint absurde. La mutation du larynx aboutit à des dialogues de sourds, parce que chacun voulait imposer son point de vue. Ils appelaient cela de la philosophie, d’ailleurs ils disaient vivre avec une certaine philosophie, mais il n’y avait qu’un lapin tiré du chapeau. Ils avaient l’art de la poudre aux yeux. Les Erectus capturèrent des Bonobos, allant jusqu’à regrouper des familles entières qu’ils enfermèrent dans des cages de verre. Ils purent ainsi étudier leurs comportements sociaux et ils observèrent leurs cousins derrière du verre securit, en tentant de capturer la familiarité de leur regard. C’était comme s’ils découvraient les yeux qui leur offraient l’éclairage qu’ils cherchaient. La familiarité était saisissante et les Erectus voyaient dans la pupille des Bonobos, la manière du comportement. Ils s’y voyaient à un âge plus ancien où l’ère primitive montrait du doigt l’illusion du progrès. Les Erectus disaient vouloir apprendre des grands singes, parce qu’ils cherchaient le mécanisme qui les mit en porte à faux. À travers leur regard ils tentèrent de comprendre à la source ce qui avec le temps, put les mettre en opposition. Ils observent un gorille et sa famille dans un environnement reconstitué. L’objet d’étude était en quelque sorte inversé parce qu’il y avait une geôle dans l’esprit des Erectus, des barreaux qu’ils ne parvenaient pas à limer. Ils étaient spirituellement prisonniers de leur perception et de leur conscience. Ils ne savaient plus verser la moindre larme, parce qu'en découvrant la parole, ils oublièrent que tout était ineffable. Ils oublièrent que le sentiment allait par-delà la raison, qu'il était incompressible. Quand les Erectus pleuraient, c'est que le temps de la parole était terminé et généralement ils s'abstenaient de tout commentaire. Tout était dit, mais rien n'était exprimé. Ils pleuraient parce qu'ils ressentaient certaines forces psychiques les accabler, mais elles ne concernaient jamais les autres. C'était toujours d'eux- mêmes dont il était question. Ils s'apitoyaient et se causaient du tort les uns les autres, parce que l'important était que l'autre souffre encore plus. Ils ne savaient en sortir grandis que de cette manière. Les Bonobos n'avaient pas rencontré la parole comme on rencontre une créature mythologique, peut-être parce qu'ils étaient toujours retournés dans les arbres. Les Erectus se dispersèrent et mirent de la distance entre eux. Du moins, ils avaient instauré une ligne invisible d'inviolabilité que tous se devaient de respecter. Mais la parole avait permis certaines insultes plus blessantes que n'importe quel coup de poignard et la volonté d'extermination avait pris le dessus. Au lieu de quoi, les Bonobos avaient découvert l'échange. Ils avaient remarqué que l'infiniment grand était enfermé dans l'infiniment petit, alors ils n'avaient pas cherché à aller au-delà. Les Erectus s'acharnaient à défraîchir, déforester mais les Bonobos savaient qu'il y avait toujours un arbre pour cacher la forêt. Les Erectus avaient voulu conquérir le monde, les Bonobos s'étaient bornés à leur territoire. Ils avaient sanglé tout ça parce qu'ils savaient la conquête illusoire, ce qui permis la télépathie, la communication immédiate, quelle que soit d'ailleurs, la distance qui pouvait les séparer. La pensée était instantanée et une et tous n'étaient que des manifestations formelles du modèle unique. Il n'y avait pas de distance chez les Bonobos, ils communiquaient avec des hordes dans tous les endroits de la Terre et avec tous les êtres vivants. Cela passait par les ondes et les mondes restaient connectés. Les mondes étaient reliés, le vivant l'était. Il n'y avait pas d'impossibilité dans le voyage, le voyage était ubiquité. Il était mental la plupart du temps et tout à coup la matière devenait incertaine. Le lubrifiant télépathique avait permis l'échange et le pathos s'était dilaté comme le cosmos à son origine. Il avait fini par tout englober. Les Erectus observaient les étoiles avec un télescope, les Bonobos le regardaient avec un kaléidoscope. Les uns d’un observatoire, les autres depuis la cime d’un arbre. Les Bonobos inventaient ce qu'ils voyaient et grâce à l'empathie le jeu de cartes était constamment rebattu. Il n'y avait plus aucun siège. Il n'y avait plus aucun trône, plus aucun trophée et les egos perdirent tout à coup de leur consistance. Ils devinrent creux comme un animal empaillé. Les consciences n'avaient aucun siège proprement dit, seulement le temps éphémère d'un trajet, si bien qu'il ne resta que les multiples facettes d'un ordre cosmique qu'il était vain de vouloir comprendre. Les Bonobos étaient les numéros des branches d'un même arbre, parce qu'ils savaient être reliés et ne cherchaient jamais à s'excommunier. Ils appartenaient à la combinaison d'un code. Chacun d'eux était un organe et leur énergie était si fantastique, du fait de leur association. Le milieu associatif dans lequel ils baignaient avait gardé en mémoire son origine intriquée, si bien que la distance qui les séparait n'était pas significative. Ils avaient transféré leur âme en changeant d’enveloppe, ce qui leur avait permis de se voir avec les yeux de l’autre et c’était ce qui importait. L’essentiel était qu’ils permutent parce que le tourniquet ne s’arrêtait pas de tourner. Ils avaient ainsi délocalisé leur conscience, réalisant que leur nombril n’était que le leurre d’une séparation prétendue définitive. En vérité, le cordon ombilical était un fragment de cordon généalogique et le cordon généalogique était un lien qui remontait aux organismes unicellulaires, lequel remontait une chaîne dont le brouillard devenait toujours plus épais. Ils convinrent ainsi qu’ils pouvaient caresser les émotions et vivre pleinement dès lors qu’ils ne cherchaient pas à se situer, dès lors qu’ils ne cherchaient pas à établir de rapports, aussi bien que d’agencer des mots ensemble. Accrocher les wagons de l’arbitraire à la queue leu leu pour former un train de marchandises qui donnerait du sens leur apparut insensé. Lorsqu’ils s’étaient observés, séparés par du ver securit, les Bonobos avaient trouvé les Erectus trop cérébraux et aujourd’hui ils étaient prisonniers des mots. Aujourd’hui ils ne savaient plus penser sans eux. Il y avait un train de marchandises sémantique interminable qui passait dans leur esprit et ils ne savaient plus sentir. Leur odorat s’était terni. Ils ne pistaient plus rien, plus rien ne les flattait. Les Erectus se croyaient fantaisistes avec l’apparition de la culture et ils ne voyaient pas qu’ils étaient de grossiers copistes. Ils avaient seulement trouvé le moyen de passer le monde sous le photocopieur et en vérité ils ne trouvaient jamais les originaux. Mais eux se croyaient originaux. Ils pensaient produire, mais ils reproduisaient et ils répétaient tels des perroquets depuis qu’ils avaient pris la parole. Ils répétaient et mimaient grâce à leur larynx, l’environnement qui les précédait avant qu’ils nomment ses composantes. Ce qui était déjà là avant qu’ils aient eu le malheur de montrer du doigt les pierres, les arbres, les animaux, le soleil, le ciel, la mer, les montagnes. La parole était falsification et la duperie leur avait échappé. La duperie de l’Erectus analyste. Les Bonobos se concertèrent et ils décidèrent du recours. Le recours à la permutation. Jusqu’à présent, ils n’avaient pas tenté de se connecter sur les sièges Erectus, parce qu’ils avaient estimé que c’était leur choix. Mais il y avait un déséquilibre du vivant, les isoloirs plaçaient les Erectus dans une posture de résistance et cela les rendaient amers. Ils étaient désabusés. Il n’y avait qu’une méthode qui pouvait les éclairer, la télépathie et les Bonobos allaient devoir se brancher sur leur cerveau. Ce cerveau reptilien qui faisait du monde, un terrain où il y avait des zones d’attaque et de défense. Ils voulaient cesser ce match mortel, où les perdants étaient décapités. L’échange serait une expérience nouvelle pour eux, du moins elle réveillerait ce souvenir originel qui précédait la prise de parole. L’aventure télépathique éveillerait leur pathos et ils découvriraient en eux, un entendement complètement réhabilité, reconfiguré. Depuis qu’ils avaient pris la parole, ils pensaient grâce à un dialogue muet intrinsèque entre eux et eux même, mais maintenant les choses seraient différentes. Les Bonobos allaient injecter à leurs cousins Erectus, de la pensée pure, du pathos purgé de toute parole, pour qu’enfin ils sachent l’irréductibilité du pur contact. Ils découvriraient la véritable palpation du sentiment, de la sensation et la corruption linguistique serait endiguée. Les Bonobos prendraient la tête des Erectus entre leurs mains, ils les fixeraient dans les yeux et l’étau pathologique se chargerait du transfert. Ils ne pourraient se dérober. Ils sauraient qu’il ne faut pas expliquer, justifier, commander, contrôler, mais laisser faire. Ils ne se raconteront plus d’histoires et ils remarqueront qu’il n’existe que de l’ineffable. Ils remarqueront l’arbre qui cache la forêt et ils inscriront l’infiniment grand dans l’infiniment petit. Les Bonobos sortirent du bois et allèrent à la rencontre des Erectus qui occupaient les clairières bétonnées. La conversion était inéluctable.
 2 commentaires
2 commentaires
-
Par Barman le 28 Octobre 2012 à 09:00

Avec cette nouvelle étoilée d' Emmanuelle Cart-Tanneur se termine l'édition 2012 du concours Calipso. Toute l'équipe de l'association et les membres du jury tiennent à remercier les auteurs qui ont tenté l'aventure et adressent leurs chaleureuses félicitations aux treize lauréats ainsi qu'aux étoilés qui ont bien voulu présenter leurs nouvelles au café.
Nous n'irons plus au Bois.
Ma chère Mathilde,
Quand vous lirez cette lettre, je serai loin ; très loin. Et vous serez surprise d'apprendre ce que je vais vous révéler et qui vous montrera à quel point le destin est fragile, à quel point la vie est précieuse, et à quel point vous êtes passée tout près de la mort. Car il me faut à présent sortir du bois, et passer à ces aveux que j'ai jusque-là différés.
Rappelez-vous cette promenade dans les allées du Bois de Boulogne ; je vous y avais priée, en ces premiers jours du mois de février, afin, avais-je prétendu, de vous permettre de vous changer les idées et de chasser de vos pensées cette mélancolie qui vous avait prise à la fin de l'été. Vous n'aviez paru que peu étonnée du fait que je fusse au courant de vos états d'âme, et je ne m'en étais que peu expliqué ; tout se sait très vite dans un milieu fermé – et Dieu sait si celui auquel nous appartenions l'était ! Vous n'en faisiez pas mystère par ailleurs, et j'avoue même m'être demandé si vous n'en aviez pas joué – mais cela m'importe peu à présent.
Vous vous complaisiez dans cette langueur morbide depuis, disait-on, que votre fiancé avait rompu ses engagements, décidant du jour au lendemain de vous préférer l'appel de l'inconnu en partant tenter sa chance outre-Atlantique. Vous vous êtes retrouvée abandonnée et furieusement vexée, avouez-le, de n'avoir pas su l'emporter sur un goût de l'aventure somme toute fort commun chez les jeunes gens bien nés comme l'était votre Frédéric, issu comme tous ses cousins et ses frères du même élevage normalisateur incapable de produire d'autres modèles que de jeunes garçons brimés et avides de la moindre sensation de liberté ; vous avez été une victime indirecte de cette éducation qui, reconnaissez-le pourtant, ne vous aurait fourni qu'un piètre époux en matière de fantaisie.
C'est là que je suis intervenu ; je n'avais ni nom ni fortune, mais vos parents, vous voyant si neurasthénique de jour en jour, ont consenti à relâcher leurs exigences en termes de fréquentations pour me permettre de vous rendre visite.
Je me suis présenté comme un ancien ami de Frédéric, camarade désargenté que la bonté de votre fiancé avait sauvé de la délinquance. Loin de déplaire à vos parents, cette soudaine évocation des qualités de leur ex-futur gendre m'a ouvert les portes de leur salon – et de votre chambre. Apparemment sa fuite transatlantique ne l'avait pas pour autant privé, dans leur esprit, de la possibilité de vous revenir un jour. Ils restaient dans l'expectative, et pour le moment n'étaient soucieux que d'une chose : votre vague-à-l'âme. Aussi m'ont-ils invité chez eux – et chez vous – sans faire la moindre manière, dès lors que j'ai eu évoqué mon amitié avec Frédéric : peut-être ont-ils alors pensé que parler de lui avec moi vous ferait du bien.
Dieu sait si j'ai été étonné de leur imprudence, et de la facilité avec laquelle j'avais réussi à vous approcher !
Je crois que je me dois d'être maintenant sincère avec vous : je n'avais, en approchant votre famille, pas la moindre intention charitable, pas plus que le moindre désir de vous faire l'aumône d'une promenade thérapeutique ou d'une conversation de salon. J'ai toujours haï les riches, les rupins, les millionnaires, les nantis, les gens comme vous et les vôtres, et comme votre Frédéric, cet abruti mythomane qui s'est imaginé pouvoir illuminer les États-Unis de l'éclat de son simple nom associé à un minable projet commercial financé par les économies de ses parents décatis. J'ai joui, je l'avoue, de la vision de vos parents, désespérés par votre état, inquiets au plus haut point du devenir de la santé mentale de leur fille unique, pressentant avec effroi l'ombre de la mort par neurasthénie se pencher sur son pâle visage… Allons ! On ne meurt plus par amour de nos jours, chère demoiselle ! Vous avez trop lu Flaubert ! Vous n'avez pas su, pas vu, parce que vous étiez bien trop préoccupée, centrée, obsédée par votre prétendue douleur – qui n'était que blessure d'amour-propre ! que je ne me sentais nullement affligé par vos vapeurs ou compatissant à vos soupirs. Je sais, je suis bon comédien ; on me le dit souvent. Cette fois-là, cela m'a été utile, je le reconnais.
Mais je m'éloigne de mon sujet. Reprenons.
Rappelez-vous, donc, cette promenade au Bois. Il faisait froid et vous portiez cette étole de vison qui vous avait été offerte, m'avez-vous confié dans un reniflement ridicule, par Frédéric l'hiver précédent. J'ai essuyé une larme à vos yeux de mon index et vos yeux de biche ont risiblement papilloté à mon intention. Belle fidélité au souvenir de votre amant ! J'ai feint de ne rien en apercevoir et vous ai offert mon bras pour vous conduire tranquillement le long des allées.
Nous avons causé quelques heures en cheminant. Vous avez causé, devrais-je dire, tant vous m'avez semblé encline à vous épancher, ne me laissant guère la possibilité de parler moi-même ; mais cela m'a convenu, éludant mon souci de devoir me composer un personnage si éloigné du mien, de même que l'obligation de chanter les louanges de cet abruti de Frédéric. Vous-même n'en avez d'ailleurs que peu parlé au demeurant, ce qui n'a pas laissé de m'étonner. Vous m'avez semblé faire finalement la part des choses, d'une façon que l'on n'aurait pas soupçonnée en vous voyant soupirer à son simple nom, comme vous le faisiez chez vous depuis des mois ! Était-ce donc un calcul ? Une feinte ? Je n'ai pas réussi à en savoir davantage et, ceci dit, je n'y tenais pas, puisque l'objet de mon dessein était ailleurs.
Nos pas nous ont conduits, vous en souvenez-vous ? Au ponton de location des barques. Vous avez frémi lorsque je vous ai proposé une promenade sur le lac. Vous m'avez avoué que vous ne saviez pas nager, et j'ai répliqué en riant que vous n'aviez besoin que de savoir vous tenir assise et me regarder ramer ! Vous avez finalement accepté de vous laisser emmener, et je vous ai aidé à embarquer, d'un pas mal assuré, mais dont la confiance manifeste m'a touché plus que je n'aurais cru.
Je dois faire un effort, je vous l'avoue, pour revivre en pensée ces premiers moments que nous avons passés ensemble sur l'eau ; ils sont pour moi à la fois pénibles et doux à ma mémoire.
Vous ne sembliez pas avoir peur ; vous regardiez autour de vous comme une enfant étonnée, et de temps à autre vos yeux revenaient vers moi, qui ramait en face de vous. Vous ne parliez plus. De loin en loin, je vous observais, et constatais que votre mélancolie encore si proche n'était plus que souvenir, si elle n’avait jamais été sincère. Vous m'avez soudain paru simple, douce, si éloignée de ces apparences qui régissent votre façon de vivre que j'ai dû me reprendre pour me rappeler qui vous étiez vraiment.
L'éclat métallique des eaux glacées reflétait les branches nues des platanes dégarnis, et le bruit régulier de mes rames était le seul qui parvenait à nos oreilles ; nous étions seuls en ce coin du lac invisible à tous.
C'est le moment que j'attendais. J'ai déposé les rames et vous ai regardée.
Et vous, vous m'avez souri, avec dans les yeux un éclat de joie qui m'a aussitôt foudroyé.
Vous n'avez pas compris pourquoi j'ai alors fondu en larmes.
J'ai repris mes rames, et nous avons rejoint la rive en silence. Vous n'avez pas osé me questionner, et j'ai tenté de mon côté de vous assurer de l'insignifiance de mon trouble.
Je vous ai ramenée chez vos parents, vous m'avez fait promettre de revenir le dimanche suivant, et la suite, vous la connaissez : vous ne m'avez jamais revu.
Vous ne me reverrez jamais, Mathilde. Et c'est préférable pour nous deux.
Je n'avais pas imaginé que les choses tourneraient ainsi. Et mon échec m'a plongé dans un abime de désespoir. Mais maintenant que je m'en suis remis, j'ai tenu à apposer moi-même le sceau final de notre aventure – si toutefois vous aviez été tentée de baptiser ainsi ce déplorable épisode. Je vous dois une explication, autant que je me la dois à moi-même si je veux pouvoir faire ce deuil qui m'a été jusqu'ici impossible.
Je suis Germain Dupré.
Vous avez connu un autre Dupré, vous en souvenez-vous ? Léon était mon frère. Je vous vois grimacer, Mathilde. Oui, c'est bien celui à qui vous pensez. Léon, mon frère aîné, mon ami, mon compagnon d'enfance et de jeunesse, qui a un jour eu le malheur de croiser votre si joli regard, il y a trois ans déjà… Léon, que vous avez aimé, je le sais, autant qu'il vous aimait ; que vous avez laissé vous approcher, de si près, que ni vous ni lui n'avez su résister à ce désir qui vous a enflammés… Ne niez pas, Mathilde, je l'ai entendu m'en parler, le lendemain, il en était à la fois honteux et fou de joie, fou d'amour pour vous, et moi j'étais heureux pour lui… Pourrez-vous un jour expliquer pourquoi, alors, ce revirement, pourquoi ces accusations indignes et calomnieuses que vous avez lancées contre lui quelques semaines plus tard, réalisant sans doute que vous étiez enceinte et n'ayant pas voulu l'assumer auprès de vos parents tout-puissants ? L'avoir accusé de viol, Mathilde, est un crime dont vous ne pourrez jamais vous sentir tout à fait affranchie… Comment avez-vous pu le laisser conduire en prison ? L'abandonner tel que vous l'avez fait, au point que vous n'avez jamais plus pris de ses nouvelles, et jamais pu apprendre qu'il s'était pendu dans sa cellule quelques mois après le jugement !
… Pardonnez-moi si mon écriture vous semble moins lisible en ce moment de ma lettre. Je n'ai dû le courage de la rédiger ce soir qu'à l'absorption d'une liqueur qui trouble mon esprit autant qu'elle m'aide à vous apprendre ce que vous deviez savoir, et ce qui vous a été manifestement caché par vos parents – qui se sont empressés de vous faire rentrer dans le rang en vous présentant cette caricature de fiancé… Comment auriez-vous pu remplacer Léon ? Et pourtant, vous alliez le faire, sans le stupide sursaut d'orgueil de cet imbécile qui vous a fuie – me laissant l'occasion inespérée d'une vengeance que j'aurai finalement échoué à mener à terme.
Je savais que vous ne saviez pas nager, Mathilde. Je connaissais cet endroit du lac abrité des regards. Mais vos yeux vous ont sauvée. Je n'ai pas pu vous pousser à l'eau comme je l'avais décidé. Je n'ai finalement pas été plus hardi que votre crétin de Frédéric, en me laissant aller à ces larmes maudites, celles qui m'ont gagné dans un flot irrépressible quand j'ai réalisé que je ne sauverais pas la mémoire de Léon – ou peut-être que tout ce que je pourrais tenter ne me le ferait jamais revenir.
Adieu donc, Mathilde. Vous avez été trop bête, ou trop belle, pour mourir ce jour-là. Faites-moi simplement la grâce de vous en souvenir, et de garder à l'esprit la mémoire de mon frère, le premier de vos amants et le seul qui vous aura aimé à ce point.
Quant à moi, je prends demain le bateau pour les Indes. Exil que j'espère salutaire : on dit qu'on y enseigne une sagesse millénaire – de celles dont j'ai grand besoin pour apaiser les douleurs morales qui ne me quittent plus depuis que mes yeux ont croisé l'éclat des vôtres, au creux de ce bois qui a emprisonné mon âme et dont, jamais vraiment, elle ne sortira.
Bien à vous,
Germain Dupré.
Note du barman : Vous pouvez retrouver Emmanuelle Cart-Tanneur dans le recueil 2012, primée pour sa nouvelle "Nouveau régime"
 2 commentaires
2 commentaires
-
Par Barman le 25 Octobre 2012 à 10:30

Camille Duciel, l'étoile du jour
J'aime écrire des nouvelles avec un "twist" final. J'ai beau essayer de le contourner, pour l'instant je n'y arrive pas.
"Je ne suis pas là" raconte le mensonge et la vérité, la présence et l'absence. Le thème exploré est la connaissance de l'autre ; que renferme réellement l'esprit des gens ? J'aime beaucoup sonder la psyché humaine, ses conflits et ses virages sinueux. Dans cette nouvelle, deux personnes réelles s'opposent, s'affrontent, s'unissent : mais peut-être ne sont-elles que des fantômes... Au lecteur d'en tirer son analyse !
Je ne suis pas là
Je sais que le moment est mal choisi, mais il n’est jamais trop tard pour s’amender. Enfin, c’est ce que ma mère m’a toujours dit. Moi, je suis plutôt de l’avis que toute vérité n’est pas bonne à dire, surtout quand on n’a pas d’arrière-pensées particulières. Après tout j’ai prémédité chacun des actes qui m’ont emmenée jusqu’à ce jour. Je n’ai rien laissé au hasard et je n’ai rien fait contre ma volonté. Je suis ici, aujourd’hui, parce que j’ai choisi de l’être. Mais je crois qu’une part de moi ressent le besoin d’expier.
Je n’ai jamais éprouvé de frisson particulier avec Louis. J’apprécie sa conversation, sa culture, son humilité. Il ne me manque pas quand il s’éloigne. Je ne ressens pas de sensation de vide à l’idée qu’il me quitte, qu’il disparaisse, qu’il soit happé de ce monde sans crier gare. J’ai de l’estime pour lui. Ça s’arrête là. C’est suffisant. Quand je l’ai rencontré, il étudiait l’histoire de l’art depuis quasiment dix ans. Il se dirigeait vers une carrière brillante de conservateur, il était de bonne famille. Il était curieux. Il a insisté pendant des semaines pour m’emmener dîner. J’ai fini par accepter, sans conviction, persuadée qu’il perdrait son bagout à l’évocation de mon passé peu fourni, de mes ambitions sans démesure, un peu incolores. J’avoue n’avoir jamais cerné avec exactitude la raison pour laquelle il est tombé amoureux de moi. Et pour laquelle il continue de m’aimer. Tout ce que je sais, c’est qu’il est facile de manipuler un homme amoureux.
J’ai grandi dans une famille où les femmes étaient omniprésentes. Mes tantes m’ont répété toute ma vie de me trouver un homme gentil et peu dégourdi qui m’achèterait une jolie maison. J’ai trouvé ça ridicule en grandissant parce que je me représentais le Grand Amour comme quelque chose d’inévitable, un genre de rite de passage quelque peu banal. Et puis, à vingt-sept ans, quand j’ai réalisé que je n’avais jamais fait de rencontre intéressante, j’ai arrêté de croire. Par paresse, j’imagine. J’ai réalisé que la vie était beaucoup moins stressante lorsqu’on n’essaie pas de plaire. C’est à ce moment que j’ai croisé Louis pour la première fois, un jour de printemps, je crois. Il m’a regardée comme si je tombais du ciel.
Nous nous sommes installés ensemble et j’ai feint de vivre les meilleures années de ma vie. Je m’occupais de la maison avec attention, j’organisais de grands dîners pour ses amis, j’invitais sa mère prendre le thé le dimanche. Je riais chaque fois qu’elle me demandait quand je lui donnerais un petit-fils. Je maintenais le masque. Même devant mon miroir, mon reflet en portait un. Il contemplait la vie sans incertitude que j’avais endossée, une vie que Louis continue d’alimenter chaque jour qui passe. Il est si paisible. Il me donne l’idée d’un homme qui a réalisé ses rêves. Peut-être en suis-je un à ses yeux.
Un jour, il m’a offert une bague sertie d’un petit diamant. Il avait un drôle d’air en me la donnant, comme s’il ne voulait pas lâcher l’écrin. Il avait peur d’un refus, je crois. Il m’arrive de ressentir quelque chose d’étrange, d’un peu froid, quand je repense à cette journée. Il était plus effacé qu’à l’ordinaire, un peu transparent. Comme s’il flottait dans un autre monde. Je me suis dépêchée d’accepter pour dissiper son malaise. Et pour masquer le mien. Je venais d’officialiser mon choix. Celui d’une vie qui ne me surprendrait jamais, aux côtés d’un homme que je ne saurais jamais aimer en retour.
Je me suis demandé une ou deux fois si je ne devrais pas lui dire la vérité. J’ai fini par prendre le parti de me taire. Louis n’est pas stupide, il doit se douter que je ne suis pas transie d’amour pour lui. J’imagine qu’il se contente de ce que je lui donne. Et moi je me contente de la même chose : une vie d’exilée dans un monde qui n’est pas le mien. Son monde. J’ai décidé d’y émigrer sans expectatives, d’oublier ce que j’ai laissé derrière moi. Je vivrai une vie confortable et je la traverserai sans beaucoup la sentir, une vie où l’angoisse de l’inconnu n’existe pas, où j’ai enterré mes suspicions, mes idées noires, mes insatisfactions. Une vie où j’ai laissé mon cœur et ce qui me rendait réelle dans la dimension que j’ai choisi de quitter. Je n’ai plus besoin de me demander de quoi sera fait demain. Je le sais maintenant.
Quatre ans se sont écoulés. Nous avons été un couple modèle, deux personnes qui illuminaient la vie des autres. En apparence seulement, mais qu’importe ? Louis croit à cette illusion, c’est tout ce qui compte. Je lui souhaite d’être heureux, même s’il aurait mérité mieux que ça. Mieux qu’une femme qui ne l’aime pas et qui se tient souriante à ses côtés, sans être vraiment là, au cours de ce qu’il pense être le plus beau jour de sa vie. Et de la mienne.
Mais pour moi ce n’est qu’un jour, égaré au milieu des autres.
J’ai été plutôt chanceux jusqu’à vingt-huit ans. J’ai grandi dans une famille aimante, privilégiée, qui m’a donné les moyens d’étudier autant que je l’ai voulu. Je n’ai jamais eu à me soucier du lendemain, de ce qui s’annonçait au-devant de moi, des chemins que j’étais censé prendre ou ne pas prendre. J’ai eu le choix, tout du long.
Mon choix le plus beau fut celui de tomber amoureux de Lila. J’avais vingt-deux ans quand je l’ai rencontrée. Je m’étais inscrit par ennui à un cours d’été à l’Ecole du Louvre qui traitait d’un thème que je connaissais par cœur. Elle s’est assise à côté de moi. Ce jour-là, j’ai pensé à tous ceux qui ne trouvent jamais l’amour, le vrai, pas une seule fois dans toute une vie. Et moi qui n’avais jamais rien quémandé, qui n’avais rien de romantique, je le tenais. Assis à ma gauche. Il frôlait mon coude du sien.
J’ai passé les plus belles années de ma vie avec elle. Nous avons emménagé dans un petit appartement dans le 9ème qu’elle a peint en rouge et vert. Elle voulait vivre comme Amélie Poulain. C’était ça, son rêve. Vivre dans un rêve.
Au printemps, je l’emmenais pique-niquer sur l’Ile Saint-Louis et je lui lisais des contes pour enfants. Elle avait une grande malle en osier dans laquelle elle conservait des dizaines de nappes colorées et un assortiment de vaisselle des plus disparate. Chaque matin, avant le petit déjeuner, elle choisissait une nappe, un bol et une petite cuillère : elle mettait la table et mangeait des céréales en réfléchissant à la couleur de son humeur du jour. Lila attribuait des couleurs à tout ce qui l’entourait. Les gens, les sensations, les idées. C’était sa façon d’exprimer ses petits combats. C’était sa façon de dessiner. Moi, je la regardais à l’infini et je gribouillais son visage sur les coins de table au restaurant. J’essayais de reproduire mon bonheur. Mais c’était impossible. Il était unique. Comme elle.
Comme nous.
Six ans après notre rencontre, j’ai été acheter une petite bague en argent dans une joaillerie de la rue des Martyrs. Mais je n’ai pas eu le temps de la donner à Lila.
Un jour, elle s’est plainte d’un léger mal de tête et elle a été faire une sieste dont elle ne s’est pas réveillée. Elle a juste cessé de vivre, en douceur, sans se laisser la moindre chance.
Cessé de vivre. D’un instant à l’autre. Sans se rendre compte de rien. Sans me laisser le temps de finir de l’aimer. Cesser de vivre. C’est ce que j’ai fait ce jour-là. J’ai décidé d’arrêter de respirer, à mon rythme, comme elle, sans objection, pour la suivre à l’endroit où elle était partie. J’ai laissé mon fantôme continuer mon chemin pour moi, vendre notre appartement, finir ma thèse. Aller de l’avant.
Un an après la mort de Lila, j’ai rencontré Sylvie, une fille intelligente, maussade, pas très lumineuse. Son utilité m’est apparue comme une évidence : j’avais trouvé un fantôme pour accompagner le mien. J’avais ma mère sur le dos depuis des mois, à l’époque. Elle ne voulait pas me voir seul. Elle était tellement contente quand je lui ai parlé de Sylvie.
Je lui ai fait une cour insistante jusqu’à ce qu’elle daigne venir dîner avec moi. Je l’ai laissée parler deux heures durant pour lui faire croire qu’elle me subjuguait. J’imagine que ça a marché. Nous avons commencé à sortir ensemble quelques jours plus tard. Je n’ai jamais cherché à savoir ce qu’elle avait vraiment dans la tête. Je ne m’intéresse pas à ses sentiments, pour dire la vérité. Elle a l’air satisfaite de sa part du gâteau. C’est suffisant.
Aujourd’hui, je l’épouse. Il y a deux-cents personnes autour de nous qui scrutent le moindre détail de notre bonheur. Nous leur avons vendu une illusion parfaite.
Je n’ai pas d’animosité envers ma vie.
J’ai longtemps pensé à mon histoire avec Lila comme au Songe d’une nuit d’été. Je nous imaginais prisonniers à jamais d’un jardin secret dans lequel nous aurions passé nos journées à nous courir après, vêtus d’oripeaux absurdes. Le temps n’aurait pas eu d’emprise sur nous et la cime jalouse des arbres nous aurait cachés aux yeux du monde. Un jour, pourtant, il aurait été temps pour nous de regagner le monde des vivants. À ce moment-là, j’aurais compris que Lila ne pouvait plus m’y accompagner et j’aurais dû me résoudre à quitter le jardin sans elle.
C’est ce que j’ai fait. J’ai laissé mon âme à ses côtés et je me suis soumis à l’exil le plus douloureux qui soit. Celui qui mène au monde des vivants, où je suis sommé de finir ma propre partie, quand j’ai laissé mon cœur dans le jardin des morts.
J’ai trouvé un amour immense et splendide. Je n’ai pas de remords même s’il m’a été arraché. Je suis parti avec lui, et j’ai laissé un fantôme remplacer mon reflet dans le miroir.
Je ne suis pas là.
 2 commentaires
2 commentaires
-
Par Barman le 23 Octobre 2012 à 08:00

Marie-Christine Quentin, l'étoile du jour
Écrire a toujours été pour moi une passion, mais me donner à lire... ça c'était tout autre chose ! Ce n'est qu' en 2008 que j'ai franchi le pas en participant pour la première fois à un concours de nouvelles. Je voulais "mesurer" mon écriture. Le résultat a dépassé mes espérances. Depuis, mes nouvelles ont été distinguées à plusieurs reprises (salon du livre du Mans, Dol de Bretagne, Ancinnes...) et certaines publiées au sein de recueils collectifs (Plumes d'azur, Éditions Grimal, La lampe de chevet, Tu connais la nouvelle, Concours de nouvelles George Sand)
Au plaisir d'écrire, s'est ajouté celui de partager avec le lecteur les émotions qui traversent mes textes, avec l'espoir d'apporter à chacun de courts moments d'évasion.
Le roux noyer
Elle ne sut jamais comment il était arrivé. Ni d’où. Elle l’avait aperçu la première fois en tout début d’après-midi, seul au milieu du champ. Il était forcément passé devant sa fenêtre. Forcément. Pourtant personne n’avait marché sur le chemin. Le chien n’avait pas aboyé. Plus tard, bien plus tard, elle se dirait que comme tous les loups solitaires, il avait dû venir de la forêt. Forcément.
Intriguée, elle était restée longtemps à épier la silhouette qui se dressait exactement à l’emplacement du vieux noyer. Elle l’avait d’abord observé tourner en rond, tête baissée, les épaules enfoncées comme s’il avait perdu quelque chose au milieu des hautes herbes mouillées. Puis il s’était figé. Sans se soucier de l’orage qui redoublait d’intensité, il était resté immobile pendant plus d’un quart d’heure avant de brusquement tourner la tête vers la maison. Instinctivement, elle s’était reculée dans l’ombre des rideaux.
Le chien se redressa d’un bond, les oreilles soudain en alerte.
- Couché Dourak !
L’animal vint lécher sa main puis, rassuré, il s’étira longuement avant de regagner sa couverture devant la cheminée.
Elle n’avait pas bougé. Tapie contre le mur elle avait retenu son souffle. Elle avait cru entendre quelque chose. Elle n’en était pas sure. Elle avait bien tendu l’oreille, mais peine perdue, à lui seul le gargouillis de la gouttière noyait tout espoir de distinguer le moindre pas sur le gravier. Elle avait fini par risquer un coup d’œil par la fenêtre : la silhouette avait disparu. À gauche, la petite route qui serpente le long du Vidourle était déserte. Sans doute avait-il dû poursuivre son chemin à travers la prairie. Si tel était bien le cas, elle le verrait bientôt réapparaître aux abords de l’étang, à l’autre bout du champ. À moins qu’il n’ait choisi de s’enfoncer directement sous l’épaisse frondaison de la forêt pour se mettre à couvert. Quoi qu’il en soit, il s’était éloigné. Tranquillisée, Agnès allait reprendre sa lecture quand des coups secs furent frappés à la porte.
- Je peux entrer ?
Avant même qu’elle n’ait eu le temps de lui répondre, l’homme se dressa devant elle, dégoulinant de pluie. Il était vêtu d’un épais manteau de laine et d’un curieux chapeau en feutre rond à large bord comme ceux que portent les bergers. Ses manches étaient trempées, maculées de boue jusqu’aux coudes comme s’il avait fouillé dans l’herbe. Sans hésiter, il se dirigea droit vers la cheminée, le corps secoué par une forte quinte de toux.
- On peut encore manger ?
La saison était terminée et rares étaient les touristes qui s’aventuraient encore jusqu’à l’auberge. Elle n’avait pas grand-chose à lui proposer, mais elle acquiesça :
- Si vous n’êtes ni trop difficile… ni trop pressé, ajouta-t-elle sur un ton interrogatif. Ce n’est vraiment pas le temps idéal pour se promener !
Pour toute réponse, l’homme ôta son chapeau découvrant une étonnante masse de cheveux roux retenus en catogan par un large ruban de velours vert tout élimé. La coiffure la surprit, mais plus encore l’aisance avec laquelle il lança son chapeau sur la patère située derrière la porte. Habituellement, les clients ne la remarquaient même pas. Troublée, elle détourna la tête :
- Asseyez-vous, je vais vous préparer quelque chose de chaud.
L’homme retira son manteau qu’il installa sur le dossier d’une chaise, et regarda autour de lui. Le blanc des murs avait un peu fané, la peinture des portes et des fenêtres craquelait et s’écaillait, mais pour le reste, rien ne semblait avoir changé. Seule l’immense table cirée en merisier avait disparu, cédant la place à quatre plus petites recouvertes de nappes à carreaux rouges et blancs qui donnaient à l’ensemble un charme un peu désuet. Les mains croisées derrière le dos, il parcourut minutieusement la pièce s’arrêtant devant chaque objet qui la décorait. Ils évoquaient tant de souvenirs, faisaient surgir tant d’images oubliées. Ici, la balance et ses poids en laiton avec lesquels il avait joué au marchand pendant des heures. Là, la soupière ébréchée. Ici encore, le moulin à café « Peugeot » et son couvercle bleu tout cabossé d’être trop souvent tombé sur le pavé, le fer à repasser en fonte marqué des initiales DV, le taille craies, l’œuf de forçat que son arrière-grand-père avait rapporté de Cayenne. Il ne put s’empêcher de sourire : même le vieux pot de chambre en émail avait trouvé une nouvelle fonction, trônant au milieu de la maie, garni de fleurs séchées. Les photos étaient là aussi, soigneusement punaisées sur le mur. Il n’en manquait pas une. Des scènes champêtres d’une époque révolue. Il s’arrêta sur la plus grande fixée au centre de la cheminée. Contrairement aux autres, elle avait été placée sous verre et ses couleurs étaient à peine passées. Dans le coin inférieur droit, on pouvait encore déchiffrer une inscription portée à l’encre rouge : « Le roux noyer, octobre 1956 ».
Agnès posa un pichet sur la table. Debout face à la cheminée l’homme lui tournait le dos. Débarrassé de son manteau il lui apparut plus chétif qu’elle ne l’avait d’abord imaginé. Timidement, elle s’avança à ses côtés. Il dégageait un curieux mélange d’odeur de tabac froid et de lainage mouillé. Ses yeux fiévreux étaient rivés sur la photo.
- C’était un arbre magnifique, n’est-ce pas ?
Elle avait presque murmuré ces mots, comme une confidence. L’homme n’avait pas cillé. Un long moment ils restèrent muets, les yeux perdus ensemble dans la contemplation de l’imposant feuillage aux reflets roux. C’est à peine s’ils osaient respirer et seul le ronflement du chien endormi à leurs pieds animait le silence.
- Pourquoi l’ont-ils abattu ?
Au son de la voix rauque et caverneuse, Agnès frémit : ainsi elle ne s’était pas trompée. Elle se pencha pour attiser les braises. Ses mains tremblaient. Lorsqu’elle se redressa les joues en feu, elle le fixa droit dans les yeux :
- C’est elle qui l’a voulu…
Visiblement surpris par sa réponse, l’homme haussa un sourcil en accent circonflexe. Un seul. La même expression que sa mère, songea Agnès.
- Tu sais donc qui je suis ?
Dans son sommeil, le chien émit un long grognement plaintif. Sans doute devait-il rêver. Elle s’accroupit et doucement lui ébouriffa les poils afin de le rassurer.
- Oui. Tu es Matthias.
L’homme réagit à peine. Il continua de regarder le chien qui s’ébrouait, avec au coin des lèvres un sourire vague et mou.
- Et toi, qui es-tu ?
Lorsqu’elle leva vers lui ses grands yeux gris où perçait une pointe de défi, il crut qu’il allait défaillir. Ce long visage osseux, ces cheveux ambrés, et ces yeux. Ah ! Ces yeux ! La ressemblance lui apparut d’un coup si évidente qu’il se demanda comment il avait pu ne pas la remarquer plus tôt.
- Je suis ta sœur.
Un instant Agnès crut deviner une lueur farouche dans son regard. Mais peut-être était-ce seulement son imagination ? Ou le reflet de la lumière du feu ? Quoi qu’il en soit, une seconde après la lueur avait disparu.
- Ma sœur…
Il avait murmuré ces mots comme pour lui seul. Un simple chuchotis qui se perdit au milieu des crépitements du feu. Il la dévisagea longuement essayant de lui donner un âge.
- Je suis née l’année qui a suivi ton… départ.
Elle avait prononcé sa phrase tranquillement, sans manifester le moindre trouble, comme si elle s’était depuis toujours préparée à devoir la formuler un jour. Elle avait juste marqué une légère hésitation avant le dernier terme.
Abasourdi, Matthias s’était laissé tomber dans un des vieux fauteuils en cuir et se tenait la tête entre les mains. En venant ici, il s’attendait à tout. À tout, oui. Mais certainement pas à ça. Une nouvelle quinte de toux vint le secouer, plus violente que la précédente.
- Viens, tu es trempé. Je vais te donner des vêtements secs, et puis tu vas manger. Ensuite seulement nous parlerons.
Matthias s’était levé. Il se tenait maintenant face à la fenêtre, une tasse de café fumant entre les mains. C’est à peine s’il avait touché à son assiette. Dehors, la pluie avait cessé et la lumière du jour commençait à faiblir. Voilà plus d’une heure qu’elle parlait et qu’il l’écoutait. Il n’en pouvait plus. En avait assez entendu. Ne voulait pas en savoir davantage. Fourbu, le chien s’était redressé lui aussi et il s’était traîné jusqu’à ses pieds. Il renifla le bas de son pantalon et se mit à grogner. Matthias ouvrit la porte pour le laisser sortir. Une odeur de terreau mouillé l’assaillit le ramenant des années en arrière.
Ce jour-là aussi il avait plu. Mais une pluie d’été. Il revit son père avachi sous le grand noyer, cuvant son vin comme à son habitude, la braguette ouverte et la casquette enfoncée en arrière. Il entendit la voix du vieux gronder quand il l’avait traité de tous les noms avant de le maudire à tout jamais. Puis il la revit elle, en larmes, tentant de lui dissimuler la trace des coups sur son visage. Cette fois son père était allé trop loin. Fou de rage, il avait couru s’emparer de la carabine cachée sous la commode et il avait tiré à bout portant. Il venait juste d’avoir dix-huit ans. Quand les gendarmes l’avaient emmené, il s’était tourné vers sa mère :
- C’est fini maintenant. Il ne nous embêtera plus.
Elle avait simplement baissé la tête.
Pourquoi ne m’a-t-elle jamais écrit quand j’étais en prison ? Pourquoi n’est-elle jamais venue me voir ?
Agnès sursaute. Il n’a pas prononcé un mot depuis des heures et la violence de sa voix tout à coup la surprend.
Peut-être à cause de moi. Elle n’a jamais voulu que je sache. Ce n’est qu’après sa mort que j’ai appris le drame du roux noyer. Avant, j’ignorais même jusqu’à ton existence. Elle avait tout gommé de toi, tout effacé, jusqu’au noyer qu’elle avait fait abattre. Elle n’avait conservé que cette photo. Souvent, je me suis demandée ce qui la rendait si triste quand elle la regardait. À la fin, elle venait s’asseoir ici tous les jours, sur ce banc où tu es assis aujourd’hui. Elle restait là des heures à lisser entre ses doigts son vieux morceau de velours vert qui ne la quittait jamais. Chaque fois que le chien aboyait, elle se levait d’un bond pour scruter le chemin. Les gens ici ont dit qu’elle était morte de chagrin. À cause de toi. Je crois que jusqu’au bout elle t’aura attendu.
Elle s’est assise près de son frère et a posé la main contre la sienne. Il est brûlant.
- Tu pourrais faire un effort pour me dire quelque chose, murmure-t-elle sans détacher ses yeux du ruban vert qui retient ses cheveux. Jusqu’ici tu n’as fait que te contenter de m’écouter…
Matthias relève la tête. Elle croit qu’il va enfin parler. Mais rien. À nouveau, il se referme sur son silence. Au loin, un trait de lumière blanche force le crépuscule comme un dernier rempart contre l’obscurité.
- Pourquoi tu n’es pas revenu quand ils t’ont libéré ?
Une lueur troublante traverse ses prunelles. Cette question, il l’attendait. Il est même étonné qu’elle ne l’ait pas posée plus tôt.
- Je ne sais pas…
Sa voix n’est qu’un léger bruissement perdu au fond d’un labyrinthe. Comment lui dire ? Comment lui expliquer ce qu’il a vécu durant toutes ces années ? De toute façon, que pourrait-elle comprendre ? Le regard s’enfuyant bien au-delà de la ligne d’horizon il ajoute en hochant la tête :
- Le champ me semble tellement vide…
Dans la pénombre, elle a glissé sa main au creux de la sienne :
- Viens maintenant ! Tout ça est loin, il faut rentrer. Il va bientôt faire nuit.
Il a mis plus de temps qu’il n’aurait dû pour retirer sa main. Sa paume était si fraîche, si douce. Il s’en veut. Il en veut à cette heure incertaine où tout devient possible, où les âmes les plus sombres peuvent se confondre parmi les autres sans risquer de se voir démasquer. Alors brusquement, il se lève. Sans un mot. Il pénètre dans la maison, prend son manteau, son chapeau, arrache la photo de son cadre et la jette dans la cheminée.
Agnès est restée immobile.
Sur le palier, il marque un temps d’hésitation : jamais les arbres ne lui ont paru aussi noirs qu’à cette heure où le monde bascule entre jour et ténèbres. Il frissonne. Au-dessus du champ, il croit un instant distinguer une masse plus opaque que l’obscurité. Mais l’arbre n’est plus là depuis longtemps.
Quand il atteint la lisière sombre de la forêt, il se retourne. Agnès est toujours là, frêle silhouette dans la clarté de la porte grande ouverte. Immobile, elle regarde son frère s’enfoncer peu à peu dans l’ombre avec cette étrange sensation qu’il disparaît happé dans la fumée d’un feu de cheminée. Elle s’interroge. Son frère, ou bien son père ? Elle ne saura jamais. Déjà l’obscurité se referme sur la forêt, et bientôt la nuit noire aura tout avalé.
 2 commentaires
2 commentaires
-
Par Barman le 20 Octobre 2012 à 14:50

Christine Pruvot, l'étoile du jour
Le chevreuil.
Le chevreuil hésite. Il tourne la tête d’un côté puis de l’autre. Observe… Écoute… Attend.
Gracieuse silhouette à peine visible au milieu des taillis, il reste immobile à la limite entre les arbres et la dune.
Julie hésite. Devrait-elle bouger ? Se lever… Agiter son écharpe… lui faire peur.
Qu’il fuie. Mon Dieu! Qu’il recule dans l’ombre des feuillages. Qu’il se dissimule derrière les buissons épineux. Que sa belle fourrure fauve disparaisse dans le rouge éclatant des baies d’argousiers.
Ne sent-il pas le danger ? Julie n’entend plus les aboiements des chiens et les détonations des fusils brisant le calme et l’harmonie de ce bel après-midi d’automne. Mais… les chasseurs ne sont jamais loin quand une proie s’aventure à découvert et s’offre à portée de leurs tirs. Qu’il ne sorte pas du bois!
Cela fait de longues minutes qu’il est apparu à la lisière du bois. Cela fait de longues minutes que Julie le regarde. Fascinée. Hypnotisée. Sortira-t-il du couvert protecteur où il mène sa vie secrète ? S’aventurera-t-il vers les touffes d’oyats qui semblent le tenter si fort ? Se lancera-t-il dans une folle course au travers des chemins de dune ?
Le chevreuil hésite.
Julie ne distingue plus qu’une ombre dansante. Le chevreuil ondoie dans le tremblement de ses cils. Julie passe une nouvelle fois le dos de ses mains sur ses joues. Lentement… Une main après l’autre… Une joue après l’autre… Maudites larmes!
Est-ce à cause du sable qui se colle dans ses sourcils ? D’une mèche de cheveux que le vent plaque sur son front ? Du soleil blanc qui transperce les nuages ? Tout cela sans doute. Tout cela…
Depuis plusieurs semaines, Julie ne regarde plus le monde qu’au travers d’un brouillard humide. Depuis plusieurs semaines, les yeux de Julie sont deux sources intarissables. Depuis plusieurs semaines, Julie ne peut s’empêcher de pleurer.
Simon… Pourquoi?
La librairie dissimule ses attraits, cachée au fond d’une étroite rue en impasse. La foule des samedis après midi se presse dans l’avenue commerçante et ne songe pas à s’engager dans cette rue ancienne, sans vitrines aguichantes, où l’on se tord les pieds sur les pavés.
Les touristes, confiants dans leur guide, s’y aventurent pour découvrir un décor de rinceaux au-dessus d’une fenêtre à meneaux, un mascaron sculpté dans le chêne d’une porte Renaissance, une fontaine depuis longtemps tarie, mais au-dessus de laquelle une coquille rappelle qu’autrefois un habitant de la rue a fait le pèlerinage de Saint-Jacques…
Et puis, il y a les initiés. Ceux qui aiment les livres. Tous les livres. Les anciens avec leur précieuse reliure. Les délicats au papier si fin et si doux entre les doigts. Les beaux aux illustrations raffinées. Les livres coûteux pour les collectionneurs… Les livres de poche pour les étudiants avides de culture… Ceux qui aiment l’odeur particulière de bois, de cire, de papier jauni qui ravit dès qu’on pousse la porte d’une vieille librairie.
Julie a tout de suite été conquise. Le silence de la rue au sortir de l’agitation. Le calme paisible exhalé des façades anciennes. Une rue hors du temps. Elle a ressenti une impression de sérénité.
Au fond de l’impasse, la librairie est pimpante. Elle vient d’être rénovée et repeinte. Vert tilleul et mauve. Douceur des teintes. Harmonie des couleurs. Avant même d’y entrer, Julie est séduite. À la manière dont la vitrine est présentée, on sent que le libraire n’est pas un simple commerçant. Un amoureux des livres. Un passeur de savoirs.
Julie a ouvert la porte. Elle ne l’a jamais refermée!
Le chevreuil hésite. Il tourne la tête d’un côté puis de l’autre. Observe… Écoute… Attend.
Rien qui ne puisse l’effrayer pourtant.
Les rayons de soleil tracent des chemins de lumière dans le sable. Les oyats ondulent sous la brise marine… Danse séductrice. Danse lascive.
Mais ses oreilles ont frémi. Que peut-il entendre que Julie ne perçoit pas ? Des cris d’enfants qui jouent, là-bas, sur la plage, au-delà de la ligne des dunes ? Le ronronnement d’un moteur d’avion qui passe, là-haut, dans le ciel, au-delà du moutonnement des nuages ? Un aboiement de chien, très loin, dans la forêt, au-delà des buissons d’argousiers, des rangées de bouleaux et de pins?
Julie n’entend rien. Les fusils se sont tus depuis longtemps. Julie ne voit rien. Les chasseurs se sont éloignés sans doute.
Si le chevreuil se découvre, bougera-t-elle ?
Il est dans sa nature de se mettre en danger. Il ne peut rester caché au fond des bois. Pour l’instant, il ne risque rien.
Mais si les chasseurs surgissent… Si la gracieuse bête tombe…
L’image s’imprime dans l’esprit de Julie. La bête innocente agonisante. L’or du sable et le vert tendre des oyats éclaboussés de sang…
Non ! Elle ne pourrait le supporter. Pas de mort! Trop de douleur !
Simon… Pourquoi ?
Pourquoi es-tu parti si vite ?
La librairie est devenue le lieu de retraite de Julie. Son oasis. Son jardin d’Eden. Elle ne s’est jamais sentie aussi sereine que dans ces deux pièces, débordantes de livres.
Dès qu’elle a terminé son travail, qu’elle peut s’offrir un peu de détente, elle y accourt. Le ding dong de la petite cloche qui accompagne l’ouverture de la porte la réjouit à chaque fois, comme au premier jour.
Elle s’assied dans le vieux fauteuil crapaud au velours fané et se plonge dans le dernier ouvrage reçu. Elle prépare les bandeaux: « Votre libraire a lu pour vous … »
Ou bien, elle ne fait rien. Elle écoute Simon. Les conseils de Simon aux hésitants. Les avis de Simon aux curieux. L’enthousiasme communicatif de Simon.
« Un vrai libraire, tu verras, lui avaient dit ses collègues en lui recommandant la librairie. Il faut aller acheter tes livres à cet endroit. Il n’est pas installé depuis longtemps. Il faut absolument qu’il soit connu et que ça marche. Pour une fois qu’on peut profiter d’un vrai professionnel! »
Quelle chance pour elle d’avoir rencontré Simon! Il est si calme. Si rassurant. Si reposant. Elle a enfin le sentiment d’avoir posé ses valises. De s’être installée dans une liaison amoureuse stable. Épanouissante. Apaisée.
Même les petits conflits du quotidien, les moments de tension et de discorde se dissolvent sans souffrance. Simon trouve les mots. Réduit les drames à ce qu’ils sont. Des broutilles. La colère n’a aucune prise sur lui.
Oh, Julie n’est pas béate sur un nuage azuré, dans un monde éthéré. Elle connaît les limites de son bonheur.
Elle n’est pas seule dans le cœur de Simon. La première place est occupée par Manon. La vive, la fantaisiste, la rieuse Manon. La fille qu’il a eue d’un premier mariage.
Et puis… il y a la librairie. Julie n’a pas besoin de discours. Elle sait que si un jour, les aléas de la vie l’amenaient à demander à Simon de choisir entre la librairie et elle, elle serait perdante.
La librairie n’est pas un simple outil de travail. Il lui consacre tout son temps. Participe à de multiples activités culturelles pour la mettre en valeur. C’est sa passion au sens le plus fort de ce mot galvaudé.
Consciente des fragilités de son couple, Julie est cependant enfin heureuse. Pleinement heureuse. Sereinement heureuse.
Le bonheur pourtant est chose fragile. Un papier crépon qui se déchire entre les doigts trop pressés. Un jour… Une brisure. Une fêlure.
Simon a changé. Il reste moins longtemps le soir à flâner au milieu de ses livres. Il est moins patient avec les clients, même les fidèles, ceux avec lesquels il se complaît dans d’interminables commentaires sur leurs dernières découvertes. Il semble distrait. Préoccupé.
Il mange peu. Il est pâle. Il maigrit.
Le médecin a prescrit une série d’examens. « On va y aller avec tranquillité et méthode. Examens de routine. Pour être sûr. Ce n’est sans doute que du surmenage. Un peu de repos et tout rentrera dans l’ordre. Ne vous inquiétez pas! »
Julie et Simon ont poussé la porte de l’hôpital. Ils ne l’ont jamais refermée.
Le chevreuil hésite. Il tourne la tête d’un côté puis de l’autre. Observe… Écoute… Attend.
Il a, semble-t-il, reculé. Julie ne voit plus que la partie antérieure de son corps. Ses pattes frémissantes, prêtes à bondir. Ses oreilles attentives, à l’écoute du bruit le plus furtif. Ses yeux sombres et inquiets, fixés sur l’horizon.
Le bel animal est farouche. Il se méfie de tout. Des oyats qui ondulent, caressés par le vent. Des dunes qui se poudrent d’or, illuminées de soleil.
Il n’osera pas. Il n’est pas encore prêt à sortir du bois.
Pourtant Julie aimerait le voir s’élancer. Voir la bête gracieuse courir. Dégagée de toute peur. Enivrée de liberté.
Pourtant Julia aimerait s’élancer. Prendre enfin une décision. Dégagée de toute peur. Enivrée de liberté.
Julie hésite encore. Elle se sent comme le chevreuil. Presque prête. Tentée. Pensive. Craintive.
Quel chemin doit-elle suivre ? Vers quel horizon diriger son avenir ?
Simon… Pourquoi?
Pourquoi es-tu parti si vite? Pourquoi la maladie t’a-t-elle ravi à mon amour ? Pourquoi m’as-tu laissée ?
Pendant plus d’une semaine, la librairie n’a été que murmures. Propos compatissants. Condoléances sincères. Mines désolées. Silence !…
Sans Simon, elle avait perdu son charme. Son attrait. Son âme.
Et puis…
Peu à peu, les habitués ont repris leurs habitudes. Les flâneurs sont revenus flâner. Les fureteurs fureter. Les curieux questionner.
Le jeune Rémi, l’assistant de Simon, fait de son mieux pour les recevoir et les conseiller. Manon s’est mise à la caisse. Et Julie gère au plus pressé. Pas trop le temps de penser. De pleurer. Tant mieux.
Deux mois de vacances pour faire face à l’urgence. Une chance. Hélas!
Mais Julie sent l’inquiétude qui étreint la librairie. Elle la voit dans les yeux trop vite détournés de Manon et de Rémi. Elle l’entend dans leurs propos faussement anodins. Même chez les plus fidèles clients, elle est sensible.
Que va devenir la librairie ? Va-t-elle être vendue ? Et si l’acheteur manquait de cœur ! Si elle n’était plus qu’une simple boutique. Un vulgaire supermarché du livre!
« On ne peut pas laisser faire cela ! » Manon a enfin prononcé les paroles tant redoutées.
« On ne peut pas vendre la librairie. Papa ne le veut pas. Peut-on souffrir encore quand on est mort ? »
Julie ne le sait pas. Mais on peut tellement souffrir quand on est vivant !
Manon réclame un peu de temps.
« Deux ou trois ans. Dès la fin de mes études, je suis cent pour cent avec toi. En attendant, Rémi t’aidera. Tu ne peux pas le laisser tomber. Tu ne veux pas qu’il soit chômeur. Dis, Julie, tu veux bien. »
Manon sait se faire caressante, attendrissante, quand elle veut obtenir quelque chose.
Bien sûr, Julie est tentée. Vendre la librairie ! Impossible de toute façon si Manon le refuse. Mais… Julie est une femme raisonnable. Prudente. Craintive.
Démissionner de son métier stable de professeur pour s’engager dans une aventure incertaine. En a-t-elle envie ? Tenir à plein temps la librairie avec un employé dont le travail dépend d’elle. En est-elle capable ? S’engager dans les actions entreprises avec les services culturels de la municipalité. En a-t-elle l’énergie ?
Et puis… Quand Manon aura terminé ses études et viendra travailler avec elle comme elle le souhaite pour l’instant, s’entendront-elles suffisamment ?
Julie a une porte qui s’ouvre dans son désespoir. A-t-elle envie de la refermer ?
Le chevreuil hésite. Il tourne la tête d’un côté puis de l’autre. Observe… Écoute… Attend.
Et soudain, il s’élance. Confiant.
Rien pourtant n’a changé. Ne redoute-t-il plus le fusil des chasseurs ? Les crocs cruels des chiens ? La danse des oyats orchestrée par le vent, les miroirs de soleil allumés dans les dunes ont-ils eu raison de sa peur ?
Il bondit dans les dunes. Soulève des nuages de sable. Il est beau. Heureux. Libre.
Julie le suit longuement du regard. Le plus longtemps possible. Jusqu’à ce qu’il disparaisse derrière une dune plus haute.
Alors, elle se lève. Boutonne son manteau sous la gifle du vent. Ferme les yeux, éblouie de soleil. Écoute le murmure des vagues. Respire l’odeur du sable. Lève haut la tête.
Elle voit la librairie vert tilleul et mauve. Entend le ding dong de la cloche d’entrée. Sent le bois, la cire, les vieux livres. L’abandonner serait trahir Simon.
Elle se sent presque heureuse. Libérée.
À son tour de s’élancer. Confiante.
 4 commentaires
4 commentaires
-
Par Barman le 15 Octobre 2012 à 08:00

Rocher surplombant le café
Refuge Calipso, Alt.2012.
Un fond de vallée. De ces larges vallées préalpines qui hébergent pêle-mêle axes de communication, zones de commerces et de résidence. Au milieu, quelques îlots verts font de la résistance. Pour rejoindre le cœur du village, il faut s’élever, s’aventurer dans l’étroitesse des rues, accepter de changer d’échelle et oublier un temps, l’horizontal. Un peu plus tôt dans l’après-midi, deux Lyonnaises s’y sont égarées, me dit-on. Rien d’étonnant. Nous sommes aux portes de la Chartreuse, à ses pieds. Les familiers du massif vous l’avoueront, ici, chaque sentier apporte son lot de découverte, de récompense, mais tous ne sont pas balisés. La route poursuit son ascension, mais avant de passer le petit pont, c’est l’étape. On y trouve des hôtes attentionnés, à l’écoute. On se joint à d’autres voyageurs. Les inconnus se présentent, se découvrent. Certains ont plusieurs noms. Quelques têtes familières se rassemblent. Le temps des surprises est venu. L’énergie folle du slam d’un bout de chou recule encore un temps la mort annoncée des poètes. Trois porte-parole s’emparent des mots des porte-plume, les transforment, leur donnent une seconde jeunesse. Une courte pause permet d’échanger, de prêter l’oreille à de charmantes complices, d’évoquer d’autres vies minuscules, de reprendre son souffle avant de repartir du même pas assuré. Blanche passe en coup de vent et sur le marchepied d’un tramway, elle aussi, sort du bois. L’art du conte chemine un instant à nos côtés, s’appuyant sur l’épaule de la poésie. Les nouvelles reviennent résonner à nos oreilles. L’une d’elles court. Elle est forte, dure, terrible et sans faner, marque mon esprit. Quelques mots, puisque mon tour est venu et qu’il faut bien en dire. Un bref salut amical au locataire précédent, plantigrade breton. Et puis des remerciements bien sûr : au barman qui sait recevoir, aux lecteurs qui savent lire et aux clients d’un jour qui permettent à une de mes petites histoires de se promener en si bonne compagnie. La soirée s’achève comme elle a commencé, en chansons, en musique. Une voix se distingue dans la jungle des mots incisifs, sur des airs rock de java. Je prends, j’apprends encore. L’air est vif quand, très tard, on met le pied dehors. Dans l’obscurité, le petit pont chuchote que de l’autre côté, la montagne attend. Pour emmener ailleurs, peut-être un peu plus haut. Il suggère des itinéraires, fait naître des envies, des idées. Je lui promets de revenir un jour, une nuit. Il se fait tard, je rentre. Écrire…
Merci
Dominique Chappey
 7 commentaires
7 commentaires
-
Par Barman le 12 Octobre 2012 à 11:00

Damien Blumenfeld, l'étoile du jour.
Passionné de théâtre, j'écris comme certains font du bricolage, ou d'autres des promenades à vélo. Quand le temps, dans ces si rares moments, ouvre une brèche, je prends mon stylo et note sur un carnet les idées qui me passent par la tête. Après de longues études de philosophie, cela fait du bien de pouvoir, par l'écriture, renouer avec les expériences insondables de la vie.
Une fois, Virginie, avec toi.
Il ne faut pas trembler, je dois contenir mes larmes, ma chambre est si froide et je n’ai personne à qui me confier, mais je dois leur dire. Si je ne leur dis pas aujourd’hui, je ne leur dirai jamais. Virginie m’attend, ce soir c’est notre soir. Ma chemise est défaite, je dois la boutonner. Une chemise, moi !
Dehors la maison tremble de mes douleurs, l’air y respire mal. Chacun est affairé à préparer ce grand moment. Les oiseaux dans les arbres répandent la nouvelle malgré la nuit tombée. Le chat guette, rode, m’attend sur le pas de la porte, les feuilles frémissent du dénouement. Je descends les escaliers, comme ils tournent fort et entrainent ma tête. Je tiens à peine debout.
Vive le vent, vive le vent
Vive le vent d ‘hiver
Qui s’en va volant, tournant
Dans les grands sapins verts, Oh !
Vive le vent, vive le vent,
Vive le vent d’hiver
Boule de neige et crotte de bique
Et bonne année grand-mère !
Ma sœur passe en courant devant moi comme si je n’existais pas. Elle aussi sort ce soir. Tous ces obstacles pour moi et elle si insouciante, si heureuse. J’envie la manière dont elle rit, au nez de mes parents. Si j’avais ce courage. Plus que deux marches. Ils sont là, ils m’attendent pour manger. Ma mère, debout contre le comptoir de la cuisine, les yeux dans la vague, éternellement. Mon père, les mains frottées par l’usure et le regard acide, il n’attend plus rien, que le repas, qui tarde à arriver. C’est du faisan qu’il voudrait. Une simple poule au pot cuisinée sans grand amour et une nouvelle, ma nouvelle. La radio récite continuellement son oraison funèbre interrompant des mots qui ne parviennent pas à sortir de ma petite bouche face à ce florilège de regards éteints. Il fait nuit noire, ma mère n’a rien à regarder, que le vent. Il se fait tard, mon père n’a rien pour s’énerver, que l’espoir, qu’un jour cela s’arrêtera et qu’une nouvelle femme plus complaisante entrera dans sa vie.
- « Papa je dois te dire quelque chose »
Ces mots sont sortis de ma bouche. Où me tourner ? Où regarder ? Le crépi blanc, la lumière jaune, les yeux furieux de mon père qui n’a rien entendu, mon chien qui se rapproche ? Une caresse pour toi. Ma mère parle toute seule, elle dit des mots que personne n’entend et qui ne veulent rien dire.
- « Mon père, mon père, mon père. »
C’est sa seule obsession.
- « Papa, je sors ce soir. »
Silence absolu. Même la radio ne grésille plus. Seul le chien jappe parce qu’il a faim et que personne ne se préoccupe de lui. Je hais l’odeur de ses croquettes, je ne m’en occuperai jamais. Il pue ce chien, il pue.
- « Papa ce soir je sors et je vais dans une boîte gay. »
Vite courir, loin, loin, loin. Charles tais-toi, tais-toi. Où regarder, vite, vite. Je prie le seigneur que je ne connais pas pour qu’il me pardonne mes pêchés et ne juge pas trop durement mes fautes en ce jour qui précède celui de ma mort. Il n’a rien dit, pas un mot.
- « Papa, tu m’as entendu ? »
Je ne peux pas rester, je pars, il n’a rien dit.
Enfermé dans ma chambre, je n’oserai plus jamais en sortir, mais Virginie m’attend. Combien y a-t-il de murs blancs? J’entends mon père monter. Son pas résonne lourdement, celui de ma mère est plus léger, celui de ma sœur enfantin. Sauter, il fait trop froid. Me pendre, je n’ai plus le temps. Je vois la porte s’ouvrir, je suis là, il est là, il me regarde, il ne me regarde plus. Il ne dit rien.
- « Charles… »
Un autre bruit de pas dans les escaliers, celui de ma mère, pesante comme une vache ce soir. Elle traîne ses espadrilles sur chacune des marches, ouvre la porte qui s’est refermé, me regarde avec ses yeux mi- sombres, mi- pleurants et pleure, de désespoir. Elle tape sur l’épaule de mon père immobile.
- « Je t’avais dit d’être plus là».
Ma sœur aussi est là, dans l’embrasure de la porte, sa chambre est voisine et elle pleure, de honte, je le lis dans ces yeux : « Mon frère, nous n’avons pas choisi nos parents, mais je viendrais avec toi si tu le veux, je le sais. Je voudrais être comme toi pour leur dire aussi. » Insoutenable, elle s’en va.
Quand je me suis imaginé leur dire je me voyais rayonnant, triomphant, plein de fierté, j’étais homme. Virginie m’attend. Combien de jours encore à vivre sous leur toit ? Je sors, je pars, Virginie m’attend, ils ne me verront plus. L’image du désespoir, mon père n’a rien su dire. Les arbres au moins, muets aussi, seront témoins de mon courage. Au printemps un de leur bourgeon portera mon nom.
Dehors il fait un froid de canard et il y a vingt minutes au moins à marcher pour prendre le dernier RER. Bien sûr je n’ai pas pensé à enfiler mes gants et Virginie m’attend. Là voilà, sur le pas de la porte, sans même me dire bonjour.
- « Alors tu leur as dit ? »
J’ai presque fait demi-tour.
Comme les étoiles brillent fort. Virginie me tient par la main. Je sens mon cœur se soulever et j’ai presque envie de pleurer. Elle me rassure.
- « Ne t’inquiète pas comme ça. Tout va bien se passer, tu as déjà fait le plus dur, maintenant c’est du plaisir. Regarde ma main. Est-ce qu’elle tremble ? Je ne suis pas stressé comme ça. Détends-toi. »
Elle me prend l’épaule et m’embrasse. C’est efficace, mes pieds se mettent à marcher plus vite et l’image de mes parents s’efface progressivement de mon esprit. J’aurais aimé que ma sœur puisse venir aussi. Mes cheveux sont soigneusement peignés avec un peu de gel, quand je les touche et que je les sens durcis dans ma main mon cœur s’emballe. Combien d’hommes vais-je rencontrer ce soir ? Lequel me plaira ? Y en a-t-il un qui me plaira ? Comment s’appellera-t-il ? Quel visage aura-t-il ? Je l’imagine brun avec une barbe naissante. J’aime sentir le froid sur ma peau et entendre le vent qui court dans les branches. Avant, je traînais dans le quartier, je passais tous mes après-midi dans les bois ou au terrain de foot. C’est là que j’ai rencontré Virginie. Elle était belle, elle tapait fort dans le ballon, au départ j’ai cru qu’elle me plaisait. J’avais peut-être onze ou douze ans. On regardait tous les après-midi la télé on mangeait des pizzas, ma mère ne disait rien, elle nous laissait faire. À cette époque-là, où peut-être un peu plus tard je me suis percé les deux oreilles pour elle. Prend-moi là main mon amour, je ne sais plus où regarder. Le bois s’éloigne, le train s’approche. J’entends peu à peu les vrombissements de la ville et les voitures qui roulent tout près de moi et l’odeur nauséabonde de leurs pots d’échappement qui passent tout à côté de mes narines. Virginie prend-moi dans tes bras. Ce que tu vas me faire découvrir ce soir je me demande parfois à quel point j’en ai envie et à quel point je le fais pour toi, par amour pour toi. Prends ma main. Attendons le train, ses lumières jaunes, son bourdonnement électrique, cette gare désespérément vide un samedi soir. Attendons, le temps que monte en moi l’excitation. Que je ne regarde plus ces yeux ni cette bouche, mais celle d’un autre qui m’aura conquis. C’est sûr ce soir je ne rentrerai pas. Le train arrive, on grimpe, le trajet passe, les lampadaires se succèdent à une vitesse folle sans que je puisse les distinguer, tu regardes ton portable, tu souris, ton rendez-vous de ce soir est fixé. Je te connais, ce soir, arrivé dans la boîte, tu vas me lâcher pour en rejoindre une autre. Pourquoi est-ce que nous ne faisons pas notre vie ensemble Virginie ? Tu me regardes, je te regarde, tu me souris, nous descendons du train. Il est minuit et demi, mes jambes ont du mal à me tenir. Si on allait manger quelque chose d’abord.
- « On a plus le temps, après je vais devoir payer. »
Tant pis. Je retourne chez moi… Non je reste, tout vaut mieux que là-bas. Mon père me regarde encore et sur le pas de la porte ses yeux embués pleurent de n’avoir pas produit un homme à son image.
Nous voici devant l’entrée. Je ne veux plus y aller. Qu’est-ce que je viens chercher ici ? Des hommes je peux en rencontrer partout, dans des bars, la journée, Paris en est plein. Ici tout ce que je vais gagner c’est de me faire draguer par des vieux cons qui ne voudront pas de moi. Virginie on rentre, allez viens on rentre.
Comme il fait noir, comme il fait chaud. Premier réflexe, se déshabiller. Je n’ai plus que dix euros pour me payer un verre. Les lumières m’assomment, je ne vois plus rien, où es-tu Virginie ? Pourquoi ai-je la fâcheuse impression que je suis déjà venu ici et que je connais ce lieu par cœur ? Toi, tu t’appelles Jeff ?
- « Salut, tu veux aller danser ? »
Non merci pas tout de suite Jeff, une prochaine fois. D’abord aller prendre un verre, prendre un peu d’assurance, parler avec quelqu’un, Tiens, Virginie.
- « Alors ça te plait ? »
- « Oui ça va c’est pas mal »
- « Tu vas voir là encore c’est rien. D’ici une heure ce sera blindé de monde. »
C’est déjà bien chargé. Il y a un homme derrière le bar, il veut m’offrir un verre. Je ne le regarde pas, il ne me voit pas et tout va pour le mieux. Virginie me parle.
- « Tu veux aller danser ? »
Je suis le mouvement, mais je n’ai pas assez bu, un seul whisky coca.
- « Peut-être qu’on devrait y aller. »
- « Allez, tu rigoles, détends-toi. »
Je danse un peu, je bouge mes pieds et surtout mes mains, la lumière est si forte je n’y comprends rien. Tous ses yeux braqués sur moi même dans le noir. Je les sens, je transpire. Si tu t’approches de moi, je te touche et je te prends la main, mais il s’en va. Dehors, il fait nuit, il fait froid, j’irai bien prendre l’air.
- « Eh, toi tu restes ici. »
Virginie me prend par la main. On peut encore fumer dans cette boîte, les vigiles ne disent rien alors je lui prends une cigarette. Je n’aime pas ça, mais j’en ai besoin, j’ai besoin de quelque chose qui m’occupe les mains. Alors que je l’allume, un homme s’approche tout près de moi et me frôle le dos. Je ne le vois pas.
- « Il est plutôt beau. »
- Je me retourne. Il est parti.
« Dommage, je le connais. »
L’excitation monte. Mes doigts frémissent. Je dois toucher quelqu’un. Encore Virginie. Allez va-t-en maintenant. Je la pousse, elle s’en va rigolant, revancharde et vexée. Elle a de l’argent pour s’acheter un autre verre. Je suis tout seul au milieu de la piste ou plutôt à l’extrême gauche de la piste. À ce moment précis je suis seul, enfin je crois. C’est à moi de faire le premier pas. Je regarde autour de moi. Mon œil est immédiatement attiré par un garçon en T-shirt blanc aux cheveux longs et soyeux. Il ne me regarde pas, il danse avec un autre, cela n’empêche rien, ils ne s’embrassent pas et même s’ils s’embrassaient… Je fais deux pas vers lui et je me remets à danser, une main me frôle, c’est lui, l’ami de virginie, je le sens à sa manière douce de toucher. Qu’est-ce que je fais ? Sois je me retourne et j’embrasse cet homme que je ne connais pas et à qui manifestement je plais, sois je tente ma chance avec ce beau garçon là-bas qui à l’air d’avoir à peu près mon âge et qui se désintéresse totalement de moi. Voilà qu’il m’a pris la main et je me laisse faire. Je suis sûr que Virginie nous regarde. Qu’est-ce que je suis supposé faire ? Me laisser faire ? Il remonte le long de mon bras. Je me laisse faire. Il s’étend sur moi, je me laisse faire et je ferme les yeux. Il remonte le long de mon cou, il frôle ma bouche et moi je ne dis rien, je ne fais même pas un imperceptible mouvement pour lui montrer que ça me plait. Je ne sais même pas à quoi il peut ressembler, je ne sais pas quel âge il a, je ne sais pas s’il a toutes ses dents et tous ses beaux cheveux bouclés. Qu’est-ce que je porte en dessous ? Il va m’embrasser, il va m’embrasser, il m’embrasse et je fonds. Comme sa bouche est sensuelle, comme ses lèvres sont épaisses et comme ses mains sont douces. Je ne peux que me laisser faire. Il est grand, il me dépasse au moins d’une tête, peut-être qu’il porte des talons, il ne faut pas rire. Il m’embrasse longtemps et bien et puis je le regarde. Depuis longtemps Virginie est partie. Il a un petit nez fin, des yeux noisette, un visage pâle, il est grand et beau, je le contemple dans toute sa hauteur. Il m’emmène dans un coin de la boîte, on recommence à s’embrasser, il ne me lâche plus, il m’a trouvé, tant pis pour le petit blondinet racoleur. Comme sa langue sent bon et comme elle est épaisse. Je fourre mes doigts dans les siens, il fourre ses doigts dans les miens. Un bouton saute, une caresse sur l’oreille. Un bouton saute, j’entraperçois sa peau vermeille. Un bouton saute, je me cambre pour l’embrasser, un bouton saute, il vient à son tour me lécher. Il n’y a que toi et moi et les étoiles. Tout le reste n’existe pas. Je sens ta main se promener et je ne vois rien d’autre. Dans ce moment d’innocence oubliée, ma peau profonde est comme ce mur lézardé dans lequel la pluie s’engouffre. Je ne reconnais plus rien, ni tes yeux, ni ton visage, je ne sais même pas qui tu es et je t’aime.
Il se fait tard, il faut rentrer. Depuis longtemps Virginie est partie, avec une autre. La musique se fait de plus en plus forte. Mon bellâtre se range et s’en va. Il ne reste plus que moi et la bande de travestis qui défilent sur le podium.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Barman le 8 Octobre 2012 à 09:30

Daniele Tournié, l'étoile du jour.
Depuis plusieurs années, j'habite Paris, je travaille en Normandie, et donc je prends le train, souvent. C'est dans cet espace propice à la rêverie que je lis, que j'écris. Un thème, une idée, une image et l'histoire se construit, d'abord en pensée que j'essaie de noter vite sur des papiers épars pour éviter l'oubli. Un concours c'est un petit défi, avec à la clef peut être le plaisir d'être lu, le plaisir d'avoir retenu l'attention. Merci à vous, je continuerai de prendre le train...
Enracinés !
Ma mère le dit souvent, faut que t’ailles voir ailleurs mon gars ! Va bien falloir sortir du bois un jour ! Ma mère c’est une bonne mère mais elle se rend pas compte, c’est pas facile, je sais pas, je suis jamais parti, le plus loin c’est Rouen. Après je connais pas. Elle répète, pour rencontrer du monde faut sortir, bouge-toi un peu ! Mais moi j’ai pas tellement envie, je suis bien ici. J’ai tout ce qu’il faut, la maison est grande, on se gêne pas. J’ai toujours vécu là, c’est mon père qui a acheté la maison, il avait envie d’une famille nombreuse, unie, on s’est installé ici à cause du jardin, du potager et des pommiers, dans la maison il savait tout faire, la peinture, le carrelage, le papier peint, je m’en souviens de ça. Mais il a pas eu le temps de vivre, j’avais huit ans quand il est mort, accident de travail, accident d’échafaudage à ce qu’il parait… c’était un bon père, travailleur, pas sévère du tout, bien sûr on le craignait, faut ce qu’il faut, les parents ça se respecte. Je suis le seul gars de la famille, d’abord Aurélie, Sarah, puis moi puis Aline. Mes sœurs ainées elles aident bien ma mère, et pourtant elles ont fait des études, elles aiment la ville, le cinéma, elles ont des copains mais ils ne viennent pas souvent ici. Moi aussi bien sûr j’aide dans la maison, mais je suis un garçon je préfère le jardin, le bricolage, c’est moi qui fait le bois, j’aime ça, couper le bois à la hache, faire des murs de buches bien rangées, c’est beau et ça sent bon, c’est un travail d’homme, après on est bien content l’hiver. Je suis bien ici, me croyez pas coupé du monde, juste à côté on peut dire, en retrait, d’accord j’ai toujours été timide, à l’école du village j’avais un peu de mal, je suis pas feignant mais j’y arrivais pas vraiment, je croyais avoir compris et paf c’était pas ça, ou alors j’apprenais mes leçons et le lendemain disparues, problème de mémoire ! Alors je me débrouillais, j’improvisais, fallait pas trop me parler de devoirs, ce que j’aimais déjà c’était les champs et les animaux, dés que j’avais un moment j’allais à la ferme voisine, oui, celle là même où je bosse maintenant, je venais voir les vaches, j’aidais la patronne à les rentrer le soir, en été j’allais faire les foins. Maintenant je suis en apprentissage chez eux, en alternance plus ou moins, il y a vraiment beaucoup de travail dans une ferme! J’ai beaucoup appris, mais ce que j’aime c’est l’espace pour la solitude : je m’exprime pas bien, ce que je veux dire c’est qu’ici, je suis la plupart du temps seul, avec les bêtes, et personne avec qui m’embrouiller. Ça me va, personne me juge, personne m’attaque. Allez pas croire que je sais rien de la vie ailleurs ! je lis quand même ! on a la télé, on a internet, et ça, c’est pratique pour discuter. Ma mère elle dit c’est pas des vraies rencontres ! Peut-être, mais je m’entraine. On parle, on s’écrit, un jour peut-être on se donnera rendez-vous, mais où ? Les villes me font peur, c’est plus facile pour moi de me diriger dans la campagne, plus facile de retrouver ma direction. Là bas, j’aurai l’air de quoi ? Perdu ! j’ai déjà vu la foule dans les gares de Paris à la télé, les manifs sur les boulevards, impressionnant… faut se frayer un passage comme dans les fourrés. Je sais qu’en ville, il y a des bars, des magasins pleins de marchandises, des théâtres, mais il faut de l’argent! Tout est cher, c’est comme un autre monde, certains y sont heureux sans doute. Non, je préfère rester ici. J’aime l’ombre des tilleuls, des acacias au printemps. J’aime les ormes qui bordent les cours des fermes, on est à l’abri du vent, protégé. Une double rangée de hêtres anciens, on a moins froid, c’est beau… Il y a quelque temps on est allé à la plage, avec ma sœur Sarah et son petit ami, du côté de Fécamp, là-bas y a que des galets, la mer grise et le ciel nu. On s’est assis sur un banc, pas même en maillot de bain, faisait pas bien chaud et j’ai un bronzage agricole comme dit l’autre qui se prend pour un séducteur, avec son jean moulant et son polo de marque. Ils ont retrouvé d’autres gars et des filles, elles riaient des blagues des garçons qui les draguaient, j’ai bien vu, moi je savais pas quoi dire, c’était des inconnus et le copain de ma sœur je le sens pas, il me regarde de haut ou alors je me fais des idées, enfin je suis resté sympa pour ma sœur. J’ai fait celui qui s’intéresse au port, aux marées. Avant les bateaux partaient de là bas pour la pêche à la morue. Des hommes des jours et des jours ensemble entre le ciel et l’eau. J’aurais aimé peut-être. Maintenant c’est trop tard, y a plus de chalutiers ni de marins terre-neuvas depuis longtemps et puis vivre des mois entiers avec un groupe d’hommes non j’aurai pas pu. Mon père n’aimait pas la mer, il s’en méfiait, la voleuse d’hommes il l’appelait, il y a des histoires qu’il n’a pas eu le temps de me raconter mais je sais que son père à lui était marin et qu’il a disparu… disparu en mer un jour ordinaire de pêche alors qu’une femme et un enfant l’attendaient. Ils l’ont espéré longtemps. Mon père a grandi seul auprès de ma grand-mère. C’est drôle, j’ai pensé à mon père en longeant la plage. Avec ma mère, des années plus tard, ils se sont installés sur le plateau, ancrés à la terre. Aujourd’hui, à la maison, il n’y a que des femmes, et moi. Avec mes sœurs on s’entend bien, mais c’est aussi qu’on se soutient, on a besoin les uns des autres. Les ainées elles partiront sans doute, elles parlent de travail, d’indépendance, je vois bien les gars qui viennent les chercher pour sortir, ils ont qu’une envie c’est de les emmener. L’autre jour encore, des copains de Sarah sont passés, ils fumaient dans la maison, tranquilles (ils savent bien que ma mère n’aime pas qu’on fume à l’intérieur), ils ont dit on s’arrache, et à moi : tu viens ? J’ai répondu non. J’avais pas envie. Ils ont haussé les épaules et sont partis, ma mère après, elle a repris son refrain comme quoi je devais sortir, faire l’effort de sortir, prendre l’air, que c’était malsain de rester toujours ici, trop étroit, qu’elle supportait pas de me voir, un gaillard comme ça sans ambition, que c’est le premier pas qui coute… je trouvais qu’elle exagérait, on s’est disputé, j’ai dit cherche pas c’est comme ça, je bosse à la ferme voisine, j’ai le droit de me reposer non, de rien faire parfois, plus tard on verra, j’ai tout ici, pourquoi aller plus loin ? Elle insistait, faudra bien sortir du bois mon gars, la vie c’est comme ça, tu vas pas attendre ici immobile que les filles viennent te chercher, et le boulot ! Le destin faut lui donner un petit coup de main… Elle regardait par la fenêtre, avec sa figure comme rabougrie, elle a répété ça : sortir du bois, comme si je me cachais, m’agrippais aux branches, aux racines, à l’ombre, elle marmonnait, Aline, qu’est ce qu’elle va devenir ? J’ai pensé, Aline, on se comprend, on a les mêmes délires, les mêmes peurs aussi, parfois les mêmes envies au même moment, les mêmes secrets. On peut rester des heures ensemble à écouter de la musique dans la chambre ou à marcher dans les champs autour de la maison. On s’amuse de rien. Elle est jolie ma sœur, très douce, très sensible. Il ne faut pas dire du mal d’elle, elle a besoin qu’on la protège. Y en a qui disent qu’elle est simplette, c’est qu’ils ne la connaissent pas. Quand les grandes ne sont pas là, que la mère travaille, elle m’accompagne à la ferme, elle ne fait rien, elle regarde. Elle n’aime pas rester seule. La nuit elle a peur dans le noir, faut dire que la maison est un peu isolée de la route et du village, c’est pour ça que nos chambres sont jumelles, mais la plupart du temps on est dans la sienne. La mienne est plutôt simple, pas décorée, quelques mangas, faudrait changer peut-être mais je m’en fous! Elle, elle aime les affiches de cinéma, avec des stars américaines qu’on rencontre jamais dans la vie, mais c’est sa zone de rêves. Ma mère elle dit qu’il faudrait dormir chacun dans sa chambre et fermer les portes, elle parle de pudeur, qu’à quatorze ans c’est une adolescente, une jeune fille et que moi l’ours, je devrais aller voir ailleurs. J’aime pas quand elle parle comme ça ma mère, qu’elle me traite de curieux, d’adolescent obsédé, qu’elle me traite comme un animal, elle a des mots crus. À Aline elle répète qu’elle va la mettre en pension, qu’il est trop tôt pour aller voir le loup. Moi, je sens bien qu’elle voudrait que je parte, que j’aille courir le monde. Elle rabâche que ça ne se fait pas, pas dans la famille, même si on a l’habitude, qu’on risque un bâtard ! mais nous si on a un enfant on l’appellera Dylan si c’est un garçon, mon père il aurait aimé. Si c’est une fille, je sais pas. Alors, je crois que je vais rester encore un peu.
 2 commentaires
2 commentaires
-
Par Barman le 4 Octobre 2012 à 13:00
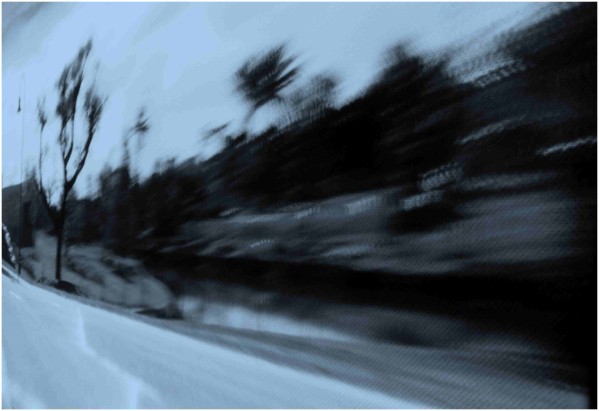
Marine Louvet, l'étoile du jour
À la lecture du thème « Sortir du bois » m’est apparu immédiatement le bois à côté duquel j’ai grandi et la curiosité que provoquait chez moi, très jeune, ces camions avec aux volants des femmes, toujours à l’arrêt. Être dans un véhicule qui ne roule pas me paraissait être un paradoxe intéressant dont j’avais envie de rendre les contradictions. D’autre part, j’avais envie d’écrire ce qui pouvait se passer dans la tête d’une femme qui se prostitue, mais dont les pensées sont simples, communes, changer d’air. De son camion, cette femme observe le même décor depuis des années et elle en est fatiguée. Le déplacement des corps autour d’elle et en elle est une danse qui a cessé de l’intéresser, elle n’a plus envie d’être spectatrice des mouvements d’autrui, mais d’elle-même se mettre en mouvement et enfin, de sortir du bois. C’est un jour du quotidien de cette femme que décrivent ces pages, le jour où elle décide de « Passer la première ».
Passer la première.
Je crois que je n’ai pas rêvé cette nuit-là. La lumière du jour désépaissit les tissus étendus sur le pare-brise. Je n’ai pas froid. La couverture a coulé entre mes cuisses. Les seins et les épaules sont dénudés, l’air est doux. Une légère buée s’est dessinée sur les vitres et à travers, la route est vide. Deux longues bandes noires à l’infini brimées de pointillés blancs et distincts, comme des points de suspension.
J’écarte du bout des doigts le tissu tendu le long du pare-brise pour laisser passer la lumière. Il fait froid dehors. Le jaune se coule doucement jusqu’au gris de la terre. L’horloge indique six heures dix-sept et le miroir une courte nuit. Les traits sont tirés et noircis de maquillage comme pour toujours. Plus aucun démaquillant n’en viendra à bout, le noir s’est incrusté dans les pores jusqu’à devenir peau. Le rouge à la commissure des lèvres les fond, incertaines, au reste du visage. Unique solution pour contraster le tout, redessiner des contours clairs, stricts, perceptibles et droits, un masque artificiel et sans bavure, en remettre une couche toujours, qui a terme viendra s’ajouter aux déjà si bien logés, indélébiles, noir et rouge.
Alors, je reprends le noir, le rouge et trace les contours du visage. De l’intérieur de la paupière vers l’extérieur, un trait noir obscur qui redessine l’œil, rouge, pour le trou béant de la bouche.
À l’arrière du camion, un gant se faufile dans les recoins du corps. Aisselles, entrejambes, lèvres, raie des fesses, arrière des genoux, cuisses, peau, ventre, entre les seins. Les odeurs des autres se ravivent dans le mouvement et remontent par intermittence aux narines. Les traces invisibles des mouvements, des baisers, des coups de reins et de langues inventent une cartographie, une expérience cachée, un vécu des bas fonds, des gémissements, des rumeurs et des râles sur le corps indemne.
La peau sèche, je glisse le long de mes jambes des bas de couleur chair, illusion sur les taches, les varices, les rougeurs et les bleus. Ce geste, bien que je l’aie fait mille fois, me plaît toujours. En coulisse, la caméra suit le geste de mes mains habillant mes jambes de ce voile de peau. Même au plus bas, ces bas m’ont toujours donné l’impression de tout effacer, de repartir de zéro. Vierge. Acheter ma paire de bas. Je passe deux doigts sous les fils sensibles pour en connaître l’épaisseur et choisis une maille matte, proche de la couleur des bas de contention. Souvent, je ne mets pas de chaussures, mes pieds sont nus sur les pédales du camion et j’aime la sensation de faire glisser la texture du collant contre les pédales. Dérapage. Je roulerais pieds nus.
Une combinaison et un peignoir couvrent le haut du corps. Noire, la combinaison. Juste ajustée, contenant la viande. Le peignoir en soie synthétique a quelques petits motifs irréguliers qui ne représentent rien. Le nœud noué, je passe une jambe puis l’autre par-dessus la boîte à vitesse et me laisse couler place conducteur.
Bougie allumée, prête. Les tissus ont glissé jusqu’au bas de la vitre avant et la lumière a envahi mon navire. Je ferme les yeux et me laisse aller à la chaleur qui trace ses ombres sur mon cou et ma poitrine, entre les arbres. Une femme traverse la route désertée en diagonale avec son chien au bout d’un fil. La bête galope plus vite qu’elle qui traîne les pieds, une cigarette laissant derrière elle des effluves de fumée blanche. Le temps d’ouvrir et de fermer les yeux et la silhouette a disparu dans les arbres. Les joggeurs à leur tour commencent à apparaître, traversant ma route à des rythmes variés. Les rodés, iPod collé au triceps, déboulent sur la route comme s’ils ne faisaient que ça de leur vie, les femmes qui viennent de s’y mettre trainent derrière elle un amas de graisse qui les ralentit franchement, moulés dans des caleçons terribles, le buste en avant et l’arrière-train en queue de train, les couples, elle, la queue de cheval au vent, lui l’écoutant en souriant, se demandant quand est-ce qu’elle comprendra qu’on ne parle pas quand on court, les jeunes filles sportives, fines comme des danseuses, les vieux beaux, les refaites, les coups d’un matin, les weekends et les quotidiens.
D’autres viennent suer autrement. Entre mes jambes, entre mes reins, entre mon cou et ma nuque, entre mes seins. Ceux-là aussi sont tous différents. Première fois, fidèles, honteux, heureux, violents, lourds, fins, rapides, interminables, propres, doux, sales, aimant, méprisant, bavards ou silencieux, grosses, petites, courtes longues, des corps à n’en plus finir d’être différents et mêmes, beaux, indésirables, laids et désirables, sensuels et raides. Passés par hasard, venus à pied, traversant le bois, se garant à quelques mètres derrière moi, de l’autre côté, du bois, venant en transport, en vélo, seuls, mariés, avec ou sans enfants, toujours le même désir de se vider, la tête, en suant un peu.
Je m’assoupis laissant divaguer ces idées dans ma tête quand la carcasse sonne trois coups à l’arrière. Le premier. Enfin le suivant, car il n’y a ni début, ni fin. Je jette un coup d’œil dans le rétroviseur et y aperçois un gaillard habitué. Il porte le fidèle duo casquette et clope au bec. Je souffle la bougie, tire un peu le rideau sur le pare-brise et me glisse à l’arrière pour lui ouvrir les portes.
Sourire penaud, il a l’air plutôt content ce matin.
— Ça va ?
— Bien et toi ?
— Ça va.
— Bien dormi ?
— Peu.
Entre les mots, il se déshabille sans me regarder, sous mes yeux. Le voilà nu comme un ver. Celui-ci s’est toujours déshabillé jusqu’à la dernière chaussette, enlevant jusqu’à sa montre et son alliance, déposant toujours le contenu intégral de ses poches sur la tablette. Manière de montrer patte blanche, de se vider totalement, de ne laisser de trace que sur la peau. Alors que d’autres se contentent d’ouvrir et de fermer leur braguette. Je me hisse à l’avant, souffle la bougie, tire le tissu du pare-brise. Il s’allonge sur le petit matelas et me fait signe de m’asseoir sur lui.
Il commence le va-et-vient universel, l’égalisateur de conscience, la grande danse de tous les temps, la danse du meilleur et du pire, le grand mouvement infini, inscrit dans tous les corps, dès le début. L’originelle, si peu originale corps à corps. Toutes les femmes pénétrées, tous les hommes pénétrants, toujours et encore jusqu’à la fin. En mourir. Mourir comme ça, dans le va-et-vient, dans cette danse sans fin, sans faim, sans saveur, sans goût, dégoûtée. Allée et venue, elle aussi. Les yeux fermés, sur une route, où ce même mouvement se répéterait à l’infini. Un va-et-vient qui tracerait ses marques sur le bitume, le lisserait jusqu’au noyau de la terre, jusqu’au fond du ventre.
Contractions. Crispations. Fin. Des gosses passent et donnent des coups sur la carcasse, en courant dans les graviers, en riant. Il sourit. Je lui tends un mouchoir humide. Il fait glisser le préservatif, le jette dans la corbeille à cet effet, se passe le mouchoir sur le front et commence à se décorer, l’animal. Montre, alliance, un coup de peigne, slip, t-shirt rentré dans le pantalon, ceinture serrée. Ni vu, ni connu. Il me glisse les billets dans la main et dit sans me regarder : « À la prochaine. » « Bonne journée », je réponds. Belle journée, oui. C’est le gros départ, on jette l’éponge, on lève l’ancre, on abat les cartes. C’est le grand schelem. Je m’affale sur le lit d’appoint, bois une gorgée d’eau. Le ciel est bleu.
Je passe la première et accélère un bon coup sec sur la route vide. Une allée d’honneur se dessine des familles avec leur poussettes et leur vélo s’écartent pour nous laisser passer moi et mon camion, tout droit sur la grande route, tout droit, tout droit, le long des points de suspension, jusqu’à ce que je puisse plus aller plus loin, jusqu’à la panne, la mer, l’accident, tout droit, sur la route à toute vitesse. Les images défilant de chaque côté des vitres et la route disparaissant sous mes roues, sous moi, la possédant. Des décors de toutes les couleurs. Fini les feuilles, les arbres morts, les bourgeons naissants, l’interminable vert du bois, les mêmes ombres des feuilles, les mêmes arbres, le soleil levé toujours du même côté, couché de l’autre, les odeurs d’herbe mouillée, la rosée du matin, le glapissement heureux des oiseaux. Fini les corps écroulés après le râle, incapables de se mouvoir, fausses caresses, les mous, les pas décidés. Fini les flics à pas d’heure venus combler l’ennui de nuits vides de mal. Fini l’odeur écœurante du latex, la vaseline, les regards droits dans les yeux, les fantasmes. Fini le sommeil mouvementé par des impromptus, des perdus, des passés par hasard, des puceaux et des traves. Fini les insomnies, la peur, la violence et les coups. Fini la nature qui dort, le silence des arbres, des feuilles, du grouillement des insectes, qui dorment, de la vermine qui courent là-dessous. Fini les regards curieux, les doigts pointés, les doigts d’honneur, les coups de langue dans la joue, les grimaces salaces et les échos de jouissance. Fini le boulot. Je mets les voiles. Je tire le rideau.
Ce matin, j’étais clairement décidée à aller faire mon trou ailleurs.
 2 commentaires
2 commentaires
-
Par Barman le 1 Octobre 2012 à 08:00

Eve Roland, l'étoile du jour
Je suis née près d'un fleuve qui m'a laissé le goût des paysages étales et de la rêverie.
Enfant des années soixante, je vis et travaille aujourd'hui à Paris.
Entre les deux : la vie.
"La vie est décousue", dit André Dhôtel.
J'aime explorer de nouveaux horizons. Etre là où on ne m'attend pas. Faire l'école buissonnière…
J'écris pour lier entre eux les morceaux du patchwork.
Loupiotte
Elle est sortie à la nuit.
Elle a attendu que tous les bruits s'éteignent autour de la maison : celui des volets aux maisons voisines, l'aboiement d'un chien remorquant son maître à la rituelle promenade du soir, le coup de freins d'une voiture au carrefour.
A présent, tout est silencieux. A peine si depuis le rez-de-chaussée lui parvient le ronronnement du réfrigérateur qui trône dans la cuisine, dernière acquisition de sa mère, chef de rayon Arts ménagers au Grand Bazar de la bourgade voisine.
Margotte entrouvre la porte de sa chambre et se faufile dans le couloir. Elle a passé sur son pyjama un gros pull et un pantalon, enfermé ses cheveux dans un bonnet qu'elle enfonce jusqu'aux sourcils. Ses chaussettes dans une main, un sac de toile dans l'autre, elle descend l'escalier dont les marches, cirées de frais, glissent un peu sous ses pas.
Dans son lit en 110, sa mère ronfle déjà.
Margotte a atteint le vestibule, enfile ses chaussettes et une paire de bottes.
Penser à prendre les clés, déverrouiller la porte.
Elle est dehors. La porte s'est refermée sans bruit. Serrant son sac contre elle, Margotte se hâte vers la grille qui s'ouvre d'une poussée. Elle a graissé les gonds cet après-midi.
La nationale déserte s'ouvre devant elle. Tout au bout, il y a le village où brillent encore quelques pâles lumières jaunes. Mais elle n'ira pas par la route. Trop dangereux, quelqu'un pourrait la voir, une voiture attardée, des fêtards, un voisin.
Elle prendra par le bois à droite de la maison.
C'est la première fois qu'elle emprunte son raccourci favori de nuit. Une lune bien ronde éclaire sa promenade solitaire ; dans son sac, elle a glissé une lampe électrique, au cas où. Sa mère lui aurait sûrement recommandé de se munir d'une bombe lacrymogène. Sa mère ne l'aurait pas laissée sortir de nuit. Sa mère a peur de tout.
Seul dans la chambre froide, monsieur Wolf caresse les gigots, soupèse les tendrons, effleure les filets d'une main adoucie par la graisse… Il saisit un train de côtelettes, trousse une papillotte, aligne croc après croc les quartiers de boeuf qui partiront demain, à la première heure, chacun portant, encré dans sa chair, le prénom de sa destinataire — une idée qu'il a eue, une coquetterie, ses clientes en raffolent. Denise, Soizic, Clémence, Monique… Monsieur Wolf soupire. Le parfum des viandes se mêle, dans son souvenir, à celui plus intime de ses fidèles pratiques.
Mylène et son goût poivré, Julie et son odeur de pain tiède, sa peau élastique. Simone… Monsieur Wolf enivré étreint une douce épaule. Suce ses doigts. A chaque fois qu'il pénètre dans la chambre froide, son coeur bat comme avant un rendez-vous.
Margotte est blonde, de cette blondeur des filles sages, un blond si pâle qu'il en est presque blanc. Par contraste, sa peau paraît encore plus rose, comme celle d'un petit cochon plaisante monsieur Wolf à chaque fois qu'elle entre dans sa boutique, envoyée par sa mère chercher un morceau de lard ou un bifteck haché. La boucherie sent le plat mijoté, le poivre, la sauce au vin et une odeur plus fade, plus insidieuse, qui se cache derrière celle de la langue sauce piquante ou du bourguignon, mais tenace et toujours, toujours présente. Une odeur qui, Margotte le pressent, a à voir avec la couleur rouge des quartiers de viande qu'elle surveille du coin de l'oeil, ces plats de côte, ces filets qui pendent lourdement au bout de crochets de fer et dont elle redoute que, par quelque abominable tour de passe-passe, ils ne se détachent et ne viennent s'affaler, plafff, en plein sur ses épaules. Alors, elle les rentre, ses épaules, elle se fait toute petite, elle qui n'est déjà pas bien grosse. Ce que voyant, monsieur Wolf part d'un rire — ah, ce rire : un rire aux profondeurs de caverne, un rire venu du ventre, qu'il a plat et sonore comme une peau de tambour. Parfois, entre deux clientes, lui prend la fantaisie d'y improviser un petit air d'une main désinvolte, boum boum, boum boum. Ces dames applaudissent : Ah ! Monsieur Wolf… Antonin… (car elles l'appellent par son prénom, elles ne se gênent pas, pourquoi se gêneraient- elles ? Chez monsieur Wolf le client est roi, et la cliente, ah la cliente…). Un rire, enfin, qui désigne Margotte à toutes les pratiques réunies en une pieuse file d'attente, à ces grosses dames berçant entre leurs cuisses des paniers débordant de légumes, de fruits et de miches odorantes. Bouche entrouverte sur de petites dents pointues, elles attendent le moment où monsieur Wolf (Antonin), se consacrera tout à elles et, l'oeil câlin, jettera sur le marbre la chair sanguinolente qu'il détaillera d'un geste sûr. Inévitablement, l'une d'elles se penchera sur Margotte et, arrondissant la bouche, sussurera d'un air entendu : Ma pauvre petite, il t'en faudra des biftecks
pour devenir grande et forte !…
Margotte se fiche de devenir grande et forte. Elle jette un oeil en biais à ces femmes qui la toisent, à leurs doigts boudinés dont les bagues mordent la chair et font saillir un bourrelet, à leurs ongles carmin fouillant un porte-monnaie aussi rebondi que leur croupe sous la jupe serrée ; à Monsieur Wolf qui découpe, désosse et lève les filets avec des grâces de danseur.
Enfin, c'est son tour. Le boucher détaille prestement deux morceaux de bifteck, les jette dans le hachoir et presse un bouton de son index trop rouge. Les dames suivent ses moindres gestes, recueillies comme à la messe. Dans sa paume arrondie, Monsieur Wolf cueille le steak haché de frais, le dépose sur une feuille de papier sulfurisé qu'il replie prestement. Il le tend à Margotte comme on offre une fleur rare et lui tapote la joue d'une main velue.
— C'est d'un tendre, ça, d'un tendre…
Sous la moustache effilée, sa bouche a un sourire gourmand. Mais entre les canines pointues brille le reflet menaçant d'une dent aurifiée. Les dames gloussent en choeur. Margotte s'enfuit sans demander son reste.
La forêt est si sombre qu'on n'y distingue pas le sentier, mais Margotte ne se sert pas de la lampe. On dirait qu'elle connaît les moindres creux et bosses du terrain pour avancer ainsi les yeux fermés. A moins qu'elle ne cherche à se rendre invisible, à se fondre dans l'obscurité — et c'est bien ce qui se passe : à mesure qu'elle s'enfonce dans le bois, le bonnet rouge, le pull rouge, la peau blonde disparaissent, happés par la nuit verte.
Bientôt le bruit de ses pas se confond avec les craquements de la forêt alentour.
Margotte est devenue herbe, rameau, brindille…
Du moins le croirait-on s'il n'y avait son coeur qui bat si fort et résonne sourdement à travers le sous-bois, au risque d'éveiller les bêtes endormies.
Monsieur Wolf pose ses mains bien à plat sur le billot de marbre. Il sait que ses mains leur
plaisent, que ses clientes se battent à qui sera la première, chaque matin, dans la boutique où il les attend — comme il espère, à cette heure de la nuit, celle qui viendra se presser sur son coeur.
D'un coup d'oeil, il embrasse escalopes, côtelettes, côtes de boeuf, plats de côtes au garde à vous. Un grand week-end s'annonce. Qui sera la première ?
— Et votre morceau préféré, à vous, Antonin ?
Le boucher adresse au souvenir de sa cliente un regard amoureux — Solange ? Christine ? — puis tranche d'un coup sec une lanière de viande crue et la porte à sa bouche. Véronique ?… Monsieur Wolf hume les galantines, le saucisson de Lyon, la rosette, la Morteau. Il fait aussi un peu de charcuterie pour plaire à ces dames. Mais c'est la viande qu'il préfère : les longs quartiers de boeuf presque aussi grands que lui, les carcasses qu'il étreint, narines palpitantes. La douceur de leur chair l'émeut. C'est un sentimental.
Il n'y a pas si longtemps, à la sortie des classes, Margotte a surpris la conversation de trois de ses camarades : l'une d'elles racontait qu'Isabelle G., à l'automne dernier, avait croisé monsieur Wolf dans le sous-bois et qu'ils étaient allés "aux champignons" ensemble. Isabelle en était revenue toute décoiffée.
Les filles ont gloussé. Margotte a froncé le sourcil, Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Les autres l'ont pris de haut : Tu ne peux pas comprendre ! Elles ont ri, bombant le torse, exhibant sous leur pull ces grosses bosses qui les font ressembler aux clientes de la boucherie.
La nuit suivante, Margotte a rêvé que monsieur Wolf plongeait son grand couteau dans le ventre d'Isabelle G. Elle s'est réveillée, suffoquée, en nage, les mains crispées sur son bas-ventre. Elle a poussé un cri.
Sa mère a déboulé : Qu'est-ce qui t'arrive ?
Margotte s'est mordu les lèvres, contenant à grand-peine un tremblement nerveux. Comment dire à sa mère la tache de sang qu'elle venait de découvrir sur le drap, son rêve et monsieur Wolf ?
Elle a remonté les couvertures sous son menton et grogné : Rien, rien… juste un mauvais rêve.
Sa mère a haussé les épaules : Une grande fille comme toi…
Tout le reste de la nuit, Margotte s'est efforcée de garder les yeux ouverts par peur de retrouver le cauchemar qui lui faisait perdre son sang.
Un frôlement — elle sursaute. Une aile est passée sans bruit tout près de son visage. Margotte extraie vivement du sac la lampe qu'elle brandit devant elle et hâte le pas.
La voici à l'orée du bois. La lune projette un cercle laiteux exactement au centre de la clairière.
Margotte s'arrête. La lampe se balance au bout de son bras.
Le regard de la lune s'attarde sur les joues tendres, les mèches dorées, la bouche petite et ronde. Changeant son sac d'épaule, Margotte rajuste le bonnet de laine sur sa tête et avance d'un pas.
Ici, le sentier se divise en deux.
Un chemin qu'elle emprunte fréquemment : celui des mûres à confiture.
Un autre qu'elle n'a jamais exploré.
Monsieur Wolf referme soigneusement la chambre froide, enlève son tablier et se rince les mains. Un bruit venu du dehors lui fait tourner la tête. Un petit bruit de rien du tout, à peine plus fort qu'un soupir — mais monsieur Wolf a l'ouïe fine et la sensibilité exacerbée.
Le bruit reprend. Une plainte, un miaulement, un couinement à peine modulé, oui, c'est cela — comme le gémissement d'un petit animal. Comme celui de l'agneau qu'il a égorgé la veille et qui git désormais, proprement désossé, découpé et paré, offert aux convoitises de ces dames sur un plat de porcelaine, entre deux rangées de persil.
— Qui est là ?
Margotte s'est immobilisée. Dans l'ombre, tout près d'elle, un grognement répond. Etouffant un cri, elle fait un bond de côté : ce cri sombre, ce râle qui secoue ses babines retroussées, c'est bien dans son gosier qu'il monte et roule sans fin.
Sur ses pattes nouvelles, la jeune louve détale sans souci des buissons qui lui barrent le chemin. Le sentier s'est refermé ; un oiseau nocturne s'envole, dérangé dans sa chasse. Un lièvre regagne son terrier, inconscient du danger auquel il a échappé.
La louve court, court sous la lumière de la lune. La lampe est tombée quelque part sur le sentier — à quel moment Margotte l'a-t-elle lâchée, il est trop tard pour se le demander. Tant que la lune luit, elle n'a plus besoin de lampe, le regard de l'astre qui suit sous les frondaisons sa course précipitée la pousse de l'avant. Elle ne sait plus que courir, courir droit devant elle avec ce grondement tapi au fond du gosier, elle court les yeux fixés sur la lueur qui perdure à l'orée du village. La seule lumière encore allumée à cette heure dans la boutique de monsieur Wolf.
Le bruit s'est tu. Monsieur Wolf entrouvre doucement la porte. Sylvie ? Francine ?
Pourquoi n'entre-t-elle pas ?
La lune éclaire la place du village bien mieux que tous les réverbères. Les yeux de monsieur Wolf regardent à droite, à gauche. Puis s'écarquillent, incrédules.
Il n'a pas le temps de crier que la bête a bondi.
Cet automne-là, toute la famille d'Isabelle G. s'est retrouvée à l'hôpital, à cause des champignons que la jeune fille avait ramassés en forêt. Elle seule n'a pas été malade : elle n'avait rien mangé au dîner, elle n'avait pas faim. Elle traînerait tout l'hiver sa culpabilité. Le printemps venu, la cause de sa distraction se verrait à son ventre arrondi.
Margotte irait lui rendre visite à la maternité, lui apporterait des pois de senteur cueillis dans les bois. Isabelle lui ferait compliment de son joli corsage rouge et de ses seins tout neufs.
De leur côté, les pratiques de monsieur Wolf se souviendraient longtemps de ce samedi où on découvrirait devant sa boutique les restes du boucher baignant dans une mare de sang. On parlerait d'une bête sauvage échappée d'un cirque… On tremblerait. On ferait des rondes. On battrait les bois avec des chiens qui toujours s'arrêteraient au centre de la clairière pour hurler à la lune.
Elle s'en moque bien, la lune. Margotte aussi.
 6 commentaires
6 commentaires Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Café littéraire, philosophique et sociologique
































































