-
Bonnes étoiles (7)
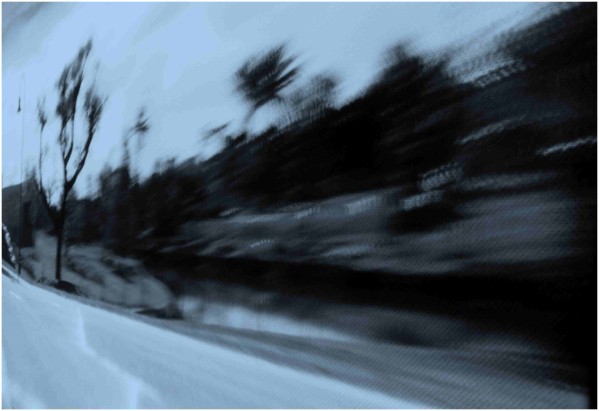
Marine Louvet, l'étoile du jour
À la lecture du thème « Sortir du bois » m’est apparu immédiatement le bois à côté duquel j’ai grandi et la curiosité que provoquait chez moi, très jeune, ces camions avec aux volants des femmes, toujours à l’arrêt. Être dans un véhicule qui ne roule pas me paraissait être un paradoxe intéressant dont j’avais envie de rendre les contradictions. D’autre part, j’avais envie d’écrire ce qui pouvait se passer dans la tête d’une femme qui se prostitue, mais dont les pensées sont simples, communes, changer d’air. De son camion, cette femme observe le même décor depuis des années et elle en est fatiguée. Le déplacement des corps autour d’elle et en elle est une danse qui a cessé de l’intéresser, elle n’a plus envie d’être spectatrice des mouvements d’autrui, mais d’elle-même se mettre en mouvement et enfin, de sortir du bois. C’est un jour du quotidien de cette femme que décrivent ces pages, le jour où elle décide de « Passer la première ».
Passer la première.
Je crois que je n’ai pas rêvé cette nuit-là. La lumière du jour désépaissit les tissus étendus sur le pare-brise. Je n’ai pas froid. La couverture a coulé entre mes cuisses. Les seins et les épaules sont dénudés, l’air est doux. Une légère buée s’est dessinée sur les vitres et à travers, la route est vide. Deux longues bandes noires à l’infini brimées de pointillés blancs et distincts, comme des points de suspension.
J’écarte du bout des doigts le tissu tendu le long du pare-brise pour laisser passer la lumière. Il fait froid dehors. Le jaune se coule doucement jusqu’au gris de la terre. L’horloge indique six heures dix-sept et le miroir une courte nuit. Les traits sont tirés et noircis de maquillage comme pour toujours. Plus aucun démaquillant n’en viendra à bout, le noir s’est incrusté dans les pores jusqu’à devenir peau. Le rouge à la commissure des lèvres les fond, incertaines, au reste du visage. Unique solution pour contraster le tout, redessiner des contours clairs, stricts, perceptibles et droits, un masque artificiel et sans bavure, en remettre une couche toujours, qui a terme viendra s’ajouter aux déjà si bien logés, indélébiles, noir et rouge.
Alors, je reprends le noir, le rouge et trace les contours du visage. De l’intérieur de la paupière vers l’extérieur, un trait noir obscur qui redessine l’œil, rouge, pour le trou béant de la bouche.
À l’arrière du camion, un gant se faufile dans les recoins du corps. Aisselles, entrejambes, lèvres, raie des fesses, arrière des genoux, cuisses, peau, ventre, entre les seins. Les odeurs des autres se ravivent dans le mouvement et remontent par intermittence aux narines. Les traces invisibles des mouvements, des baisers, des coups de reins et de langues inventent une cartographie, une expérience cachée, un vécu des bas fonds, des gémissements, des rumeurs et des râles sur le corps indemne.
La peau sèche, je glisse le long de mes jambes des bas de couleur chair, illusion sur les taches, les varices, les rougeurs et les bleus. Ce geste, bien que je l’aie fait mille fois, me plaît toujours. En coulisse, la caméra suit le geste de mes mains habillant mes jambes de ce voile de peau. Même au plus bas, ces bas m’ont toujours donné l’impression de tout effacer, de repartir de zéro. Vierge. Acheter ma paire de bas. Je passe deux doigts sous les fils sensibles pour en connaître l’épaisseur et choisis une maille matte, proche de la couleur des bas de contention. Souvent, je ne mets pas de chaussures, mes pieds sont nus sur les pédales du camion et j’aime la sensation de faire glisser la texture du collant contre les pédales. Dérapage. Je roulerais pieds nus.
Une combinaison et un peignoir couvrent le haut du corps. Noire, la combinaison. Juste ajustée, contenant la viande. Le peignoir en soie synthétique a quelques petits motifs irréguliers qui ne représentent rien. Le nœud noué, je passe une jambe puis l’autre par-dessus la boîte à vitesse et me laisse couler place conducteur.
Bougie allumée, prête. Les tissus ont glissé jusqu’au bas de la vitre avant et la lumière a envahi mon navire. Je ferme les yeux et me laisse aller à la chaleur qui trace ses ombres sur mon cou et ma poitrine, entre les arbres. Une femme traverse la route désertée en diagonale avec son chien au bout d’un fil. La bête galope plus vite qu’elle qui traîne les pieds, une cigarette laissant derrière elle des effluves de fumée blanche. Le temps d’ouvrir et de fermer les yeux et la silhouette a disparu dans les arbres. Les joggeurs à leur tour commencent à apparaître, traversant ma route à des rythmes variés. Les rodés, iPod collé au triceps, déboulent sur la route comme s’ils ne faisaient que ça de leur vie, les femmes qui viennent de s’y mettre trainent derrière elle un amas de graisse qui les ralentit franchement, moulés dans des caleçons terribles, le buste en avant et l’arrière-train en queue de train, les couples, elle, la queue de cheval au vent, lui l’écoutant en souriant, se demandant quand est-ce qu’elle comprendra qu’on ne parle pas quand on court, les jeunes filles sportives, fines comme des danseuses, les vieux beaux, les refaites, les coups d’un matin, les weekends et les quotidiens.
D’autres viennent suer autrement. Entre mes jambes, entre mes reins, entre mon cou et ma nuque, entre mes seins. Ceux-là aussi sont tous différents. Première fois, fidèles, honteux, heureux, violents, lourds, fins, rapides, interminables, propres, doux, sales, aimant, méprisant, bavards ou silencieux, grosses, petites, courtes longues, des corps à n’en plus finir d’être différents et mêmes, beaux, indésirables, laids et désirables, sensuels et raides. Passés par hasard, venus à pied, traversant le bois, se garant à quelques mètres derrière moi, de l’autre côté, du bois, venant en transport, en vélo, seuls, mariés, avec ou sans enfants, toujours le même désir de se vider, la tête, en suant un peu.
Je m’assoupis laissant divaguer ces idées dans ma tête quand la carcasse sonne trois coups à l’arrière. Le premier. Enfin le suivant, car il n’y a ni début, ni fin. Je jette un coup d’œil dans le rétroviseur et y aperçois un gaillard habitué. Il porte le fidèle duo casquette et clope au bec. Je souffle la bougie, tire un peu le rideau sur le pare-brise et me glisse à l’arrière pour lui ouvrir les portes.
Sourire penaud, il a l’air plutôt content ce matin.
— Ça va ?
— Bien et toi ?
— Ça va.
— Bien dormi ?
— Peu.
Entre les mots, il se déshabille sans me regarder, sous mes yeux. Le voilà nu comme un ver. Celui-ci s’est toujours déshabillé jusqu’à la dernière chaussette, enlevant jusqu’à sa montre et son alliance, déposant toujours le contenu intégral de ses poches sur la tablette. Manière de montrer patte blanche, de se vider totalement, de ne laisser de trace que sur la peau. Alors que d’autres se contentent d’ouvrir et de fermer leur braguette. Je me hisse à l’avant, souffle la bougie, tire le tissu du pare-brise. Il s’allonge sur le petit matelas et me fait signe de m’asseoir sur lui.
Il commence le va-et-vient universel, l’égalisateur de conscience, la grande danse de tous les temps, la danse du meilleur et du pire, le grand mouvement infini, inscrit dans tous les corps, dès le début. L’originelle, si peu originale corps à corps. Toutes les femmes pénétrées, tous les hommes pénétrants, toujours et encore jusqu’à la fin. En mourir. Mourir comme ça, dans le va-et-vient, dans cette danse sans fin, sans faim, sans saveur, sans goût, dégoûtée. Allée et venue, elle aussi. Les yeux fermés, sur une route, où ce même mouvement se répéterait à l’infini. Un va-et-vient qui tracerait ses marques sur le bitume, le lisserait jusqu’au noyau de la terre, jusqu’au fond du ventre.
Contractions. Crispations. Fin. Des gosses passent et donnent des coups sur la carcasse, en courant dans les graviers, en riant. Il sourit. Je lui tends un mouchoir humide. Il fait glisser le préservatif, le jette dans la corbeille à cet effet, se passe le mouchoir sur le front et commence à se décorer, l’animal. Montre, alliance, un coup de peigne, slip, t-shirt rentré dans le pantalon, ceinture serrée. Ni vu, ni connu. Il me glisse les billets dans la main et dit sans me regarder : « À la prochaine. » « Bonne journée », je réponds. Belle journée, oui. C’est le gros départ, on jette l’éponge, on lève l’ancre, on abat les cartes. C’est le grand schelem. Je m’affale sur le lit d’appoint, bois une gorgée d’eau. Le ciel est bleu.
Je passe la première et accélère un bon coup sec sur la route vide. Une allée d’honneur se dessine des familles avec leur poussettes et leur vélo s’écartent pour nous laisser passer moi et mon camion, tout droit sur la grande route, tout droit, tout droit, le long des points de suspension, jusqu’à ce que je puisse plus aller plus loin, jusqu’à la panne, la mer, l’accident, tout droit, sur la route à toute vitesse. Les images défilant de chaque côté des vitres et la route disparaissant sous mes roues, sous moi, la possédant. Des décors de toutes les couleurs. Fini les feuilles, les arbres morts, les bourgeons naissants, l’interminable vert du bois, les mêmes ombres des feuilles, les mêmes arbres, le soleil levé toujours du même côté, couché de l’autre, les odeurs d’herbe mouillée, la rosée du matin, le glapissement heureux des oiseaux. Fini les corps écroulés après le râle, incapables de se mouvoir, fausses caresses, les mous, les pas décidés. Fini les flics à pas d’heure venus combler l’ennui de nuits vides de mal. Fini l’odeur écœurante du latex, la vaseline, les regards droits dans les yeux, les fantasmes. Fini le sommeil mouvementé par des impromptus, des perdus, des passés par hasard, des puceaux et des traves. Fini les insomnies, la peur, la violence et les coups. Fini la nature qui dort, le silence des arbres, des feuilles, du grouillement des insectes, qui dorment, de la vermine qui courent là-dessous. Fini les regards curieux, les doigts pointés, les doigts d’honneur, les coups de langue dans la joue, les grimaces salaces et les échos de jouissance. Fini le boulot. Je mets les voiles. Je tire le rideau.
Ce matin, j’étais clairement décidée à aller faire mon trou ailleurs.
-
Commentaires
Café littéraire, philosophique et sociologique































































Bon courage , et surtout bonne chance, pour une difficile reconversion.