-

Carole Exbrayat, l'étoile du jour
« J'écris toujours vite, d'un jet, sans projet de fin, des nouvelles brèves à partir de souvenirs, de parcelles de vécu puis l'aventure de l'écriture mêle à l'expérience, l'invention et le fantasme. Le juste au corps est né de l'association immédiate de l'image du bois à une expérience traumatique de l'adolescence, revisitée dans ce qu'elle peut porter de trouble et d'ambiguïté. »
Le juste au corps.
Trente degrés. La chaleur suffocante collait sa frange au front.
Comme souvent, elle avait entrepris de traverser le terrain vague. Du temps gagné sur le trajet quotidien jusqu'à la maison. Ses parents étaient contre. Peu importe. Ce serait bon la fraicheur du petit bois à mi-parcours.
Elle suait abondamment : trop couverte, plusieurs couches de vêtements collants : un juste au corps noir en lycra, dessous, un collant sans pied, dessus un jean, plus un chemisier. Cette superposition vestimentaire inadaptée s'expliquait par le baccalauréat cuvée 72 : pour réviser l'enchainement gymnique à présenter, elle s'était entrainée chez une amie de classe à proximité du lycée ; les deux filles s'étaient agitées sur la moquette : roulade avant, roulade arrière, arrivée pieds serrés debout, dos droit, sourire aux lèvres... Puis, midi ayant sonné, elle avait quitté l'amie et la maison au tapis sans se changer et regrettait déjà sa paresse. Le bitume surchauffé montait dans ses jambes, le soleil ardent lui plombait le crâne.
Elle aborda le raccourci par le sentier aux cailloux blancs et, aussitôt sentit une présence sur ses talons ; une ombre longue au sol ; d'autres connaissaient le raccourci bien sûr, mais ça l'étonna, cette présence immédiate derrière elle. Alors, curieuse, elle n'avait pas résisté à se retourner : elle avait entrevu le grand jeune homme un peu vouté, comme perdu dans ses pensées, le visage mangé par l'acné trop gratté, les cheveux gras blond filasse. Elle hésita à revenir en arrière, à renoncer à la traversée pour rejoindre, à deux pas, la rue animée ; elle se savait jolie fille, il ne fallait pas tenter le diable comme disait sa grand-mère ; mais en général elle n'avait peur de rien et ce compagnon de route à peu près de son âge semblait bien inoffensif. Presque un gamin. Alors, ils avaient cheminé sous le soleil de plomb, lui deux ou trois mètres en arrière ; elle trouvait qu'il faisait de bien petits pas ; de si grandes jambes et si peu d'efficacité, elle n'aimait pas ça. La rue était loin à présent et la tache noire du petit bois se rapprochait.
Alors, il avait allongé la foulée ; pffffftt, elle avait senti le déplacement d'air sur son flanc ; il était arrivé à sa hauteur ; pendant une ou deux minutes, ils avaient marché cote à côté comme deux vieux potes ; elle l'avait alors regardé, il souriait d'un air embarrassé ; elle ne l'avait jamais côtoyé au lycée ; il dit d'une traite : « tu aurais l'heure s'il te plait ? » il avait une montre au poignet ; machinalement, elle avait regardé la sienne. Avant qu'elle ait pu répondre, il était sur elle. Ils roulèrent dans la poussière, elle sentit les pierres sur son échine. Il haletait et répétait « je veux juste toucher, je veux juste toucher » en la palpant de façon désordonnée. «Toucher, j'veux toucher » ; cette litanie la débéquetait ; elle n'avait pas peur, les choses allaient si vite. Les pressions du chemisier, la braguette du jean avaient sauté ; la main moite du garçon s'énervait sur le juste au corps hermétique,la poitrine bandée, l'entrejambe fermé par le collant ; une vraie armure de tissu. « ... juste toucher, juste toucher... », il haletait, s'énervait, postillonnait ; elle eut un haut-le-cœur, se débattit avec frénésie, leurs sueurs se mêlaient ; il dégageait une odeur écœurante. Elle avait sous le nez son haleine, sa peau rougie par les cratères d'acné.
Elle ne criait pas ; sa gorge bloquait les sons, tout son être trop occupé à lutter. Elle serrait les dents, les cuisses, le griffait, la peau éructante de dégout. Il s'énervait de plus en plus. Il ne savait pas s'y prendre, le tissu épais et élastique le déprimait et elle résistait trop bien. Il eut envie de pleurer, il se sentit minable.
Ses mains lasses avaient abandonné le juste au corps et de dépit s'étaient posées sur le cou frêle pour l'enserrer ; là, elle avait pris peur, alors, avant de manquer d'air, elle s'était mise à crier pour de bon ; un au secours qui avait vrillé les oreilles du garçon ; surpris, il avait relâché son étreinte comme si c'était incongru ce cri et elle avait hurlé et hurlé encore au secours au secours ; d'une main, elle avait ôté son sabot rose en bois pour lui marteler la tête ; il s'était mis à saigner, l'avait lâchée pour se protéger le visage, s'était
relevé et avait pris ses jambes à son cou en remontant le sentier ; il avait illico disparu de son champ de vision ; elle s'était mise debout, avait réajusté le chemisier et le jean, ramassé le contenu de son sac répandu ; le chemisier, neuf la veille, avait l'air d'un chiffon fleuri ;elle restait à présent piquet planté au milieu du sentier.
Là, elle avait hésité : prendre la même direction que lui pour rejoindre la rue ? Mais s'il l'attendait, plus haut, tapi derrière un bosquet ? Vu la déroute, il allait se venger. Pénétrer dans le bois pour rejoindre au plus vite la maison ? Mais la flaque sombre des feuillus d'ordinaire rassurante la tétanisait à présent. Elle se sentait désemparée, la chaleur la décida : elle opta pour le bois avec l'idée de le traverser au pas de course ; aussitôt la fraicheur l'enveloppa ; elle volait presque autant que les sabots le permettaient, craignant le moindre bruit, la moindre ombre peu identifiée ; mais le petit bois lui adressa des chants d'oiseaux, la caresse du vent, l'odeur des mousses humides, le camaïeu des écorces, des confettis de lumière tamisée...pour lui donner du courage ; en marchant, elle voyait son sabot maculé,du rouge mêlé au rose, le juste au corps irritait la peau tuméfiée.
Au sortir du bois elle le vit... le cube rassurant de son immeuble ; le vilain HLM lui parut dans l'instant ce qu'il y avait de mieux au monde ; elle s'engouffra sous le porche ; l'ascenseur lui fit l'effet d'un cocon ; le miroir lui renvoya une image d'elle presque habituelle, en un peu plus rouge et défaite. Elle n'eut pas à se débattre avec ses clefs et la serrure ; sa mère astiquait la cuisine, elle lui fit un signe rapide et gagna sa chambre ; que faire ? Lui parler ? Non, plutôt se taire ; ses parents étaient hostiles au raccourci. Elle se sentait souillée. Les vêtements volèrent dans la panière à linge ; le juste au corps était intact, même pas étiré au niveau des élastiques, inutile d'en racheter un autre pour le bac ; en une douche, elle vida le cumulus, sa mère protesta à distance. Que décider à présent ? Quelle était la marche à suivre ? On ne pouvait laisser se promener tranquillement l'individu. Elle risquait de le rencontrer à nouveau ou d'autres filles imprudentes. Elle opta pour une visite à la gendarmerie.
Le préfabriqué de la police était dépourvu de climatisation et trois gendarmes transpirants s'y ennuyaient ferme ; aucune femme parmi eux, ce n'était pas de chance ; ils mirent un peu de temps à s'intéresser à elle ; mais comme ils ne souriaient pas à ses dépens, elle raconta tout sans s'arrêter ; ils lui dirent qu'il faudrait revenir avec ses parents puisqu'elle n'était pas majeure ; c'était une mauvaise nouvelle ; quelques questions encore et ils dirent qu'une main courante suffirait sans doute, il n'y avait pas eu viol ; elle n'aima pas ce terme de main courante, il sonnait vulgaire ; ils sortirent alors l'album pour gagner du temps : elle devait le feuilleter, bien regarder et dire si elle reconnaissait son agresseur ; à travers les photos, elle vit toutes sortes d'hommes, jeunes et vieux, chevelus ou non, jamais souriants ; tout un panel de délinquants sexuels. Une armée de mâles déviants. Et soudain, elle le vit. C'était bien lui. Elle n'en crut pas ses yeux.
Non pas l'agresseur du sentier, mais Claudio, son meilleur ami ; fiché comme un bandit. Il n'avait pas l'air content d'être là, dans cet album ; il avait un air fâché .« Vous le reconnaissez ? » interrogea un policier ; elle fit non de la tête ; les gendarmes montraient des signes d'impatience ; les photos étaient de mauvaise qualité, elle devait bien se concentrer ; en même temps, on n'allait pas y passer le reste de la journée. Au final, après trois vaines consultations de l'album, ils lui donnèrent congé avec un papier dans les mains.
Le lendemain, en cours de latin, elle s'assit comme d'habitude à côté de Claudio ; son sourire franc lui fit du bien, et de lui parler à la récréation ; dans un coin de cour, elle raconta tout, l'agression et surtout l'album et lui dans l'album ; consterné, il expliqua tout : sa copine et lui, surpris dénudés par la maréchaussée dans sa deux-chevaux garée discrètement, au sortir d'un bois ; on ne rigolait pas avec ça dans ces années-là : attentat à la pudeur pour lui, rien pour elle « par indulgence » ; séance infamante de photographies avec matricule, sa famille avisée, la honte assurée, sa copine l'avait largué.
Égoïstement, l'explication la rassura; mais en attendant son agresseur courait toujours et ça, c'était vraiment inquiétant.
Pour la libérer d'une angoisse montante, Claudio lui proposa en fin d'après-midi de refaire le trajet redouté ; elle se promit que ce serait la dernière fois ; ils comprirent que l'agresseur avait du guetter celle qui passerait, juste au démarrage du sentier ; derrière un muret proche, l'herbe était froissée ; ils retrouvèrent le lieu de l'empoignade et les pierres maculées de sang noirci ; ils ramassèrent un briquet en plastique qui marchait, peut être l'avait il perdu, Claudio le récupéra. Ils collectaient avec sérieux leurs indices comme de vrais détectives.
Ils finirent par arriver presque au petit bois ; Claudio s'étonna d'un endroit si tranquille et si proche de la ville à la fois, en tout cas beaucoup plus beau que le terrain vague traversé, en attente de constructions. Mais, elle, n'était pas sensible au charme du lieu, elle se sentait déprimée ; ce trajet refait ne lui avait pas fait de bien ; cette exploration méticuleuse ne servirait à rien ; le ciel se couvrait ; il sentit sa détresse ; alors il lui sourit, amical ; lui aussi avait un visage marqué par l'acné. Elle ne l'avait jamais remarqué avant.
Ils cheminèrent en silence. Il se tenait vouté, comme perdu dans ses pensées.
Puis il dit : « Tu aurais l'heure s'il te plait ? ».
À la vacuité de son poignet, elle réalisa qu'elle avait oublié sa montre et aussi ses sabots roses. Elle était confuse de ne pas avoir l'heure. Il était tard sans doute. Il ne souriait plus du tout. Il avait l'air fâché.
Et le petit bois les enveloppa.
 votre commentaire
votre commentaire
-

Lauren Dehgan, l'étoile du jour.
Elle a vingt ans et toutes ses dents ce qui fait qu’elle n’a pas encore grand-chose d’intéressant à raconter… Elle étudie le russe, mais écrit également, dessine aussi, tourne des vidéos et fait du théâtre en amateur… Si Lionn Dubh vous a plu ou même déplu et que vous désirez quand même en savoir plus, elle se répand dans l’Internet sur diverses plateformes dont vous trouverez l’inventaire ici : http://toutesleslau.blogspot.com...
Lionn Dubh
À travers les branches, la lumière tombait sur la mousse en un essaim de tâches d’or, comme un pelage fauve plaqué au sol. Les feuillages bouclés des buissons, les racines noueuses qui s’emmêlaient profondément dans le sol mou, les feuilles mortes de l’an passé ou de celui d’avant encore et dessous, ces champignons, ces fleurs minuscules qui perçaient entre les herbes, ces bêtes à six ou huit pattes qui jamais ne cessaient de galoper, tout ici portait sa trace. Et ce jour-là, c’était un voile de sourde tristesse qui penchait les corolles vers le sol et aplatissait les herbes comme sous un vent trop fort. Au-dessus du ruisseau verdi par le reflet des arbres, Bean Shide pleurait. Ses yeux rouges et gonflés aux paupières crispées débordaient d’une eau claire qui troublait le courant. Ses longs gémissements faisaient craquer les troncs centenaires. Ses cheveux d’argent, emmêlés de feuilles et d’herbes, accablaient ses épaules de leur poids. Bean Shide ne vivait pas un chagrin d’un jour, pas de ces chagrins intenses qui rompent l’échine, mais dont on se remet, plus fort. C’était une tristesse continue, lourde et monocorde qui ne s’arrêtait pas même aux plus belles éclaircies.
Lorsque le soleil serait retombé derrière les collines, lorsque, tous, ils dormiraient au village de Bán Rúnda, plus profondément encore que les ossements jaunes du cimetière. Lorsque, tous, ils se seraient abandonnés à l’oubli terrible, alors Bean Shide sortirait de l’ombre des frondaisons, alors Bean Shide leur rappellerait son existence. Et la sueur dégoulinerait sur leurs tempes et dans leurs dos, ils écarquilleraient leurs yeux mornes et, jusqu’à leur mort, ils conserveraient cet instant à l’esprit.
Bean Shide avait accompli son sinistre devoir maintes et maintes fois. C’était écrit jusque dans les toiles des araignées les plus frêles. Elle devait s’exécuter.
Pourtant, parfois, elle avait été tentée d’y renoncer. Elle s’était attachée aux habitants de Bán Rúnda, à force. Leurs enfants exploraient ses sous-bois. Tapie dans l’ombre, Bean Shide observait les lignes de leurs profils blancs sous les faisceaux du soleil. Les plus agiles attrapaient parfois des animaux, les plus maladroits tombaient en coursant les papillons. Lorsqu’ils repartaient, leurs genoux et coudes étaient égratignés, leurs vêtements maculés de terres et leurs yeux brillaient d’un éclat sauvage sous leurs sourcils ébouriffés. Ils étaient redevenus des créatures. C’était là l’influence de Bean Shide qui s’invitait parfois dans leurs rondes, trottant avec eux entre les arbres. Dans la forêt venaient parfois aussi des vieilles femmes qui y cherchaient des plantes médicinales afin de retarder l’échéance. Et tandis qu’elles psalmodiaient des chants étranges pour repousser le passage de Bean Shide, cette dernière les guidait sans en avoir l’air vers les lieux où poussaient les herbes qui guérissent.
Non, Bean Shide ne prenait aucun plaisir à accomplir son devoir. Et si elle appréciait le respect que lui portaient les villageois, elle détestait inspirer la crainte. Elle méprisait ces colliers d’herbes qu’on accrochait aux portes pour la chasser, elle haïssait ces chants qui devaient l’effrayer. Bean Shide aurait aimé tenir un autre rôle.
Cette nuit plus encore que les autres fois, Bean Shide serait détestée. Elle allait chanter pour ceux qui n’auraient pas dû mourir. Elle crierait les noms des enfants de l’avenir, ceux qui n’auraient pas dû lui revenir, mais appartenir à un futur ensoleillé et glorieux. Elle allait voler les fondations de leurs jeunes vies.
Eochaid et son frère Énnae étaient tombés amoureux de la même jeune fille, la belle Maeve, la fille de la guérisseuse. À tout juste seize ans, elle était bien loin de ces jeunes filles blondes et éthérées dont la beauté se fane en un printemps. Grande et élancée, elle gardait sa chevelure rousse lâchée au vent, encadrant son beau visage ovale aux yeux vert d’eau. Elle souriait peu et lorsqu’elle le faisait, elle ne dévoilait jamais ses dents. Elle n’était pas la plus aimable, mais elle ne riait jamais trop fort et ne disait jamais rien d’idiot et lorsqu’elle dansait, personne ne pouvait détacher son regard d’elle. On la croyait offerte, mais à chaque torsion de son buste, à chaque lever de ses talons, elle s’échappait. C’était une fuite perpétuelle, plus fascinante encore qu’un envol d’oiseaux. À la dernière fête du village, Énnae avait dansé avec elle, puis Eochaid, puis Énnae de nouveau et ainsi de suite. Elle avait semblé n’avoir d’affection ou de préférence ni pour l’un, ni pour l’autre, mais ils n’avaient depuis cessé les attentions pour elle et tous au village se demandaient lequel elle finirait par épouser. Serait-ce Eochaid, le plus hardi et rusé des chasseurs ? Lui que la fougue et la vivacité de Maeve captivaient. Lui qui désirait plus que tout cet animal rare, sauvage et mystérieux qui ne lui appartiendrait jamais complètement et qu’il ne pourrait retenir en cage.
Ou bien serait-ce Énnae, le berger charmeur de bêtes qui ne se sentait jamais aussi bien que parmi elles ? Lui qui n’était à l’aise avec aucune autre fille que Maeve, celle qui ne minaude ni ne séduit, celle qui, pareille aux chats, semble voir plus loin que le commun lorsqu’elle fixe…
Dans le village, on estimait et aimait pareillement les deux frères qui se valaient par leurs vertus, mais différaient par leurs caractères. Les paris allaient bon train sur qui remporterait la main de la belle.
Jusqu’alors, les deux frères en avaient plaisanté, prenant cette rivalité à la légère. Mais l’autre nuit, Bean Shide avait vu Eochaid et Maeve dans la clairière des Féileacán. Étreints, mêlés, ils glissaient dans le murmure de la nuit. Les amants secrets ne font pas de bruit. Sous son corps blanc, les cheveux froissés de Maeve ruisselaient. Elle avait gardé les yeux grands ouverts, comme pour aspirer la nuit. Lorsqu’Eochaid s’était endormi, repu, elle était restée éveillée, le visage tourné vers le ciel. Bean Shide avait observé leur union, tapie dans les buissons alentour. Elle ne les quitta pas des yeux jusqu’à ce qu’ils repartent aux premières lueurs du jour doré, trop tard, déjà, pour que leur escapade reste un secret pour Énnae.
Dans la lente étreinte de la forêt était déjà inscrite la mort des deux frères. C’était fini puisque ça avait commencé. Bean Shide ne pouvait que se lamenter. Elle était incapable de comprendre ça puisqu’elle n’avait, pour sa part, ni début ni fin.
Elle connaissait l’heure exacte où ils succomberaient. Elle l’attendait avec terreur. Les deux frères allaient s’affronter au sein même de ses bois, ils allaient souiller le tronc du grand hêtre de leur propre sang. Ce serait une autre étreinte que celle de cette nuit-là. Une étreinte grotesque et grimaçante. Eochaid planterait son long couteau de chasse dans le flanc d’Énnae mais ce dernier, avant d’expirer, aurait le temps de fracasser le crâne de son frère sur une pierre. Leurs deux corps, entrelacés dans la mort, seraient découverts par Maeve et sa mère, sorties pour trouver des herbes médicinales. Elles tenteraient de les soigner, mais il serait trop tard. Alors elles les ramèneraient au village et on les pleurerait et les préparerait pour le dernier voyage.
La nuit venue, Bean Shide sortirait des bois pour crier leurs noms et chanter leurs morts. Ce serait un long sanglot déchirant qui, comme une épée sacrée, fendrait l’âme plus encore que le cœur. Ainsi, elle délivrerait les esprits d’Eochaid et Énnae qui pourraient alors quitter ce monde. Bean Shide ne savait pas où ils iraient, mais les hommes à croix ne prévoyaient rien de bon pour les fratricides.
Au bord du ruisseau, Bean Shide pleurait l’inéluctable tout en baignant dans l’eau bourbeuse les linceuls blancs des futurs défunts. Sur l’immaculé du drap, les visages jaunes des morts ressortaient mieux que dans les flaques de leur sang.
« Pourquoi pleures-tu, la Bean Shide ? »
La voix était grave et profonde comme la plainte d’un arbre qu’on abat. C’était la belle Maeve qui, de l’autre côté du ruisseau, avait aperçu Bean Shide laver ses linceuls. Bean Shide n’avait pas l’habitude qu’on la voit si aisément. Elle tenta de s’éclipser, mais elle était, elle aussi, sous l’emprise de Maeve. Aucune créature sur terre n’aurait pu lui résister, même les plus étranges n’échappaient pas à la prise de son regard vert d’eau.
« Pourquoi pleures-tu ? répéta-t-elle, quelqu’un va donc mourir aujourd’hui ? Deux personnes, si j’en crois les linceuls, mais si tu sais et si ça t’attriste, la Bean Shide, tu devrais intervenir. »
Bean Shide fixa sur Maeve ses yeux gris et profonds. Des yeux de vieillard millénaire. Maeve sentit brusquement sur elle le poids de la fatalité. Elle soutint son regard.
« Je t’ai vu l’autre nuit, et bien d’autres fois. Tu te crois bien cachée, mais Maeve voit plus loin que les autres. Je te repère dans le murmure de l’eau qui coule et dans la course des fourmis sur un tronc. Tu observes sans agir les chasseurs dépecer tes créatures et les enfants rompre les branches de tes frênes pour s’en faire des épées. Mais l’heure n’est plus au jeu, Bean Shide, si la fin approche et si tu en connais l’heure, c’est que tu peux la décaler. Sors de tes bois à la lumière du jour et non à la nuit tombée. Sors et viens au devant du destin, peut-être pourras-tu le changer. »
Bean Shide cligna des yeux comme un grand-duc qui s’éveille. Maeve ne la regardait plus, glacée d’horreur, elle fixait les linceuls devenus pourpres qui répandaient le sang prophétique dans l’eau du ruisseau en de grandes traînées vermeilles. Bean Shide plongea et disparut. Le rouge se dissipa. Des linceuls, nulle trace. Maeve quitta alors les lieux.
Lorsqu’elle arriva à Bán Rúnda, les deux frères étaient déjà partis. Maeve proposa à sa mère d’aller chercher des plantes dans les bois avant la tombée de la nuit. Elle espérait ainsi retrouver Eochaid et Énnae avant le drame.
Pendant ce temps, Bean Shide était allée auprès du grand hêtre, elle avait pris la pierre sur laquelle Énnae fracasserait le crâne de son frère et l’avait jetée dans le ruisseau où tourbillonnaient les linceuls. Restait le couteau. Terrorisée, mais décidée, elle se résolut alors à suivre les conseils de Maeve.
De l’orée du bois, elle voyait les deux frères qui avançaient sur le chemin. Côtes à côtes, ils ne se regardaient pas, mais gardaient les yeux fixés devant eux. La colère agrippait leurs traits anguleux, les faisant grimacer comme de hideuses gargouilles. Bean Shide quitta l’ombre des arbres et un rayon de soleil vint frapper sa silhouette. Les deux frères s’immobilisèrent à sa vue. Bean Shide apparaissait pour la première fois à la lumière. Petite et menue, elle avait l’apparence d’une enfant malingre. Mais ses longs cheveux et son regard grave étaient ceux d’un vieillard. Elle s’avança vers les deux frères, les fixant tour à tour. Sans un mot, elle alla prendre le couteau de chasse à la ceinture d’Eochaid, puis, son devoir accompli, elle disparut.
Bean Shide alla se réfugier dans la clairière des Féileacán. Encadré par la cime des arbres les plus hauts, le jour se couchait dans un ballet de roses, de violets, d’oranges et de bleus. Bean Shide ne quittait pas cet infini des yeux, craignant et espérant y basculer et s’y perdre, elle tournait sur elle-même, riant et pleurant à la fois. Étourdie par les mille couleurs et odeurs qui défilaient, elle était incapable de s’arrêter. Ses gestes étaient d’une grâce irréelle et son rire faisait s’envoler les oiseaux. On eut dit un ange païen.
De leur côté, Maeve et sa mère avaient retrouvé les deux frères dans la forêt. Eochaid avait percé le flanc d’Énnae avec une branche acérée et Énnae avait fracassé le crâne d’Eochaid sur le tronc du grand hêtre. Leur sang ruisselait sur la mousse. Maeve et sa mère essayèrent de les soigner, mais il était trop tard. Elles les ramenèrent alors au village pour les pleurer et les préparer au dernier voyage. On enveloppa leurs deux corps jaunes dans les linceuls immaculés, puis, leur famille et proches restèrent pour les veiller tandis que les autres retournaient se coucher.
Dans la nuit glacée, les cris de la Bean Shide retentirent. Toute leur vie, les habitants de Bán Rúnda allaient s’en rappeler en frissonnant jusqu’au fond de leurs âmes.
 4 commentaires
4 commentaires
-

Annick Demouzon, l'étoile du jour
Née en région parisienne, Annick Demouzon vit à Moissac dans le Tarn et Garonne. D'abord, professeur de Lettres, elle a ensuite adopté le métier d’orthophoniste. Elle écrit depuis sa toute petite enfance. Sa première publication date de 1973 : Sur le chemin de l’oiseau feuille, poésie, éditions Saint Germain des prés.
Puis elle s’est surtout consacrée à sa famille et à son métier, avant de replonger en écriture en 2005. Lauréate de plus d'une cinquantaine de concours depuis cette date, plusieurs de ses nouvelles ont été publiées en revues ou anthologies. En 2011, deux ouvrages personnels sont édités :
— Virages dangereux, éditions Le bas vénitien, a été sélectionné pour le Prix de La femme renard.
— À l’ombre des grands bois, éditions du Rocher, Prix Prométhée de la nouvelle 2011.
En 2012, publication, en Serbe, d'Un jour à la mer, nouvelle extraite d'À l'ombre des grands bois, in Svetionik, par Povelja, éditions de la bibliothèque Nationale de Serbie.
Ma princesse
— Viens, ma poupée, nous allons nous amuser.
Elle arrive aussitôt. Ça fait tellement plaisir à Julia de jouer avec elle. Et elle, elle aime tellement Julia.
On va se déguiser. Julia adore les déguisements. Et c’est elle qui choisit, parce que, elle, elle sait ce qui est le mieux, elle s’y connaît en déguisements. Et puis, elles se regarderont dans le miroir, Vera surtout, et Julia lui dira :
— Vois, comme t’es belle, une si jolie petite fille.
Vera ne sait pas si elle est belle, mais elle se regarde, comme Julia a dit. Près d’elle, il y a Julia, qui lui sourit. Elles se ressemblent un peu, même peau blanche, mêmes yeux bleus, mêmes cheveux d’une blondeur étonnante. Vera sourit. On ne sait pas si c’est à Julia ou à son image que s’adresse ce sourire, mais sur le verre glacé, les yeux ne sourient pas.
— Mets-toi là, dit Julia. Je vais te prendre en photo.
Elle s’installe où Julia a dit, comme Julia dit et Julia prend plein de photos :
— C’est parfait, ma princesse.
Vera s’est enfermée dans sa chambre. Être seule, c’est bien aussi, pour jouer. Elle a pris sa poupée préférée. Elle s’appelle Ma princesse. Vera n'a jamais eu envie de lui donner d’autre nom, Ma princesse, elle trouve que ça lui va bien. C’est une poupée, que mamie lui a offerte. Mamie, elle est gentille. C’est elle qui s’occupe de Vera, lui fait ses repas, la conduit à l’école, elle qui la soigne quand elle est malade. Parce que sa mère, elle a trop à faire.
Vera joue avec sa poupée, longuement, avec un plaisir sérieux. Elle l’habille, la déshabille, lui change ses tenues, ses habits de princesse, et elle lui dit : « Mets-toi là, regarde-toi dans la glace, vois comme tu es belle. Comme ça, oui, c’est parfait, ne bouge plus. » Et Vera serre sa poupée dans ses bras, très fort, pour que la poupée sache combien elle l’aime. La poupée l’écoute. Elle regarde Vera de ses yeux bleus, elle répond : « Ma maman adorée. » Vera l’a entendue, qui disait ça, elle lui répond à l'oreille : « Ma belle princesse.» Elle et Ma princesse, elles s’aiment beaucoup, beaucoup.
Julia appelle :
— Viens, Vera, je vais te montrer quelque chose.
Vera regarde. Des photos d’elle. Il y en a plein. Dessus, elle est très blonde, et pâle. On dirait une poupée, comme dit Julia. Mais Vera n’aime pas se voir en photo, ni ailleurs. Vera ne s’aime pas. Vera aime sa poupée et Julia et que maman la serre dans ses bras.
La première fois qu’elle a ouvert un magazine, Vera n’a pas compris. Elle a demandé : « Pourquoi tu me montres ça ? » Mamie a expliqué :
— C’est une idée de Julia. Tu veux que j’en accroche une page dans ta chambre ? Laquelle ? Choisis.
La petite a baissé les yeux :
— Non, mamie, je ne préfère pas. Merci.
Et elle est partie s’enfermer, seule, avec sa poupée à elle, pour tout lui raconter. Ce jour-là, elle a déshabillé sa poupée, elle l’a mise toute nue et elle a jeté ses habits de fête sous le lit. Elle n’aime pas que sa poupée ressemble à une princesse. À la place, elle lui a mis sa jupe écossaise à bretelles et un pull en laine mohair, tricoté par mamie :
— Je te conduis à l’école, tu veux ?
La poupée veut bien, alors elles s’en vont toutes les deux à l’école.
À l’école, c’est Vera qui fait la maîtresse. Elle explique à sa poupée le nom des lettres et les conjugaisons et 2 et 3 ça fait combien et toutes les choses qu’une petite fille bien élevée doit connaître. C’est quoi, la capitale de la France ? Et le 14 juillet ? La poupée apprend très vite et très facilement. La maîtresse la félicite : « C’est parfait. »
Mais, à la récréation, la poupée s’ennuie. Elle ne sait pas jouer comme les autres, avec les autres. Et elle n’ose pas. « Vas-y lui dit cependant Vera-maîtresse d’école, tu n’as rien à craindre, ce sont des filles comme toi et elles sont très gentilles, tu sais. » Mais la poupée ne va pas jouer avec les autres. Pourtant, elle en a très envie. Elle baisse les yeux, elle murmure : « Non. » Et Vera la serre dans ses bras.
Julia est arrivée en trombe :
— Ma petite princesse, viens vite. Je suis en retard.
Et Vera y est allée. Julia lui dit :
— Mets-toi là, comme ça, voilà, c’est très bien, tire un peu tes bas, ils font des plis, là c’est mieux, elle te va à la perfection, cette guêpière, j’ai bien choisi.
Vera n’est pas sûre. Mais Julia est si gentille. Elle a une voix douce et câline… Et Vera aime Julia.
Ce jour-là, Julia a demandé : « Viens, ma princesse », et Vera est venue.
— Je mets quoi ?
— Rien.
Vera a d’abord ri — c’était rigolo —, puis elle a souri. Dans le miroir, elle a vu que ses yeux aussi souriaient. Elle ne savait pas que les yeux pouvaient sourire, c’était amusant, d'un coup, toutes ces étoiles qui s'y promenaient. Elle n’a plus bougé. Elle examinait ses yeux qui s’inventaient ciel, avec de drôles d’étoiles partout. Puis elle s’est étudiée en détail, elle toute entière : sa jupe à carreaux, qui lui sert pour aller à l’école, ses chaussettes blanches, ses ballerines à brides, son tricot bleu. Elle était belle comme ça. Aujourd’hui, Julia allait prendre des photos d’elle en petite fille de tous les jours et ça serait très amusant. Et, soudain, elle a eu envie de mettre son pull jaune, à la place du bleu. Il est très joli, son pull jaune.
— Si je mettais plutôt mon pull jaune ?
— Un pull ? Tu rigoles ? Non, aujourd’hui, tu mets rien.
— Rien quoi ?
— Rien. À poil.
Vera n’a pas voulu se regarder dans la glace. Encore moins sur les photos, après. Mais Julia a dit : « Si ! Tu dois. Tu es si belle, regarde. » Et elle l’a forcée à regarder. Julia avait une voix onctueuse, avec du sucre dedans, une voix que Vera n’aime pas. Mais elle a regardé. Elle a vu les chaussures à talons hauts, le rouge à lèvres trop vif et ses yeux tristes au dessus, sans étoiles. Elle a baissé le front. Julia a pris une photo d’elle comme ça, le front buté. Elle riait.
Le soir, dans sa chambre, Vera a déshabillé sa poupée et elle l’a laissée nue, comme elle aujourd’hui sur les photos, mais elle ne lui a pas mis de talons ni de bijoux ni rien d'autre. Elle l’a seulement laissée nue. Toute nue.
Elle lui a dit :
— Tu n’aimes pas ça, Ma princesse ?
Elle l’a susurré d'une voix très douce, avec tout plein de vraie gentillesse : oui, elle la comprenait. La poupée la fixe de son long regard bleu. Elle non plus, n’aime pas ça. Vera lui remet sa jupe écossaise avec les bretelles et son pull mohair qui vient de mamie, et de petites chaussettes blanches très mignonnes. Vera ne l’habillera plus jamais en princesse.
Julia appelle : « Ma princesse, ma jolie poupée. Viens ! Viens vite. »
Vera a entendu, elle ne répond pas. Elle s’est cachée au grenier. Vera ne veut plus jouer. Vera ne veut plus se voir dans la glace. Ni en photo. Hier, elle a découpé les bas neufs en morceaux. La résille noire s’est rétractée en se tortillant. On aurait dit un serpent. Vera l’a piétiné du pied. Puis elle a décousu les paillettes du porte-jarretelles. En fait, elle les a arrachées, en faisant plein de trous, exprès. Après, elle… Mais elle a entendu mamie, qui arrivait. Alors, vite, vite, elle a tout remis en place, dans les tiroirs de la commode.
— Julia sera là demain.
Vera n’a pas envie de voir Julia. Vera l’aime toujours, mais elle ne veut plus la voir. Son regard s’est assombri.
— Ça ne te fait pas plaisir ? a demandé mamie.
Vera a menti :
— Si, mamie, beaucoup.
Mais, aujourd’hui, elle s’est cachée au grenier.
Julia l’a trouvée. « Allez, viens, arrête tes enfantillages ! » Elle a pris sa voix cajoleuse, lui montre des albums où on la voit, lui caresse les cheveux :
— Tu es si belle. Les hommes raffolent de toi. Vois cette photo, une vraie poupée, n’est-ce pas ? Tout le monde t’admire, ma princesse. Tu peux être fière.
— Je suis pas ta princesse !
La mère regarde la petite, sa fille si jolie, si délicieusement jolie, et déjà si célèbre. On s’arrache ses photos, on en fait des livres, des expositions, on les portes aux nues et elles s’échangent à prix d’or. Grâce à elle, la mère. Sinon, elle serait quoi ? Une gamine comme les autres, une rien du tout. Julia considère le visage buté de l’enfant. Elle ne comprend pas.
Devant elle, la fillette, debout, les cheveux subtilement relevés en désordre, une mèche coulant sur son regard, des boucles énormes accrochées aux oreilles, les yeux barbouillés d’ombre, avec ce bleu pur au milieu, qui trouble et une lueur qui interroge, la bouche, une tache de sang sur ce visage trop pâle, un porte-jarretelle ornés de strass, des bas en filet noir, talons aiguilles très haut. Pas de culotte, et tout le reste nu. Elle est superbe.
Installe-toi, dit la mère. Prends la pose. Cette photo va faire un tabac.
— Non.
La mère la regarde.
— Tu a envie de faire pipi ? Vas-y, j’attends.
— Non.
— Et bien quoi, alors ?
La petite ne quitte plus la femme du regard. Elle a plongé ses yeux au fond des siens, ne cille pas. La femme parle, raconte des choses, rit un peu. Elle a pris sa voix douce, des caresses, des mots, des gestes pour séduire. L’enfant n’entend pas. La voix ne l’atteint plus. Elle se tient droite, le menton raide. Elle jette :
— Fais le, toi.
Julia se tait.
 6 commentaires
6 commentaires
-

Bruno Baudart, l'étoile du jour
J'ai écrit cette nouvelle, Trois petites notes de musique, pour ma fille Karen. Je n'avais jamais abordé ce thème – l'amour d'un père pour sa fille – et comme d'habitude, mais puis-je faire autrement ? Je l'ai écrite dans un contexte noir.
Cette chanson qui rythme le déroulement de la nouvelle, Trois petites notes de musique, peut prêter à confusion, une certaine ambiguïté quant à la destinataire de ces propos. Mais d'ambiguïté, dans mon coeur et mes sentiments, il n'y en a pas. Juste un père qui se demande jusqu'où peut-il aller pour sauver sa progéniture bien aimée...
Cette année 2012 est pour moi une année étrange. En effet après n'avoir eu que deux ou trois nouvelles remarquées ou « étoilées » pour reprendre votre terme pendant toutes ces années, depuis le début de l'année 2012 il y a eu :
Mission Bay, éditée dans le recueil Mauves en Noires
Le Point Oatman, éditée dans le recueil Fnac de Liége
Rio Grande, éditée dans le recueil Police de Liége
Plus trois autres nouvelles, toujours le genre noir, classées dans divers concours. Et maintenant, vous.
Bien sur un peu de regret de ne pas être dans votre recueil - très belle couverture au demeurant - mais néanmoins ravi de faire partie de cette aventure.
D'où je vis je contemple la Méditerranée et les vagues bleues, et vertes, se joignent à moi pour vous souhaiter à tous plein de bonnes et belles choses quant à votre avenir et qui sait... pourquoi pas à l'année prochaine.
Trois petites notes de musique
Je me souviens très bien de cet air-là, des paroles qui vont avec. Je ne l'ai jamais oublié. Je n'oublie jamais rien...
Accoudé au bar, chez Henry, je bois un whisky. Le bar est désert, juste quelques jeunes derrière moi, garçons et fille mélangés, je trouve qu'ils ont bien changés.
Dix ans que j'ai pas mis les pieds dehors, dix ans à voir le ciel au travers des barreaux, une pluie grise et froide m'a accueilli tandis que je sortais de la centrale avec ma valise, quelques billets en poche. Personne pour m'attendre, personne pour me serrer dans ses bras, personne pour me dire, je suis si contente de te revoir.
Personne et surtout pas elle... Catherine Tromal.
Celle pour qui j'ai fait dix ans de prison.
Je fais signe au barman. D'un geste expert, il me verse un double ; sans un mot, il repart derrière son comptoir.
Il y a un jukebox dans un coin, un vieux, un authentique, un vrai de vrai. J'attends que les jeunes aient fini d'écouter leur morceau de rock, je m'approche. Je sais qu'il est là, ce vieux titre qui ne dit plus rien à personne à part moi.
Catherine était si jeune quand nous venions là, un diabolo menthe pour elle... Et pour moi ? À l'époque, de la bière. Les temps ont bien changé, maintenant il me faut du lourd afin d'oublier.
Je glisse une pièce. Un bras articulé saisit un disque par la tranche, va le poser sur la platine. Est-ce que le temps a tout effacé ?
La petite musique s'élève, douce, naïve, toute une époque. Je revois Catherine assise sur une chaise en skaï, son verre rempli de bulles vertes, elle me regarde, me sourit. À ce moment-là, de la revoir comme ça, sourire de princesse et chevelure inondée de soleil, je l'aime si fort, je crois que je vais en mourir.
« Trois petites notes de musique,
Ont plié boutique,
Au creux du souvenir... »
À côté les gosses se mettent à râler, hé ! c'est quoi ça, c'est pas du rock, virez-moi cette merde !
Je regarde le leader, celui qui se lève. Il vient en direction du jukebox, moi debout à ses côtés. Un sourire aux lèvres, il me regarde, me défie, veut changer de disque ; je le chope. Il s'arrête, me regarde encore.
Autour de la table, ses potes se taisent. Parmi eux, une fille a un sourire ravi, ouais super ça va taper...
Je regarde le merdeux, je le regarde en plein dedans. Il me sourit, crâne un peu, voit mon regard de poisson mort, là où il n'y a plus rien, plus de vie, alors il baisse les yeux. Je le lâche, il retourne vers sa bande et moi je suis ailleurs, là où Catherine Tromal m'a laissé, il y a dix ans. C'était hier, c'était il y a un siècle...
Tout est parti du monde des people quand Catherine s'était mise en tête de devenir une star.
Oh ! Elle avait de quoi : ce sourire qui vous faisait fondre, son visage et puis ses yeux... Belle c'est rien de le dire. Belle comme une gosse de quinze ans qui en faisait vingt. Et c'est là que ça a commencé à ne plus aller, quand elle a commencé à faire des castings. Pour des photos, des bouts de films, des pubs, ça n'arrêtait pas. Moi je ne disais rien, mais je trouvais qu'on avait plus beaucoup de temps pour nos moments, se balader au square, courir après les pigeons, manger une glace, tous nos projets, bref faire ce que font tous les gens comme nous.
Mais, poussée par sa mère, Catherine en avait décidé autrement. Et moi j'avais laissé faire. Ouais, la plus grosse connerie de ma vie : laisser Catherine aux mains du show-biz, ce monde d'adultes où les adolescentes n'ont rien à y faire.
Un soir j'avais retrouvé Catherine en larmes, le maquillage ravagé, les yeux tout rouges à force de pleurer. Catherine... Prostrée dans son lit, elle m'avait avoué ce que le photographe, pour qui elle venait de poser, lui avait fait. Comment le dire, avec ses mots à elle ? Comment partager ce que j'avais ressenti à ce moment-là ? Personne. Personne ne pouvait comprendre ce coup en pleine gueule, mon cœur déchiré... Personne à part le photographe. Et c'est là où tout avait basculé.
Surtout quand la police l'avait retrouvé après ma visite, si amoché qu'il avait passé l'arme à gauche. Pas sûr que j'ai voulu ça, mais je crois bien que je n'étais plus moi-même. Je l'avais tapé si fort, si longtemps. Oui, j'étais devenu quelqu'un d'autre et mes poings meurtris, mes phalanges écrasées, tout ça avait fortement impressionné le jury. Dix ans, voilà, c'était ma peine annoncée et je la voyais se dérouler devant moi comme un long, un très long désert qu'il me faudrait arpenter jusqu'au bout.
J'avais fini mes dix ans hier.
Personne, personne n'était venu me voir pendant tout ce temps.
Catherine ? La jeune ingénue devenue top-modèle, je ne l'avais jamais revue. Juste dans la presse, d'abord en milieu de page puis au fil des années en couverture, en une des magazines là où son regard bleu-vert faisait sensation. Probable qu'on l'avait dissuadée de venir me voir en prison - mauvaise pub pour elle, ça. Trop de fric en jeu aussi.
Fini le regard hésitant, le sourire fragile, les poses maladroites de starlette débutante. Non, Catherine Tromal était devenue une grande et belle jeune femme et il n'y avait que moi pour savoir ce qu'il y avait de cassé derrière ce beau visage à la beauté figée, derrière ce regard éteint. Une âme perdue à jamais.
« Mais un jour sans crier gare,
Elles vous reviennent en mémoire... »
Comment l'oublier ? J'ai fini mon double, je suis sorti. La chanson m'a poursuivi jusque dans la rue. J'ai marché en direction du petit square. Même si je ne l'avais pas revu depuis dix ans, je savais qu'il serait toujours là, le joueur d'orgue de barbarie. J'ai longé la Seine. Oui j'avais revu Catherine ce matin même, dans l'immense appartement qu'elle partageait avec son agent, un vieux de soixante ans - eau de toilette intense, sourire rempli de fausses dents. J'avais sonné à l'interphone d'un immeuble, style Haussman. J'étais monté, la porte était déjà ouverte.
Quand j'étais rentré dans l'appartement aux murs recouverts de posters, Catherine se tenait là, avachie dans un fauteuil, l'air ailleurs. Elle m'a regardé, elle a essuyé un peu de poudre blanche à la base de son nez. « Ça va ?
Je suis venu te voir Catherine.
- Je sais, je t'attendais. » Elle avait vieilli. Non, plus exactement sa beauté s'était durcie. Je me suis demandé, tout en m'approchant d'elle, combien de parties, de drogue, d'alcool, où était la Catherine Tromal d'avant ? Morte certainement, ses illusions enfuies et moi aussi. Je lui ai tendu la main. En vacillant, elle s'est levée. « Où tu m'emmènes ?
- Pas loin, tu vas voir. » Je lui parlais doucement tandis que l'on se dirigeait vers l'immense balcon surplombant la belle avenue. Il faisait doux, le vent a soulevé ses cheveux quand nous sommes sortis.
« Vrai elle était si jolie,
Si fraiche épanouie,
Mais tu ne l'as pas cueillie. »
« Où m'emmènes-tu ?
- Pas loin Catherine, pas loin... Tu te souviens quand nous étions ensemble et qu'on voulait aller en Australie, tu te souviens ? » Elle a hoché la tête, un sourire de petite fille sur les lèvres, elle disait oui, rien qu'avec sa bouche. « Et bien on va y aller Catherine, c'est le moment. Regarde bien devant toi, je lui ai dit, regarde bien devant et surtout ne te retourne pas. »
J'avais le cœur qui saignait. Dans son dos j'ai sorti le petit automatique que je m'étais procuré la veille. Doucement il est venu se nicher dans sa belle chevelure.
« En Australie tu as dit ?
- Oui Catherine. Non, non, ne te retourne pas, voilà, comme ça, regarde bien devant toi... Tu les vois ces paysages immenses, tous ces beaux animaux ?
Et les kangourous ? Oh oui ! Les kangourous... On ira voir s'ils ont la tête à l'envers.
Oui Catherine, on ira voir ça et tellement d'autres choses. »
J'ai senti ses cheveux quand le vent les a rabattus vers moi. J'ai fermé les yeux et j'ai tiré. Sa tête est tombée en avant, Catherine a eu un hoquet... Elle s'est agrippée à mes cheveux puis elle a glissé sur le balcon.
Le joueur et son orgue sont bien là. Je lui demande le morceau, celui de Catherine, je lui donne le reste de mes billets. Il me sourit. La musique s'élève parmi les feuilles qui volent, les arbres noirs, les allées solitaires, perdues dans la nuit.
Je suis assis face au plan d'eau, un bateau d'enfant abandonné face à moi, sa voile en berne. Je repense à Catherine, je suis près d'elle...
« La la la tout rêve,
Rime avec s'achève,
Le tien rime à rien. »
Il me semble entendre venant du fond du jardin une musique, des gens qui rient, une fête qui s'en va au loin... La police qui vient me chercher.
Je souris, je glisse le canon du petit automatique entre mes lèvres. Notre musique, elle s'enroule autour de moi, puis elle s'enfuit.
Et si Catherine était là, hein ? De nouveau là, à m'attendre, dix ans plus tard, cachée dans le jardin comme une surprise, on reprendrait enfin notre histoire là où nous l'avions laissée. Catherine... Je souris, je vais la revoir. Quand je presse la détente de l'automatique enfoncé dans ma bouche, une main surgit dans le noir ; elle m'invite à la rejoindre et c'est Catherine, et c'est sa main.
La main de ma fille.
 8 commentaires
8 commentaires
-

En attendant Nouvelles en fête du 13 octobre prochain au Fontanil, nous vous présentons quelques unes des "nouvelles étoilées" par le jury de la onzième édition du concours Calipso.
Jordy Grosborne, l'étoile du jour
Depuis presque trois ans, le temps m'a mis en quarantaine. Cellule d'isolement de mon enfance, de dégrisement de mon adolescence, capitonnée de ma trentaine, de crise peut-être aujourd'hui. Une vie multicellulaire qui caractérise toute existence.
Fut un temps où l'écriture y tenait presque toute la place, dans ma cellule privative, et s'il n'y avait pas assez d'espace pour qu'elle y croisse, j'en faisais volontiers. Certains textes ont alors, pour mon plus grand bonheur, eus de belles vies, couchés dans des revues, évoqués sur le net, vocalisés sur les ondes radios, récompensés par certains jurys, ignorés par d'autres. Tant de frémissements et de pulsations cardiaques qui vous font respirer un autre air et grandir le cœur.
Aujourd'hui, l'écriture est dans une autre cellule dont j'ai un peu perdu, parfois le chemin, parfois la clef, mais pas encore l'envie d'en sentir le souffle. Heureusement, c'est elle qui s'échappe parfois et vient à ma rencontre, telle une poussée d'enfance, un souvenir tenace qui vous fait regarder vos pas derrière vous, une apnée bienfaisante.
Alors faire aujourd'hui partie du ciel étoilé de Calipso me ravit et je vais contempler ses étoiles du fond de ma cellule. Je suis certain que si je les reliais toutes entres elles par un trait d'imaginaire, elle formerait une élégante plume sur laquelle voyager.
Et si pour libérer l'écriture il ne me fallait point une clef, mais une plume… ?
Merci en tous cas à l'équipe de Calipso de me permettre de remonter le temps et bravo à toutes les étoiles qui m'accompagnent et plus encore à celles qui sont allées jusqu'au firmament.
Une nuit de rêve
Il fait presque nuit... Quand la balle trace un profond sillon brûlant sur ma cuisse.
Il fait presque nuit... Mais pas assez pour qu’un noir se confonde avec les buissons. Pas assez, pour échapper à la meute d’animaux sauvages assoiffés de sang qui me pourchassent... Et à ses chiens ! Pas assez, pour que je ne fasse pas tache dans leur décor.
Face contre terre, je sens l'humus accueillant me lécher le visage sans se formaliser de sa couleur. Je rampe, haletant, alors que mon corps s’écorche aux pierres, avec en tête les Blind Boys of Alabama qui entonnent No more, souvenir du peuple noir qui m'accompagne au rythme de mes battements de cœur ! Tétanisé et inquiet je plonge la main dans ma poche de pantalon. J'y sens d'abord la chaleur du sang, puis, mes doigts tremblants trouvent la feuille collée au tissu.
Il fait presque nuit... Mais assez jour pour voir les taches rougeâtres marquer le papier déplié.
Je manque éclater de rire ! Un de ces rires qui déborde dans la gorge, découvre vos gencives et vous immunise du monde. La balle a traversé le texte juste à la fin du titre. À la place du point, il y a désormais un trou vide aux bords calcinés, ponctuation gigantesque à la mesure des écritures de dieu. Alors je m'accorde un silencieux répit pour de mes dents blanches rendre son sourire à la lune.
Derrière les aboiements, j'entends les voix et le cliquetis des armes. Des insultes soubresautent avec les lumières blafardes des torches à travers le feuillage et je plaque la feuille dans ma chemise, tout contre mon cœur. La prochaine balle qui le touchera m’enlèvera aussi la vie.
Les voix s’éloignent et les chiens doivent avoir la truffe désemparée au-dessus du ruisseau que je viens de traverser. Inquiet, je me demande comment délivrer ma lettre ensanglantée sans sortir du bois et me faire pendre. Les yeux fermés, le film des derniers jours défile : il est en noir et blanc.
Il faisait presque nuit aussi quand j’étais arrivé dans ce trou. J’avais avalé de la poussière toute la journée par les vitres ouvertes de la Ford chauffée à blanc sous un soleil de plomb. J’avais trouvé le bureau du shérif face à un petit restaurant dont un vieux noir balayait le pas-de-porte. J'avais réajusté ma cravate, pris ma mallette en cuir et respiré profondément avant de pousser la porte qui avait grincé sur des relents de bière et de transpiration brassés par deux ventilos asthmatiques. Une montagne de graisse savourait une glace et l'autre adjoint était plongé dans une revue où la bannière étoilée flashait comme la promesse d’un avenir blanchi. Ils n’avaient pas l’air débordé. Le shérif était un grand moustachu aux traits aiguisés à la serpette et aux yeux de musaraigne. L'étoile sur sa poitrine brillait autant que le colt posé sur les dossiers en guise de presse-papiers. À mon raclement de gorge, ils avaient levé la tête.
- Ouais ! Il avait dit en crachant par terre.
Je m’étais avancé en lui tendant ma carte de visite. À sa lecture, son front s'était plissé.
- Vous êtes avocat ? S'était-il étranglé.
- Maître Collins ! Avais-je répondu calmement.
Ses mâchoires avaient laissé échapper un grincement de dents alors que le gros avait fait tourner le barillet de son flingue avec gourmandise.
- Et ? Avait interrogé le shérif.
- Je dois assurer la défense de M. Ryckman. J’aimerais le voir.
Les adjoints avaient gloussé dans mon dos et le shérif avait affiché son plus beau sourire.
- Ok, prenez une pelle et enlevez votre déguisement, il a juste deux mètres de terre sur lui ! Avait-il dit ravi de sa blague.
- Que s’est-il passé ?
Il était allé prendre une bière.
- Oh, rien de particulier ! On l’a juste retrouvé pendu dans sa cellule. La peur de la prison sans doute, ou la lâcheté….
J’avais eu envie de vomir !
- Et comment une corde s'est-elle retrouvée dans sa cellule ? J’avais repris insolent.
Le shérif m'avait balancé son haleine fétide au visage en tapotant mon torse de son index.
- Eh, négro, t'insinues quoi ? Barre-toi. T'as plus de clients ici !
- Et il reste sans doute des cordes qui s'ennuient à se pendre… Avais-je glissé avant de sortir furieux.
J'étais remonté dans la voiture, mais elle avait refusé de démarrer. Un peu trop de sucre dans le carburant peut-être… On a l’air très con, quand on est noir dans une ville de blanc, en costume, debout à côté d’une voiture qui sent le caramel.
Les aboiements et les lumières se rapprochent. Malgré la douleur j'avance, dos courbé, me demandant si un jour nous pourrions librement nous redresser.
"Veux-tu écrire pour nous ?" M'avait demandé un ami. Même dans mes rêves les plus fous, je n'avais pas fait ce rêve-là ! Alors j'étais devenu une plume de leurs ailes, pour faire s'envoler nos mots.
J’avais trouvé une chambre, après une bonne marche, dans un hôtel miteux réservé aux noirs, excentré à l’autre bout de la ville. Après, j’avais cherché les Ryckman et j’avais rencontré Lina, veuve d'un mari retrouvé ligoté à un arbre et battu à mort, qui me raconta son histoire comme on fait une prière. C’est son grand-père qui s’était opportunément pendu dans sa cellule. On l'avait arrêté pour avoir volé une poule prétendument possession du frère du shérif. Le reste était banal ici. J'avais laissé quelques billets à Lina et l'avais longuement serré dans mes bras avant de partir.
De retour à l’hôtel, je m’étais effondré sur le lit, le coeur au bord des yeux. La lune découpait les pales du ventilo sur le mur et je fixais le plafond en chantonnant Nobody’s fault but mine des Blind boys.
C’est là que je l’ai écrit !
On me l’avait demandé la semaine précédente. "Rends-nous l'espoir", avaient-ils réclamé. Lui était venu me parler le lendemain. Ses yeux dans les miens, une main sur l’épaule, il avait murmuré :
- Soit mes mots et fais-nous rêver d'un autre monde !
Les mots m'avaient fuient et depuis mes pages étaient désespérément blanches, mais là, dans cette chambre miteuse, j’avais pensé à Lina et je les avais noircies de nos maux et de nos espérances. Le sourire aux lèvres, j’avais passé la nuit à nous rêver un monde.
Une deuxième balle siffle au loin. Ils tirent au hasard pour me débusquer. Mon cœur bat la chamade contre la feuille. Ils doivent être une dizaine à me pourchasser et j’imagine sans peine qui mène la danse ! Leur acharnement est l'aveu que leur vieux monde agonise.
Il faisait presque jour, quand j’avais reposé le stylo. Épuisé, j’avais dormi jusqu'à ce que les cloches sonnent un peu avant midi. Je m’étais précipité chez le télégraphiste avant qu'il ne ferme. C'était un petit blanc qui ressemblait à tant d'autres, déçu de ne m'avoir vu arriver pour tourner la clef avant que je n'entre. Tout tenait en quelques mots. «Ai construit notre monde. À vous de le louer. Serai là dans la nuit. Collins». N'ayant plus de voiture, j'étais retourné voir Lina pour lui demander qui pourrait me dépanner. Sur le chemin, j'avais acquis la certitude d'être suivi, mais personne ne s’était montré. J'avais trouvé Lina au milieu de valises, s'apprêtant à prendre le car pour partir vivre chez une tante plus au nord. Elle m’avait donné le nom d'un vieux fermier excentrique qui avait deux trois vieilles guimbardes et qui m'aiderait sans doute si je disais venir de sa part. Il faisait une chaleur écrasante et la poussière m'irritait les yeux. J’avais du marcher vingt minutes avant de repérer la ferme. Plusieurs fois je m'étais retourné et j'avais aperçu une voiture au loin rouler bien trop doucement pour être honnête.
Une nouvelle balle transperce la forêt protectrice. Ses arbres semblent resserrer un peu plus sur moi leurs branches pour me dissimuler à ceux qui la violent. Les chiens aboient de plus belle. Ils doivent être épuisés aussi à tirer sur leur laisse depuis des heures pour attraper ce curieux gibier. Je les plains.
Le vieux aux guimbardes me guettait derrière le rideau quand j’ai fait irruption dans sa cour ou poules, chats, chiens, lapins gambadaient joyeusement. Un vieux rocking-chair se balançait au rythme du vent sous l’avancée du toit. En voyant le rideau bouger, j’avais crié que je venais de la part de Lina. Une minute après la porte s’ouvrait et laissait apparaître les bras décharnés du vieux Charly - c’était son nom -. Il m’avait chaleureusement serré la main tout en s'étonnant de mon "curieux accoutrement". On avait parlé de Kennedy et de blues et je lui avais avoué ce que j'étais et ce que j'avais dans la poche. Ses yeux s’étaient mis à briller et il m’avait tendu une clef comme il l'aurait fait du Graal. « Prends celle-là, petit, c’est ma meilleure ! J’peux t’assurer que je la bichonne ! » On avait bu quelques verres, le temps de lui avouer que d'autres, moins bien attentionnés que lui, savaient sans doute qui j'étais et que cette affaire de procès n'avait certainement été qu'une ruse pour m'attirer sur leur territoire. Pour couronner le tout, le télégraphiste avait certainement vendu la mèche. Le soleil déclinait dans un rougeoiement de braise quand j'avais finalement pris la route. Deux nuages de poussière caractéristiques n'avaient pas tardé à prendre place dans le rétro. Le bijou de Charly avait sans doute eu son heure de gloire il y a 20 ans, mais il n’était plus de taille et la première des deux voitures m'avait bien vite collé aux basques. J’avais eu tôt fait d'y reconnaître le shérif et ses adjoints. La deuxième voiture s’était portée à ma hauteur et m'avait percuté violemment sur le côté, mais j'avais pour un temps évité la sortie de route en virant dans un champ. La forêt était à ma portée et le temps qu’ils fassent demi-tour, j’avais pu piquer un sprint entre les arbres. Ils ne s’étaient pas affolés, s'arrêtant tranquillement pour discuter. Sans doute voulaient-ils s’amuser un peu avant de me faire la peau. Une heure après j’avais entendu les chiens et m’étais précipité dans le ruisseau.
Deux nouvelles détonations trouent la nuit. Ils approchent. La tête me tourne et la douleur lancinante m'empêche de réfléchir. Soudain, mon cœur rate un battement. Là, derrière les arbres, j'entrevois une lumière ! Perdu comme ça ce ne peut être que des fermiers noirs. À bout de force, j'essaie de courir, mais mon corps me trahit. Je m'affale et ne peux retenir un cri de douleur que je regrette vite, car la seconde suivante les chiens hurlent de plus belle dans ma direction. C'est là qu'apparaît un jeune noir, caché derrière un arbre, dix mètres devant. Les boucles de sa salopette brillent par intermittence dans l'éclat de lune.
- N’ai pas peur, petit, approche ! Je susurre.
Il se fige contre l’écorce et je me rapproche en glissant à mon tour sous le halo lunaire. Il m'observe. Il ne semble plus avoir peur. Pas très loin le shérif gueule qu'il va me tuer, mais tout mon être est tendu vers le gamin, car je sais que je ne sortirai pas de ce bois. Je tends la main vers lui et il s'approche enfin doucement. Il doit avoir quatorze ans et deux lapins pendent à sa ceinture.
- Comment tu t’appelles ? Je demande dans un souffle.
- Melvin, M’sieur, murmure-t-il.
- Prends ce papier Melvin et apporte-le à ton père. Qu'il appelle ce numéro. On lui expliquera.
Cette fois j'entends la course de la meute. Dans quelques minutes, les crocs des chiens gouteront ma chair. Je griffonne au dos de la feuille et la tends au gamin qui la prend et la regarde machinalement.
- M’sieur... MLK ? C’est le pasteur ?
Je souris.
- Oui ! C’est bien Martin Luther King ! Maintenant, cours vite chez toi.
Il range la feuille dans sa besace et part tel un fantôme sans bruit entre les arbres. Je le suis quelques secondes et lâche un soupir avant de m'affaisser, vidé comme un boxeur au dernier round. Comme s'il me comprenait enfin, le ciel se noircit et masque la lune, protégeant la fuite de mon rêve. Melvin vient à peine de disparaître que le faisceau d’une torche m’attrape le visage.
- Bonsoir, « Maîîîîître » Collins. Vous courrez vite pour un avocat ! Crache le shérif. Vous avez quelque chose qu’on veut récupérer, mais ne vous donnez pas la peine, on le prendra sur votre corps froid ! Vous pourrez discuter avec le vieux Ryckmann finalement ! Ajoute-t-il en éclatant de rire.
- J’ai fait un rêve... Lui dis-je calmement, en souriant, un rêve dont vous entendrez parler et dont, quoique vous fassiez, vous ne faites déjà plus partie.
Cours, Melvin, apporte mes mots à Luther King, va faire sonner la cloche de la liberté ! Elle est le glas de notre monde de souffrance.
Il fait complètement nuit, au moment où la balle blanche pénètre mon crâne noir et y croise incrédule ces quelques mots d'un autre : "I have a dream…"
 6 commentaires
6 commentaires
-
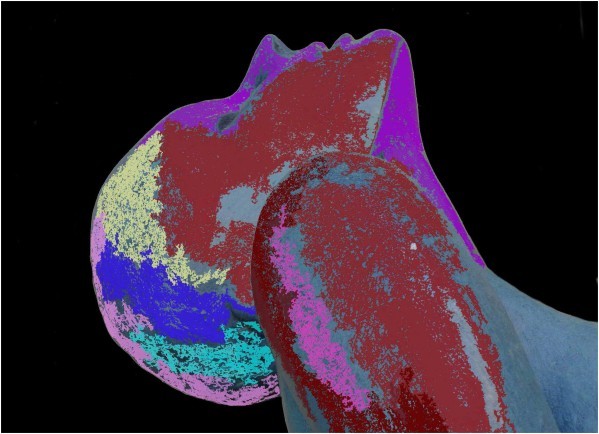
Une rentrée toute en fraîcheur et pleine de promesses avec notre illustre commémorateur...
James comment déjà ?
Jean-Claude Touray
- Tu vas me prendre, pour un drogué du numérique en manque… Mais j’ai mes raisons : voilà une heure que je cherche un nom dans tous les sites de rangement de mon cerveau et rien à faire ! Si j’avais eu accès à Google, l’affaire était réglée en une minute.
- On n’a pas de computer mais on a une tête… Je peux peut-être t’aider !
- Le comble, c’est que j’ai retenu à peu près tout de ce James…sauf son patronyme, ça me gonfle et ça me gêne considérablement dans l’écriture de mon roman : c’est le trisaïeul du héros. Il est né et mort à Londres où il vécut pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle et les débuts du suivant. Comme Alphonse Allais, il était fils d’apothicaire et s’intéressait à la politique, mais à la différence du natif d’Honfleur, il ne l’abordait pas avec l’humour que donne la pratique d’une certaine forme d’absurde. Il avait l’intrépidité et la détermination d’un défenseur de la cause du peuple, élu par le peuple à la Chambre des Communes.
- Je suppose qu’il a d’autres titres de gloire ?
- On le connait pour sa contribution active à la structuration de la Géologie, nouvelle science de la nature vers 1800. Ses travaux de collecte de description et d’interprétation des restes fossilisés d’animaux et de végétaux ont conduit certains à voir en lui le père de la Paléontologie. Mais il n’était pas le seul au monde sur ce créneau où le « coquillard amateur » était légion et l’on peut penser que d’autres demandes de reconnaissance en paternité ont été formulées. La science des fossiles est assez composite : elle a des domaines et des applications diversifiés et il est arbitraire de lui chercher un géniteur unique. C’est là que je me demande si James…
- Dalton ?
- Non ! … James « le géologue » avait une autre corde à son arc et suffisamment de notoriété pour mériter la promotion de sa mémoire dans le « Cercle des pipoles disparus ».
- Alzheimer ?
- Mais non, je cherche un Anglais, pas un Bavarois
- Parkinson ?
- Oui !! Je ne sais pas comment tu as fait, mais tu as trouvé… J’avais oublié de préciser que notre homme était également docteur en médecine. Il a été le premier à décrire une maladie d’origine nerveuse qu’il a dénommée « Paralysis agitans ». Il a fallu une cinquantaine d’années pour que l’importance de la découverte soit reconnue et qu’en hommage au découvreur la maladie porte son nom, sur la proposition d’un éminent savant français
- Pasteur ?
- Non, mais tu vas rire, j’ai oublié son nom.
 1 commentaire
1 commentaire
-

Depuis toujours, le théâtre est un formidable lieu de représentation de la nature humaine. Un cadre où se déploient les forces vives du désir et de ses désordres : amour, pouvoir, trahison, vengeance en sont des ferments incontournables. C'est dans la Grèce antique que s'est bâtie la cité d'Epidaure. Très vite, elle est devenue un haut lieu de la médecine et du théâtre. C'est là, sur un vaste plateau en plein air que les arts s'exprimaient, que les maladies de l'âme se dévoilaient, que l'émancipation et la servitude se défiaient, que la tragédie était à l'oeuvre.
Avec pour titre Epidaure, Patrick Denys, écrivain, philosophe et psychologue, nous annonce d'emblée le lien privilégié qu'il entretient avec la dramaturgie. Pour autant, l'auteur n'est pas l'homme d'un passé recomposé et s'il entreprend de nous faire voyager du côté de ce théâtre là, c'est pour nous faire entendre ce qui se joue encore aujourd'hui sur toutes les places du monde. Voilà donc un recueil de cinq nouvelles, un drame en cinq actes où les personnages, pris dans le huis clos du manque et du ressentiment, sont incapables d'échapper au même destin funeste.
On le sait, pour sa tranquillité, l'homme est un animal capable de verrouiller sa mémoire, mais il reste souvent désarmé face aux images maudites qui l'assaillent, impuissant à maîtriser les mots réprouvés, et c'est dans cette force de la rumination que se fondent quelques unes des morsures qui font saigner l'écorce de la raison.
"Folie du désespoir qui me murmure, aux heures de trop forte brûlure, l'idée de ton meurtre.C'est moi qui serait punie et cette punition, je ne la mérite pas. Pourquoi me priver à jamais du spectacle de tes souffrances ? Je ne veux pas ta mort, mon Yannis. Je ne désire que la contemplation apaisée de ton supplice."
C'est cette musique particulière, cruelle et poignante que nous offre Patrick Denys, et elle entre en profonde résonance avec l'acoustique du théâtre antique.
Epidaure de Patrick Denys aux éditions Orizons, 144 pages, 14€
 1 commentaire
1 commentaire
-

Onzième édition du concours de nouvelles Calipso : les nouvelles qui valaient leur pesant d'étoiles
Enracinés de Danièle Tournié
Jardin secret de Laurence Marconi
Je ne suis pas là de Nathalie Giaffreda
L’échange de Joachim Sax
La guerre des deux Marcel de Claudine Créac'h
La vie en beau de Danielle Chavancy
Le chevreuil de Christine Pruvot
Le juste au corps de Carole Exbrayat
Le roux noyer de Marie-Christine Quentin
Lionn Dubh de Lauren Dehgan
Loupiotte d'Eve Roland
Ma princesse d'Annick Demouzon
Nous n'irons plus au bois Emmanuelle Cart-Tanneur
On ne sait quoi dans l’ombre de Sylvette Heurtel
Passer la première de Marine Louvet
Une fois, Virginie aveec toi de Damien Blumenfeld
Une nuit de rêve de Jordy Grosborne
Trois petites notes de musique de Bruno Baudart
Comme chaque année, nous proposons aux auteurs "étoilés" par le jury lors de la première sélection, de les retrouver au café, histoire de ne pas limiter au seul recueil les regards et les sensibilités qui se sont exprimés à l'occasion du concours. Nous invitons donc les auteurs cités, et qui le souhaitent, à nous faire parvenir leur texte, accompagné d'une courte présentation, à notre adresse mail.
 3 commentaires
3 commentaires
-

Palmarès de la onzième édition du concours de nouvelles Calipso
1 - Pelle du saigneur de Dominique Chappey (Isère)
2 - Elle court d'André Fanet (Côte d'Or)
3 - Le fiancé de l'écorce d'Anne-Marie Teysseire (Rhône)
4 - 1955 de Laura Kuster (Vosges)
5 - Love me tender de Claudine Créac'h (Yonne)6 - Nouveau régime d'Emmanuelle Cart-Tanneur (Rhône)
7 - Ces yeux là de Désirée Boillot (Paris)
8 - La valise de Pierre de Martine Ferrachou (Haute Vienne)9 - Facture salée de Jean-François Vielle (Ille-et-Vilaine)
9 - De menthe et de thym de Ludmila Safyane (Rhône)
11 - La table en formica de Benoit Camus (Doubs)
12 - Retraite dorée de Patrick Ledent (Liège, Belgique)
13 - Fille de pute d'Isabelle Guilloteau (Côte d'Armor)La liste des auteur-e-s dont la nouvelle a été "étoilée" sera publiée en fin de semaine.
 10 commentaires
10 commentaires Suivre le flux RSS des articles
Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires
Café littéraire, philosophique et sociologique






























































